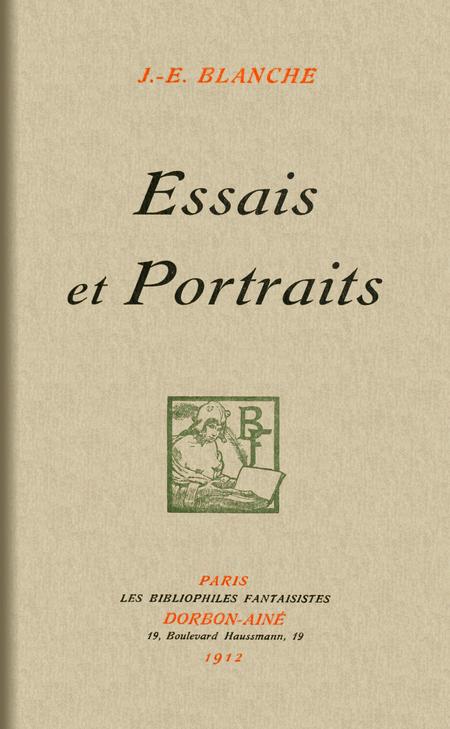
L'image de couverture a été réalisée pour cette édition électronique.
Elle appartient au domaine public.
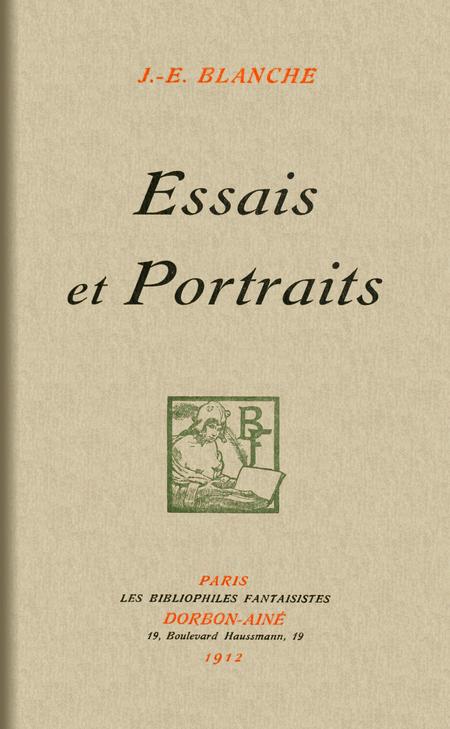
ESSAIS ET PORTRAITS
J.-E. BLANCHE

PARIS
LES BIBLIOPHILES FANTAISISTES
DORBON-AINÉ
19, Boulevard Haussmann, 19
1912
Ce volume a été tiré à
cinq cents exemplaires
numérotés à la presse,
dont quinze sur japon
numérotés de 1 à 15.
SERVICE DE PRESSE
Ces portraits n’auraient jamais été réunis en volume sans l’aimable insistance de quelques bibliophiles; écrits pour des revues, au moment que l’on jugea propice pour les faire paraître—le plus souvent à la mort de l’artiste dont j’essayai de retracer la figure—on me les demanda comme à quelqu’un qui avait connu le modèle. Si je me suis décidé à ne pas rejeter l’offre redoutable de les rassembler aujourd’hui, c’est que j’ai livré au public tant de portraits «peints»—dont beaucoup, sans doute, de médiocres,—que le danger ne me paraît pas sensiblement plus grand, de lui donner ces pages. Elles auraient pu trouver place dans des mémoires que j’aimerais à rédiger, si j’en avais jamais le loisir, tant me paraissent dignes d’être conservés, des souvenirs, des impressions d’années passées auprès de gens intéressants avec qui il me fut réservé de vivre. Parmi ceux-ci, les uns m’ont diverti, passionné, les autres m’ont inspiré de la méfiance ou de l’antipathie; le jugement porté sur eux par le critique ou par des amis, me sembla juste en peu d’occasions, plus souvent exagéré en bien ou en mal. L’amitié, les intérêts [p. 8] communs ou la haine et la jalousie faussent le sens critique. Je crois que le cœur a peu de raisons que ma raison ne connaisse pas, et juger est un besoin impérieux de mon esprit. Les liens les plus tendres de l’affection ne m’ont jamais fait changer en cela et envers moi-même je tâche d’être juge, le plus sévère des juges. Après des années de luttes douloureuses parfois et de quotidiennes difficultés, je jouis encore si vivement des choses et des êtres, que je ne regrette pas les coups échangés naguère. Si j’ai blessé ou étonné certains compagnons de route, j’en suis chagrin pour eux, mais je me repose sur les plus judicieux—car il en est, ma foi! qui m’ont deviné et ne m’en veulent pas.
Il faut dire ce que l’on pense:
Telle est ma conception de l’Honnêteté, à une époque de disputes et de troubles universels, où les convictions sont chancelantes, où l’on se bat sans avoir de grands principes à défendre (il n’est question ici que des artistes), par attitude, par désir de s’affirmer libre, par plaisir.
De chers camarades m’ont avoué que, selon eux, un peintre ne doit pas faire «de la critique». Tout ce que je puis leur concéder, c’est que «faire un Salon», c’est courir à un danger, si l’on est soi-même exposant. On n’admet plus qu’un sentiment: l’admiration passionnée. Or, vous n’avez pas toujours l’occasion d’admirer vos contemporains, si votre idéal de Beauté est élevé.
Sans doute, nous passerons parfois à côté d’œuvres belles et neuves sans les apercevoir tout de suite. André Gide s’est décidé, dès l’âge de vingt [p. 9] ans, à courir toutes les aventures plutôt que de risquer la honte d’avoir nié un Génie dont les ailes pointent à l’horizon. Je me résignerais encore à une telle calamité, mais me crois, en toute conscience, autant menacé d’un autre côté. N’acceptons-nous pas plus volontiers, aujourd’hui, que nous ne rejetons? Notre enthousiasme est toujours prêt à applaudir les débutants, mais nous avons peu de patience avec les vieux ténors, et Sainte-Périne est un asile qui nous paraît mieux approprié que le Théâtre, pour tout artiste dont la voix est devenue trop familière à notre oreille. Nerveux, inquiets, nous nous lassons tout de suite. Notre mémoire est courte comme notre patience. Nous oublions hier et attendons des miracles pour demain.
Les critiques de profession—s’il en est encore qui méritent ce nom—n’aiment pas assez la peinture pour pouvoir résister au travail surhumain que leur imposent les incessantes manifestations, les provocations indiscrètes de la production. Plaignons-les comme des condamnés au «Hard Labour», mais qu’ils nous excusent, s’ils ne sont pas toujours pris au sérieux. Croient-ils, aussi bien, en leur infaillibilité? Échappés de toutes les professions, quand ils ne sont pas de simples reporters, ils n’ont plus l’autorité de leurs prédécesseurs. Rarement lus, leurs plus sûrs clients sont les artistes qui leur fournissent de la copie.
En somme, je n’aperçois aucune raison valable—si ce n’est l’habitude et la convention—pour qu’un peintre n’écrive pas sur la peinture, comme les musiciens et les auteurs dramatiques, sur leur art. [p. 10] Les peintres ont des arguments à donner, en dehors de leur sympathie ou de leur aversion, sentiments d’un médiocre intérêt et critérium assez discutable.
D’ailleurs, dans ce volume, il n’y a pas, au propre, de la critique, et je me suis interdit de passer en revue des œuvres récemment produites et exposées. Sauf J.-L. Forain, mes modèles sont morts; mais je les ai tous connus vivants et je me suis permis de dire comment ils se sont présentés à moi.
La dimension de chacune de ces études n’est pas toujours en proportion avec l’importance du sujet. Par exemple, le grand Watts, à qui quelques lignes sont consacrées, il faudrait tout un livre pour le raconter. Mais voici des articles de revues, dont la longueur fut imposée par la place qu’on leur accorda dans chaque numéro—et le temps me manque pour refondre tout cela et l’écrire à nouveau.
La rapidité de la vie est si effrayante et tant de merveilles en remplissent les jours, qu’on voudrait en doubler la durée pour y mettre tout ce qui sollicite notre regard émerveillé.
J.-E. B.
Lorsqu’on allait frapper à la porte de Fantin-Latour, c’était à droite, au fond de la cour, no 8, rue des Beaux-Arts;—non pas à la porte de son atelier principal, qui était en face, mais d’un autre, construit en retour, petite pièce encombrée de peintures, où madame Fantin travaillait parfois—, on était préalablement examiné au travers d’un judas, afin que le maître de céans jugeât s’il devait, oui ou non, ouvrir. Entre l’instant où il avait aperçu le visiteur et celui où il l’accueillait, plusieurs minutes s’écoulaient: Fantin se demandait sur quoi il pourrait «attaquer» l’importun, quelle opinion il aurait à réfuter. Si c’était avant la fin de la séance, à l’heure du thé, ou s’il ne comptait pas vous engager à la conversation, vous le voyiez entre-bâiller la porte; le bras, rapproché de son torse massif, tenait haut dressés l’appui-main et la palette; une sorte de visière, comme celle de Chardin, abritait ses beaux yeux, brillant dans une large face, un peu russe d’aspect; des cheveux léonins se renversaient sur son vaste front de Capellmeister. Si l’on était reçu, c’était chez lui, dans une étroite galerie, au plafond vitré, sorte d’atelier de photographe, que M. Degas appelait «la tente orléaniste», sans doute à cause des bandes verticales en deux tons, dont elle était extérieurement revêtue, à la mode de 1830. C’est là que Fantin, pendant plus de trente ans, chaque jour, prépara ses couleurs, lava ses pinceaux, balaya le plancher et fit son œuvre.
[p. 14] La lumière était dure, tombant directement du toit peu élevé au-dessus du sol; point de recul, point d’espace vide, où l’on pût se tenir pour contempler les murailles qui disparaissaient sous les plus belles et les plus charmantes études. Un chevalet portait, en général, une vaste planche à lavis sur laquelle étaient retenus, au moyen de «punaises», cinq ou six carrés de toile, vieilles esquisses qu’il reprenait, ou dont il voulait s’inspirer pour de nouvelles compositions. Le poêle, surmonté d’un antique buste de femme en plâtre, répandait une chaleur congestionnante. Fantin était rouge, le col entouré d’un foulard, engoncé dans une grosse vareuse, les pieds traînant lourdement des chaussons de lisière. Et il était superbe avec son air terrible de vouloir vous souffleter de tout son mépris pour des opinions qu’il vous attribuait a priori. J’éprouvai toujours en l’abordant un petit sentiment de frayeur, à cause de ces façons rudes que les artistes de sa génération affectaient volontiers comme inséparables d’une noble indépendance. Il est probable que Fantin avait de la bonté et de la sensibilité, mais il ne tenait pas à en témoigner dans la conversation. D’aucuns avaient fini par ne plus le voir, non qu’il ne fût capable d’amabilité, mais parce qu’on le savait toujours prêt à partir en guerre contre des hommes ou des œuvres dont il vous croyait l’admirateur, s’efforçant à vous arracher du cœur des affections que souvent l’on n’avait pas, façons assez fatigantes, déroutantes, surtout pour ceux qu’il connaissait, comme moi, de longue date.
Il s’était assis autrefois à la table de mes parents et fut le premier peintre que j’entendis parler de son art; c’est lui dont j’ambitionnai des leçons, au sortir du collège. Il m’avait fait présent d’une toute petite toile, que je possède encore et qui renferme ses meilleures qualités et les plus exquises: portrait exact et touchant de deux pommes vertes, sur un coin de cet éternel meuble en chêne, où tant de fleurs et de fruits achevèrent [p. 15] leur brève destinée. Il peignit devant moi; je lui soumis mes premiers essais. Il les jugea nuls ou quelconques. Je lui suis reconnaissant de sa franchise comme je remercie tous ceux qui m’ont malmené:—légion!
Fantin est pour moi au nombre de ces figures bourrues et amies que nous avons vues, enfants, au milieu de notre famille et qui ont avec elle une sorte de parenté: ce caractère jadis commun à tous dans un même milieu, à une époque où le cinématographe international n’était pas encore inventé. Sa place est indiquée dans ces vieux albums à fermoir de cuivre où s’alignent les «cartes de visite» d’Alophe et de Bertall, offrant des gibus et des favoris de médecins, de magistrats et de notaires, à côté de dames à crinoline. Je voudrais me rappeler ses traits adoucis par le sourire que les enfants recueillent sur toutes les bouches dont ils attendent un baiser.
Fantin, a-t-on dit, est le peintre de la bourgeoisie sérieuse et intellectuelle. En effet, c’est à cette saine et forte classe, honneur du XIXe siècle, qu’il se rattache par bien des liens. Certains traits significatifs de son caractère, de sa pensée, sont d’un petit bourgeois élevé dans les idées voltairiennes, «libéral», admirateur de Michelet, encore un peu romantique et berliozien, aux goûts simples, point voyageur, infatigable liseur, passionné et timide, ennemi des gouvernements quoique partisan de l’ordre. Certains de ses amis, de même origine, se transformèrent au cours de leur existence, ou du moins les contacts extérieurs modifièrent leurs habitudes et les succès, leur situation. Un Manet, fils de magistrats sévères et gourmés, quoiqu’il n’ait pas quitté le cercle étroit de sa famille, devient tout à coup un brillant boulevardier et fréquente Tortoni. M. Degas lui-même a des phases d’élégance sportive. Mais Fantin, d’ailleurs fils d’un peintre très modeste, fut immuable dans ses goûts: le musée du Louvre, où il fit ses classes en même temps que l’école buissonnière, est l’unique église dont le culte l’ait fixé, le seul Eldorado qu’il ait rêvé.
On peut le suivre depuis son extrême jeunesse jusqu’à sa mort, faisant les mêmes gestes, aux mêmes heures, dans les deux arrondissements de Paris qui furent tout son univers. Non qu’il eût des œillères, car il fut mieux que personne au courant de la littérature et de l’art en France et ailleurs; mais si sa pensée vagabondait, [p. 17] son corps semblait enchaîné aux rives de la Seine, entre le pont des Saint-Pères et l’Institut, pour lequel il avait un secret penchant, mais dont il ne se décida pourtant jamais à franchir le seuil par fierté, indécision et peur du ridicule. Après tout, Chardin et les autres peintres du Roi n’eurent guère plus que lui l’humeur d’un touriste. Entre les quatre murs de l’atelier, une journée de travail que suspendent des repas frugaux; de bonnes lectures, le soir venu, sous la lampe; des cartons remplis de reproductions de tableaux célèbres (Fantin en décalquait «pour se mettre de bonnes formes dans la mémoire»),—que peut souhaiter de plus un sage, s’il conçoit l’importance de sa tâche, ne tient pas à conserver une taille mince et des mouvements alertes au delà de la quarantaine?
Fantin, lourd de corps, avait l’esprit vif. A l’horreur de l’exercice et du mouvement il joignait une sorte de terreur de tout ce qui est l’action. La guerre de 70 lui avait laissé un tel souvenir, qu’il se fût jeté parmi l’encombrement de la chaussée plutôt que de coudoyer un militaire sur le trottoir. Violent à l’excès en tête à tête, chez lui, il eût, en public, fait un long détour afin d’éviter une personne hostile. Aux vernissages de l’ancien Salon, emporté par sa passion pour ou contre ses confrères, il se faufilait par les galeries, sous la protection d’une petite phalange de dévots, qui recueillaient ses sentences. De ce pardessus très boutonné, de ce foulard, sortaient des jugements durs, amers, inexorables et parfois disproportionnés avec leur objet. Pas un nouveau venu qu’il n’ait découvert, surtout parmi les étrangers. Il était pour ceux-ci d’une indulgence incompréhensible: s’il s’agissait d’un «jeune» Scandinave ou d’un Berlinois, il en suivait les progrès ou les défaillances avec partialité.
Le «Salon» était pour Fantin le point culminant de l’année. S’y préparant plusieurs mois d’avance, il y envoyait autant d’œuvres que possible: il refusait de [p. 18] faire partie du jury, mais approuvait en principe les récompenses et les décorations.
Par égard pour la hiérarchie, il défendait les académiciens, et redoutait les impressionnistes comme ennemis de l’ordre; toujours irritée, et, somme toute, difficile à suivre, pleine de contradictions—sa critique avait une belle violence de sectaire.
Deux tableaux à l’huile, deux pastels, des lithographies, telle était sa contribution annuelle,—«son Salon», comme on disait alors.—Et, le jour du vernissage venu, c’était une partie familiale et un acte rituel que de dépasser le pont de Solférino, de s’engager dans les Champs-Elysées et de déjeuner à midi sous l’horloge du Palais de l’Industrie, à «la sculpture»,—évitant «Ledoyen» à cause des courants d’air et des lazzi des Béraud, des Duez, amusants, mais qu’il préférait qu’on lui rapportât dans l’après-midi.
Une journée de lumière et de fête dans toute une année de claustration voulue! Après le repas, on montait dans les salles, puis redescendait aux allées bordées de bustes de marbre, où les élégantes promenaient leurs robes et leurs chapeaux de printemps parmi les groupes de plâtre et les rhododendrons.
Six heures ayant sonné, la foule chassée par les gardiens s’écoulait au cri de «on ferme! on ferme!», et Fantin rentrait avec une migraine, dans son cher appartement, pour reprendre aussitôt ses habitudes de chat domestique.
Il faut connaître ces coutumes invariables du peintre, heureux dans sa retraite, marié à une femme supérieure, elle-même peintre de mérite; il faut savoir sa fidélité à quelques principes et à quelques idées de jadis, pour s’expliquer son œuvre, sans pareille à notre époque: les causes qui la restreignirent lui donnent une part de sa signification et de l’originalité.
Fantin, qui s’instruisit lui-même auprès des Maîtres, sans passer par l’Ecole, est un exemple parfait pour les jeunes hommes d’aujourd’hui. Tel artiste, plus hardi que lui et de plus d’invention, aurait peut-être fait un autre usage du catéchisme appris au Louvre. Tout ce qu’il faut savoir, il le savait. Et quelle compréhension des maîtres! Ses copies sont des chefs-d’œuvre. Sont-ce même des copies? Il s’y montre personnel autant que partout ailleurs. Si fidèlement elles traduisent les originaux, tel est leur accent que, dès le début, elles étaient reconnaissables entre toutes, recherchées des amateurs. Fantin sut réduire aux proportions d’un tableau de chevalet, tout en lui conservant leur noblesse, l’héroïque envergure des Noces de Cana. Plusieurs fois il renouvela la gageure. On lui commandait des répliques qu’il exécutait, rapidement, dans la lumière rousse, mais insuffisante, du Salon Carré. Si j’excepte les grands morceaux que fit Delacroix d’après Véronèse, je ne sais rien qui prouve une pénétration plus aiguë du génie du maître. Véronèse, Titien, Rembrandt donnèrent au jeune artiste l’occasion d’autres [p. 20] traductions aussi éloquentes. Comprendre à ce degré un chef-d’œuvre, et ajouter à sa copie une part si importante de soi-même, pourquoi ne serait-ce pas un peu de génie? Génie de peintre, purement de peintre et de technicien. Mais, somme toute, n’est-ce pas là, pour un tableau de quelques centimètres et ne prétendant pas à décorer un monument, ni à instruire les foules, ni à aider à la révolution sociale, n’est-ce pas un but très élevé?
M. Charles Morice, dans un questionnaire proposé à mes confrères, demandait ce que Fantin a apporté, ce qu’il emporte dans la tombe. Cette question parut un peu déconcertante. Elle ne pouvait venir que d’un homme de lettres, pour qui les opérations intellectuelles du peintre restent toujours assez impénétrables. La nouveauté, l’invention, en peinture, se décèlent souvent en un simple rapport de tons, en deux «valeurs» juxtaposées ou même en une certaine manière de délayer la couleur, de l’étendre sur la toile. Qui n’est pas sensible à la technique n’est pas né pour les arts plastiques, et telle intelligence très déliée passera à côté d’un peintre pur, sans s’en douter. Naturellement, un peintre qui, par l’intérêt des sujets qu’il traite, et par la joie physique qui se dégage de son œuvre, conquiert un plus large public,—qu’il se nomme Rubens, Delacroix ou Chavannes,—est plus haut placé dans l’opinion des hommes qu’un petit maître comme Fantin; mais Fantin excelle dans ses menus travaux. Ce qu’il a apporté? Une jolie et charmante technique, un dosage curieux des «valeurs», un parfum de lavande d’armoire à linge bien rangée. Ce qu’il a emporté? Rien du tout. Un artiste n’emporte rien dans la tombe: il livre tous ses secrets en ses toiles; libre à chacun de les approfondir, et, s’il ne craint pour sa propre personnalité, de se les assimiler!
Fantin-Latour, picorant comme un jeune coq dans les ouvrages des maîtres anciens, si variés et si stimulants, s’était nourri solidement pour la route. On voit, dans la première partie de sa carrière, quel robuste et raisonnable [p. 21] métier il avait à sa disposition. Alors, oseur, ardent, l’influence du passé n’agissait sur lui que comme un tonique. Parmi des hommes jeunes, tous plus ou moins révolutionnaires,—confrères ou littérateurs,—sa timidité naturelle se dissimulait encore. Les camarades l’aiguillonnaient: il était emporté, sans doute un peu malgré lui, dans un magnifique mouvement d’indépendance et de protestation contre l’académisme. M. Lecoq de Boisbaudran, qui dut être un exalté, communiquait une flamme aux plus froids de ses élèves. Il est probable que ce fut grâce à ce professeur clairvoyant qu’ils eurent tous de belles qualités et que de très bonne heure, ils découvrirent en eux-mêmes et montrèrent dans leurs ouvrages tels de ces dons individuels qui parfois tardent à se produire.
Si nous voyons les artistes de premier rang se développer et élargir leur manière à mesure qu’ils vieillissent, certains autres épuisent très vite leurs réserves. Fantin portait en soi une faiblesse; pour lutter contre elle et la vaincre, une vie plus extérieure eût été nécessaire, avec moins de ces petites manies bourgeoises qui l’enrênaient. Cette faiblesse fut la timidité et la peur des êtres vivants, la phobie du prochain.
Dès ses débuts, il se claquemure; ses deux sœurs sont presque les seules femmes qu’il ne craigne pas de faire poser. Elles sont d’aspect austère et gardent une certaine tournure chaste et noble très particulière à leur classe et à leur temps. La réserve tranquille qui se dégage suavement de leurs personnes, ajoute à la saveur du tableau. Nous sommes loin de la société élégante et frivole que portraiturent les favoris du jour.
Paris ne présente plus ces caractères tranchés qui permettaient encore sous le second Empire de reconnaître la classe sociale des individus à leur mise même; une même tenue, qui recouvre la personnalité d’une manière uniforme, semble peu propre à stimuler l’inspiration du portraitiste actuel. Les grands magasins de [p. 22] nouveautés répandent dans tous les quartiers de la ville et en province ces «confections» adroites à singer les odieuses modes qu’impose la rue de la Paix à un public sans imagination. Les femmes sont, comme malgré elles, tirées à quatre épingles, coiffées d’absurdes chapeaux. Elles n’ont point de mal à se donner pour avantager de fanfreluches et de colifichets leur taille volontairement déformée, celles que nos attachés d’ambassade, séjournant à l’étranger, déclarent sans rivales pour la sensualité de leurs courbes. La toilette féminine a pour idéal l’image du journal de modes.
Un manque total de fantaisie et la peur de rien «oser»—si particulière à notre race—ne sont inoffensifs qu’en des temps autres que celui-ci. La beauté des styles en France, jusqu’après Napoléon Ier, reflète la rigidité, la dureté d’une volonté supérieure et l’honnête respect de ceux qui, même de loin, dans les campagnes, imitent avec de bons matériaux et naïvement, ce que la Cour a commandé. Il était fatal que, sous un régime démocratique et égalitaire, le goût fût tel que nous le voyons. Nous savons ce qu’est la fausse élégance d’une rue parisienne, le dimanche; nous savons aussi ce qu’au théâtre, la scène offre à notre délicatesse vite blessée: les actrices habillées à grands frais par les couturiers, pour affoler les spectateurs du paradis et les riches cosmopolites des loges ou de l’orchestre.
Il n’y a que trop de raisons pour expliquer la lamentable école de portraitistes dont la France semble avoir le privilège. Nulle distinction, nulle noblesse de maintien, dans la «société»; ni simplicité, ni jolie retenue chez les personnes de condition moyenne, mais une banale, universelle élégance, tapageuse ou guindée. Même en province, on ne trouve plus de ces types fortement caractérisés, de ces attitudes gauches, si charmantes, si privées, qui donnent à l’artiste l’envie de les peindre. Partout la platitude, un manque général de saveur. Et, dernier vestige de la tradition, suprême rayonnement de [p. 23] notre goût si fameux, la supériorité de nos couturiers est celle que partout encore on subit sans protester. Où sont les berthes, les canezous, les guimpes et les rotondes et ces cols rabattus des femmes de naguère?... D’instinct, Fantin-Latour s’écarte de la Parisienne, de l’élégante. Il sent, quoiqu’il ne l’ait peut-être pas analysée, la transformation du type français et des mœurs. Il assiste à la dégradation progressive d’une beauté pure et modeste, qui lui est chère, sans qu’il se permette de chercher loin de lui, là où elles étaient peut-être, les créatures dont son pinceau aurait pu rendre l’allure... Les modèles lui faisaient défaut, ou du moins il se l’imaginait: de là une retraite anticipée du portraitiste. Il prétextait de la gêne qu’il eût éprouvée devant des personnes inconnues. Très nerveux, facilement agacé par les conversations, maniaque comme une vieille fille, la présence d’autrui le paralysait d’ailleurs. Toute personne étrangère à son petit cercle troublait l’atmosphère, lourde, mais si recueillie, dans laquelle il avait conçu et réalisé ses meilleurs morceaux. Marié, il ne fit plus guère poser que sa femme et les membres de sa famille, les Dubourg, à la tenue protestante, ou bien des artistes, ses amis. A part ceux-ci, je ne vois guère que madame Léon Maître, madame Gravier et madame Lerolle dont il entreprit de fixer l’image, et ce furent là des effigies assez froides et compassées.
Fantin était d’une maladresse attendrissante dans l’arrangement d’un fond d’appartement ou le choix d’un siège. Ce réaliste scrupuleux épinglait derrière le modèle un bout d’étoffe grise ou dressait un paravent de papier bis, chargé de représenter les boiseries d’un salon. Dans Autour du piano, dont Emmanuel Chabrier forme le centre, je me rappelle la peine qu’il prit pour donner quelque consistance au décor. D’ailleurs ce tableau célèbre, excellent en quelques-unes de ses parties, demeure comparable à une scène du Musée Grévin. M. Lascoux, M. Vincent d’Indy, M. Camille Benoît sont des mannequins [p. 24] d’une mollesse et d’une gaucherie d’attitude tout à fait surprenantes.
L’atelier de Fantin n’était pas plus subtilement éclairé que celui d’un photographe de jadis. Il n’y modifia jamais les jeux de lumière. Sa paresse et l’effroi qu’il avait de se transporter hors de chez lui le restreignaient encore. Il ne savait pas varier ses effets, donner de l’imprévu à ces réunions d’hommes, sur lesquelles Rembrandt eût fait glisser de magiques rayons dans un clair-obscur ambré. Il souffrit de ce plafond de verre, qui, d’un bout à l’autre de la pièce, baignait également les visages d’une lumière diffuse. La famille Dubourg, autre toile célèbre,—à mon avis l’une de ses moins bonnes, d’un modelé mol et affadi,—m’apparaît telle que si M. Nadar avait prié ces braves gens de venir chez lui à la sortie de l’office divin, tout ankylosés dans leurs vêtements dominicaux.
On éprouve du regret en songeant aux merveilleuses qualités, aux dons rares que Fantin s’interdisait de mettre en œuvre par peur de la rue, de la vie et,—en somme,—des autres.
Il est deux exemples, cependant, de ce que Fantin pouvait faire, quand un hasard le forçait à dresser son chevalet en face de personnages exotiques. Les Anglais qui s’adressèrent à ce portraitiste difficultueux, avaient sans doute deviné que l’auteur des «Brodeuses» apprécierait leur sévère dignité et leurs habits sans prétention.
Je ne sais dans quelle occasion,—sans doute par l’entremise d’Otto Scholderer, établi en Angleterre,—l’avocat peintre-graveur Edwin Edwards et sa femme, lui avaient été présentés. Il alla même à Londres, chez eux, et je devine ce que dut être ce déplacement, y ayant fait moi-même un séjour avec Fantin en 1884. Ce premier voyage «au delà des mers» dut s’accomplir après 1870, alors que Whistler et plusieurs artistes français, entre autres Alphonse Legros, Cazin, Tissot, Dalou, s’étaient [p. 25] fixés hors de France. Mr. Edwin Edwards, occupait les loisirs de sa retraite à graver de dures, sèches, mais curieuses planches, et il avait une villa à la campagne où Fantin fut invité. Je ne sais si c’est là que fut exécuté le double portrait ou si ce fut dans la délicieuse lumière opaline de Golden Square, ce coin vieillot que l’on croirait hanté par l’ombre de Dickens; peut-être même fut-ce rue des Beaux-Arts tout simplement. C’était un fort beau couple. Mrs. Ruth Edwards, les bras croisés, avec son visage anguleux, dur même, le teint rose, les bandeaux de cheveux grisonnants, est debout, vêtue d’une robe en gros tissu d’un indéfinissable gris bleu, que nos élégantes critiqueraient sans doute, mais dont la forme est harmonieuse et picturale. A côté d’elle, assis, médite en regardant une estampe, Mr. Edwards, dont les traits réguliers, la barbe et les cheveux blancs, avec son expression de sereine placidité britannique, complètent un ensemble exceptionnel dans l’œuvre de Fantin. Cette toile appartient déjà à la National Gallery. Mrs. Edwards avait promis de l’offrir à la Nation dès qu’elle le pourrait. L’épreuve était redoutable pour notre compatriote et notre contemporain. Vous pourrez voir l’excellente tenue que garde ce morceau vibrant au milieu des chefs-d’œuvre qui l’entourent et avec qui, sans plus attendre, on l’a décrété prêt à voisiner.
Une autre fois, Mrs. Edwards força son ami à entreprendre le portrait d’une jeune fille, miss B... Après beaucoup de résistance il consentit à recevoir chez lui cette étrangère, dont la vivacité et les libres allures bouleversèrent le no 8 de la rue des Beaux-Arts. Revêtue d’une longue blouse de travail jaune, d’une cotonnade à menus dessins, ton sur ton, Fantin l’assit de profil, devant l’inévitable fond gris, regardant des fleurs de crocus jaunes dans un verre, qu’elle s’apprête à copier à l’aquarelle. Et ce fut encore là une grande réussite, quoique le maître se fut mis à la tâche furieux et contraint. De quelle précieuse galerie il nous a privés, dont il eût rassemblé [p. 26] les éléments en se répandant un peu au dehors, puisqu’il ne voyait plus à Paris les types chers à sa jeunesse.
Rappelons encore ce beau tableau, un peu froid, mais si intense: mademoiselle Kallimaki Catargi et mademoiselle Riesner, étudiant la tête en plâtre d’un des esclaves de Michel-Ange, et un rhododendron aux sombres feuilles.
Nous sommes reconnaissants à ces dames et à tous ceux qui ont apprêté pour Fantin un motif un peu piquant mais approprié; à ces «intrus» dont l’apparition rafraîchit la vision du solitaire. Il est presque regrettable que Fantin n’ait pris part aux événements de cette Commune où se laissèrent enrôler d’enthousiasme, maints généreux et naïfs artistes, ses amis. L’exil et la lutte l’auraient galvanisé et peut-être sa puérile timidité eut été vaincue. En tout cas, il aurait rencontré, soit en Angleterre ou en Allemagne, des visages accentués, des êtres lents, simples et ennemis de la mode, il aurait pénétré dans des «homes» silencieux et inquiets, pour lesquels il avait un goût si marqué; mais il se maria et fut plus que jamais ancré aux rives de la Seine.
Ce bourgeois, casanier avec entêtement, se plaignait de toutes les choses de chez nous: elles choquaient son esprit. Ses sympathies de vieux romantique pour l’Allemagne, allaient s’accroître dans une famille française, mais germanique de tendances et d’éducation, où deux femmes supérieures et cultivées, favorisaient par des lectures continuelles, de la musique, et des discussions, certains penchants de Fantin. Ce n’était plus l’intérieur du père et des sœurs—les «brodeuses» à qui nous donnons le premier rang dans son œuvre d’avant 1870 et dans toute son œuvre,—mais une sorte de petite Genève à l’entrée du Quartier Latin, un oratoire protestant, sectaire, jalousement clos où l’activité cérébrale et les passions à la fois artistiques et politiques allaient s’exaspérer.—Nous allons voir comment, verrouillé chez lui, Fantin transporta [p. 27] dans sa peinture, de vives impressions littéraires et musicales et, de plus en plus méthodique et dur, quant à la forme, nous confia les secrets de son cœur, d’abord en de savoureuses esquisses, puis en des tableaux plus conventionnels, qui occupèrent la fin de sa vie, pour la joie future des marchands de la rue Laffite, si non pour la nôtre.
D’assez bonne heure, Fantin avait fréquenté des littérateurs, comme l’indiquent l’Hommage à Delacroix et cette tablée de poètes du Parnasse où le jeune Arthur Rimbaud appuie ses coudes de mauvais petit drôle près d’une brillante nature morte;—deux ouvrages qui, avec l’Atelier de Manet, aujourd’hui au Luxembourg, faisaient espérer un peintre de la grande lignée hollandaise et flamande.—L’exécution en est très variée. Dans l’Hommage, la pâte est transparente, légère, chaude et rousse. Dans les deux autres, les têtes, très inégales de qualité, sont plus grises, parfois admirables, parfois creuses et de construction molle. On sent que Fantin excellait surtout à «enlever» des morceaux, ne parvenant que rarement à relier dans l’air, les uns aux autres, plusieurs personnages.
Telles quelles, ces pages appartiennent à l’histoire artistique et littéraire; nous devons les tenir pour très précieuses, quels que soient le convenu des gestes et l’immobilité des expressions. C’est le temps du Parnasse, c’est l’enfance de l’Impressionnisme, heure significative dans le XIXe siècle. Fantin fut lié avec ces hommes dont il nous importe tant d’avoir l’image; il la traça d’un pinceau souvent très fin, sans doute dénué de cette puissance dans le modelé et le dessin, de cet accent je dirais caricatural, qui, à l’étonnement de nos présents esthètes, feront plus tard de M. Bonnat une figure considérable;—bien plus tard, quand on aura oublié qu’il fut décoré [p. 29] de tous les ordres, portraitiste trop abondant, officiel, et presque Ministre.
Fantin rendit l’aspect, le teint de ses amis, sinon toute l’individualité de leur structure, et il les baigna dans une atmosphère délicate. Il devait être nerveux en leur présence et, ne pouvant ou ne voulant jamais «reprendre» un morceau, tenant surtout à la fraîcheur de la pâte, il n’analysait pas toujours assez les têtes, dans sa hâte de peindre ou sa terreur de fatiguer l’ami qui pose. On dirait qu’il ne conversait pas avec celui-ci: or, des séances de portrait ne sont fructueuses que si un rapport intime s’établit entre le portraitiste et la personne portraiturée.—Vous verrez, quelque jour, dans une exposition générale qui sera une révélation, des toiles anciennes de M. Bonnat: sortes d’instantanés, pour la déformation cocasse du dessin, victoires de cet observateur parfois cruel, outrancier, dont la matière, souvent pareille à celle de Ricard, s’émaille, à la longue. Or c’est un dessin original qui manque aux groupes de Fantin.
Les séances de portraits sont épuisantes, si l’on n’a pas le goût de la conversation et si les gens vous importunent par leur présence. Il eût fallu que Fantin gardât toujours auprès de ses semblables un peu de cette liberté qui lui permit de faire, comme nul autre, des fleurs et des fruits, de la nature morte. Avec la même sûreté, semblent avoir été conduits jusqu’au «rendu» intense et définitif de la vie, quelques-uns de ses portraits: les Brodeuses, le buste de mademoiselle Fantin, les nombreuses têtes du maître et les deux portraits de sa femme, dont l’un est au Luxembourg, l’autre au musée de Berlin. Ces quelques pages de la plus heureuse venue font penser au style soutenu et ample des Vénitiens; font songer à Rembrandt aussi, et atteignent les hauts sommets de l’art du portraitiste. Il suffirait d’ailleurs à Fantin de les avoir signées, pour que sa gloire fût méritée. Le peintre s’y montre tel qu’il voulut être: d’un autre [p. 30] temps, retardataire résolu, irrévocablement traditionnel et d’intimité.
Deux personnes aimées, silencieuses dans l’atmosphère chaude de vie familiale d’une chambre toujours habitée, il excelle à les nimber de pureté et de candeur, il se complaît à dépeindre leur intimité. Mais il lui faut des conditions de sécurité toutes spéciales. Ses groupes de littérateurs et d’artistes, quoique distingués, ne sauraient nous convaincre. Il y eut toujours un moment où Fantin, gêné auprès d’eux, ennuyé, timide, souhaita d’être seul et ne put rendre, faute de recueillement, ce qu’il voyait si bien auprès des siens, dans son propre foyer. Prises séparément, les têtes d’Edouard Manet, de Claude Monet, de Renoir, d’Edmond Maître, de Scholderer, dans l’Atelier aux Batignolles, sont des morceaux exquis. Peut-on dire que la toile, dans son ensemble, ait une allure magistrale? Ne lui manque-t-il pas ce qu’il y a de direct dans les Brodeuses, sans pour cela s’affirmer comme un Franz Hals?
Les grandes toiles de Haarlem donnent l’exemple de ce que peut fournir d’éléments picturaux, une réunion nombreuse d’hommes et de femmes, vue par un maître-peintre; chaque fois que Fantin multiplia des figures dans un ensemble, il pécha par le dessin; non qu’il ne pût copier exactement «un morceau», mais le dessin, le grand dessin est tout autre chose que cela. L’arabesque qui remplit d’un bout à l’autre la surface à couvrir, la ligne, non pas exacte, mais décorative, qui chez les maîtres, court dans l’huile et la couleur, cernant la ressemblance, comme au hasard, par besoin, mais sans application ni effort, Fantin n’eut pas ce don souverain. La belle facilité si décriée de nos jours—celle de Rubens, de Van Dyck, de Vélasquez, de Fragonard et de Reynolds—est le contraire de ce qui distingue la personnalité de Fantin. Cette brillante qualité, galvaudée par de bas prestidigitateurs, transformée en virtuosité à bon marché, [p. 31] à mesure que le faux-semblant, l’escamotage se substituaient au savoir, personne ne l’a plus depuis longtemps. M. John S. Sargent possède la science du dessin, mais sa couleur ne s’harmonise pas toujours avec la forme; pourtant, seul parmi nous, il continue la tradition du grand portraitiste, que rien n’arrête dans son métier.—Ce don fut refusé à Fantin-Latour qui sut dire plus bas, les paroles qu’il avait à murmurer dans une chambre close.
Fantin occupa, pendant les vingt dernières années de sa vie, une position très spéciale, respecté par les deux camps extrêmes dont il se tenait à distance, comme à mi-côte, en plein succès. Pourquoi les critiques les plus avancés le classèrent-ils parmi les impressionnistes et les révolutionnaires? Respecté de tous, isolé, entre l’Institut et les Indépendants, il fut défendu par les petites revues et les journaux, par tous ceux qui jugent et écrivent, comme s’il était attaqué—ce qu’il n’eût pas été séant de faire. N’exerçant aucune influence,—car son difficile métier est de ceux qu’on ne s’essaye pas à imiter,—refusant de faire partie d’aucun jury, seul, toujours seul, si j’omets quelques amis, il inspirait le respect à ceux-là même qui n’avaient pour lui qu’un goût médiocre. Il fut à la mode et toujours cité à côté des novateurs. Pourquoi? nous nous le sommes souvent demandé.
Il inspirait de la sympathie à toute une classe de Français par la modestie, sinon par la pauvreté de sa mise en scène. En le défendant, on protestait très justement contre les portraitistes mondains. Pour beaucoup d’amateurs un peu naïfs, le seul fait de représenter une élégante en ses atours et de peindre une mondaine, constitue une sorte d’infériorité morale, qui ne va pas sans entraîner les défauts du peintre à gros succès, aimable et superficiel. Les critiques d’avant-garde devaient se servir de Fantin comme d’un drapeau. La manie de la politique et de la [p. 33] sociologie, l’amour des humbles—réaction dont il faut sourire, comme de tous les snobismes de la mode—exaltait la simplicité, même la laideur, au détriment du «joli». Cela était inévitable, après les excès d’adresse et de coquetterie, dont l’école française se rendit coupable au lendemain de 1870, à l’heure de ses succès scandaleux. M. Valloton jouit aujourd’hui du même privilège.
Pour un publiciste candide, l’autorité de Fantin, le «dépouillé» de ses toiles froidement nues, sa sécheresse même, devaient signifier grandeur, profondeur, solidité. Plus ses fonds étaient tristes, ses personnages guindés et modelés menu (portraits de M. Adolphe Jullien, de M. Léon Maître, de la nièce de l’artiste), plus on admirait sa manière «discrète» et son goût. C’est à des raisons morales, à l’attitude, pour tout dire, d’un certain public, que Fantin dut des faveurs exceptionnelles. Ses incomparables natures mortes, ses fleurs, n’étaient pas encore connues à Paris; ses fantaisies mythologiques plaisaient peu, avant que la spéculation ne les lançât sur le marché, comme une «bonne affaire».
Nous savons les milieux où sa réputation se forma et quelles personnes souhaitèrent d’être peintes par lui. C’est à un public limité que ses qualités modestes, puritaines et bourgeoises agréèrent, d’abord. S’il eût accepté des commandes, nous imaginons sans peine la file de modèles qui se fussent pressés à sa porte, les redingotes noires, les binocles tenus dans la main droite, les ennuyeux chapeaux, les dames point belles et vêtues d’un costume tailleur ou d’une robe à demi décolletée en carré, que son pinceau aurait eus à fixer, sur un fond de terne boiserie grise;—vêtements sans attraits pour le coloriste, mais tant de solide intelligence, de sérieux et de vertu dans ces visages graves!—Fantin eût fait avec certains Parisiens de la fin du XIXe siècle une galerie aussi typique que celle des Allemands de Lembach. Mais la fantaisie, le pittoresque, l’abandon [p. 34] en eussent été exclus. Rappelez-vous le portrait de M. Adolphe Jullien, qui est caractéristique: soigneusement dessiné, modelé jusqu’à la fatigue, dans une lumière argentée, un monsieur est assis comme il le serait chez Pierre Petit, une main appuyée sur une table, dont le tapis d’Orient est d’ailleurs exquis, et l’autre, sur sa cuisse. Professeur? commerçant retiré? médecin de quartier? on ne peut dire ce qu’il est; mais c’est un homme sérieux, qui déteste endosser le frac, le soir venu, pour qui «se soigner» est un supplice, une entrave aux habitudes de son cabinet, une lâche concession aux caprices du «monde». C’est un laïque, qui réprouve, comme ferait un bon prêtre, les grâces, les jolies inutilités, le faste de la vie.
Et les épouses de ces hommes sans fantaisie? Excellentes mères de famille, instruites et hautement respectables, nous les vénérons, même dans leurs erreurs généreuses et leurs petits ridicules, mais leur mépris des futilités de la parure offre un mince régal au coloriste. Parvenus aux honneurs officiels, ils seraient tenus, hommes et femmes, de passer par l’atelier de M. Bonnat; mais, simples particuliers, ils voudront que Fantin soit leur peintre.
Fantin redouta peut-être des conversations dont son esprit paradoxal se fût irrité, que son ironie et sa causticité eussent interrompues. Il eût tôt pris le contre-pied d’opinions émises par sa clientèle d’admirateurs. Ce solitaire dédaigneux les eût bien vite déconcertés par de subites boutades et un tour d’esprit le plus original. Fantin était un bourgeois, mais point de ceux-là!
Il vivait deux vies mentales, à la fois; la peinture maintenait en équilibre les deux sphères, d’apparence si étrangères l’une à l’autre, dans lesquelles sa pensée se plaisait. Les philosophes, les poètes, les musiciens enrichissaient de leur incessant commerce son cerveau, aussi actif que son corps était lent. Dans son fauteuil d’acajou, assis comme un notaire de province, près [p. 35] de l’abat-jour vert d’une lampe Carcel, il poursuivait un rêve somptueux que ses compositions, d’inspiration poétique ou musicale, font deviner, mais ne traduisent qu’imparfaitement. Jamais il ne donna une forme digne de lui—par le pinceau ou le crayon lithographique—aux visions qui l’assaillaient pendant les lectures à haute voix, des soirées de tête-à-tête, où son imagination s’exaltait, s’enflammait comme à l’audition d’un opéra ou d’une symphonie. Mais la pensée vagabonde revenait toujours aux formes et aux objets familiers: poète, il était avant tout un peintre réaliste. Tous les éléments combinés dans ses tableaux de fantaisie, il serait aisé de les trouver à portée de sa main, autour de lui. Ses paysages modérés, les colonnades de ses temples, ses draperies, tout cela n’est-il pas tiré de ces innombrables cartons d’estampes, chaque jour feuilletées, étudiées amoureusement, copiées même? Son type féminin, beauté un peu corrégienne, blonde, grasse, au visage d’un ovale plein, il l’a vu, vivant auprès de lui; ce sourire, cette bouche, nous les retrouvons dans tels de ses groupes de famille, chez certaine dame à pèlerine, qui boutonne son gant de chevreau glacé (portrait de la Famille D...). Ce type est celui de ces chastes beautés que Fantin, sensuel et réservé, fit courir au clair de lune dans les fourrés mythologiques. Il n’osait regarder que ses proches, parmi les vivants, et, s’il rêvait de parcs et de bois, c’était de ceux qu’il préférait: les fonds des tableaux de maîtres...
Admirable et un peu dangereuse claustration volontaire d’un artiste qui se détourne de l’activité moderne et, par entêtement, par crainte aussi, se circonscrit, décide qu’il vivra jusqu’à sa mort, là où il naquit.
Ce n’est pas du renoncement, mais une retraite de sage qui veut, de sa cabine, regarder, juger sans courir les risques de la mêlée.
Un grand peintre n’a pas nécessairement une culture universelle, il lui manque le temps de se la donner et le génie devine ce que d’autres apprennent. Fantin voulut tout connaître.
Il est peu de questions à quoi il soit resté étranger. S’il sortait à peine de chez lui, son information et sa culture étaient sans cesse entretenues par des conversations, par les revues et les livres qu’on lui prêtait. Il supporta même, non sans impatience, certains habitués fatigants et trop empressés, en faveur des notions qu’il tirait d’eux. Chaque visiteur, chaque ami correspondait pour lui à une spécialité et à certains thèmes de causerie. Parmi les fidèles de la rue des Beaux-Arts, qu’il me soit permis de citer le nom du très cher Edmond Maître, qui écoute, de profil, au premier plan du tableau Autour du piano et dans l’Atelier aux Batignolles: à Edmond Maître je devrai une éternelle gratitude, car il me fit respecter, avant que je fusse d’âge à les apprécier, certaines belles choses, certains artistes dont les jeunes gens s’écartent instinctivement. Qu’on m’autorise à citer ici, à côté de Fantin, le nom de cet homme d’élite, qui fut trop orgueilleux ou trop modeste pour rien signer, et se borna à fréquenter les plus distingués entre ses contemporains, peintres, musiciens, poètes et philosophes, dont il fut aimé et consulté. Pour un conseil, un éloge de lui, nous eussions tout sacrifié. Quel esprit compréhensif, grave et aimable! Vous n’auriez pu souhaiter un guide plus autorisé [p. 37] dans tous les domaines de la connaissance. Il se contenta d’être un amateur et un dilettante. Il avait tellement joui par l’exercice de sa pensée et sa mémoire était si riche que, brisé par la maladie, presque aveugle, il nous disait peu avant de mourir: «Je m’amuse, je voudrais que cela n’eût pas de fin, tant je me divertis de mes souvenirs». Ce cher ami est mort il y a déjà quelque temps; pendant vingt-cinq ans, je l’ai entendu formuler des jugements sur tous les heureux et les dédaignés de l’art et de la littérature: nul ne s’est prouvé faux par la suite. Edmond Maître était le goût et l’intelligence mêmes. Si comprendre, c’est égaler, il fut à la fois un grand philosophe, un grand écrivain (et quelles lettres j’ai conservées de lui!), un grand peintre et un grand musicien.
De la rue de Seine, où il demeurait, il se rendait souvent chez Fantin, dont il prisait autant les idées originales que le talent; et celui-ci avait beaucoup profité des conversations si variées, si solides, comme des vastes lectures d’Edmond Maître, son voisin discret et son bibliothécaire. Grâce à sa femme et à son ami, Fantin vivait dans une atmosphère d’active intellectualité, nécessaire pour combattre l’assoupissement d’une maison de province en plein Paris, de plus en plus cadenassée par une croissante terreur du dehors. Pendant les dix dernières années, Fantin ne pouvait se décider à aller entendre, au théâtre ou au concert, les chefs-d’œuvre auxquels il était le plus sensible, et je me rappelle que, lors d’une reprise des Troyens, place du Châtelet, malgré son désir de voir un opéra qu’il chérissait entre tous, il ne se décida pas à traverser la Seine pour s’y rendre. Le froid, la chaleur, la foule, tout le troublait, dans la perspective de cette sortie inusitée.
Il ne connut donc ses ouvrages favoris que par la lecture, ou par des reproductions, si c’étaient des œuvres plastiques. L’Italie était trop loin, le chemin de fer trop inquiétant pour qu’il fît le voyage. A part Londres et [p. 38] Bayreuth,—où il était allé jeune encore, en 1875, pour l’Inauguration,—Fantin s’était résigné à ne rien voir de ce à quoi il songeait sans cesse, de ce qui stimulait sa production quotidienne. Les petites toiles qu’il empâtait, grattait, glaçait au médium Roberson, étagées par deux et trois, l’une au-dessus de l’autre sur son chevalet, sont comme les dialogues tenus par Fantin avec ses auteurs préférés. Il finit par prendre un tel goût pour cette douce occupation de dilettante solitaire, qu’à la longue il se persuada qu’il y mettait le plus de lui-même, et renonça à tout autre travail. Obstiné comme il était, ayant la sensation d’une sorte de réserve du public et des artistes quant à ses œuvres d’imagination pure, il se rebiffa et ne consentit plus à rien exposer qui fût peint d’après nature. Il donna un double tour de clef à sa porte, et se claquemura dans une sorte d’in pace qu’animait seule la venue du marchand de tableaux Templaere et des habitués du lundi soir.
Ce soir-là, de tradition, était consacré à un cercle de fidèles, pour qui Fantin sortait lui-même commander un bon plat ou un de ces gâteaux dont il était friand, quoiqu’il les redoutât d’ailleurs. Ces réunions hebdomadaires devaient avoir une belle tenue et un ton charmant de noble confiance réciproque. Edmond Maître me racontait les rites invariablement pratiqués dans la petite chapelle, et je me souviens du rôle muet de deux dames qu’il y rencontra pendant vingt ans, une fois par semaine, qu’il reconduisit régulièrement à leur omnibus vers neuf heures et demie et dont, par discrétion, il ne demanda jamais ni le nom ni la condition. Fantin remettait à l’une d’elles le journal le Temps, au moyen duquel il prenait un joli soin de distraire la respectable femme, tandis que s’établissaient autour de la table de graves conversations. Le critique de ce «quotidien» officiel ne se permettait pas alors de mettre à la portée des professeurs et des notaires de province les découvertes de Cézanne et des jeunes génies qui essaiment au Salon [p. 39] d’automne; car Fantin eût déchiré le journal, lui dont les préférences esthétiques étaient de plus en plus retardataires, à mesure que sa politique devenait plus avancée. Pauvre homme! S’il eût pu voir, lire et entendre ce que chacun admet maintenant, dans une marée montante d’anarchie, d’ignorance et de grossièreté à la Homais, peut-être eût-il regretté d’avoir tendu sa main (en pensée, car en fait il la gardait jalousement par devers lui), de l’avoir offerte même à de futurs ennemis de ses goûts.
Il disparut à temps. Je crois que l’avenir le plus immédiat lui eût réservé des sujets d’amère réflexion. Son succès auprès des plus «avancés» reposait sur une sorte de malentendu: c’était une de ces positions fausses que l’on s’efforce de ne pas s’avouer à soi-même, mais dont une nature sensible finit par être incommodée. Très dangereuse est la situation de ceux qui ne sont pas «tout d’une pièce». Fantin était, par essence, comme nous l’avons montré, bourgeois, fonctionnaire, ami des médailles et de la hiérarchie; il entrevoyait le ruban rouge et les croix comme un but naturel à poursuivre, comme une preuve agréable à recevoir de ses propres mérites reconnus en haut lieu. S’il était possible d’entrer à l’Institut tout en raillant certains de ses membres, Fantin eût tenu à honneur d’en faire partie: l’épée qui bat les pans d’un uniforme pacifique lui parut toujours une arme appropriée pour un peintre, dût-il, en marchant, s’y embarrasser les jambes. Le courage lui aurait manqué pour braver tels amis politiques, en avouant que le Palais Mazarin n’est pas un lieu à dédaigner. Par une disposition essentiellement française de son esprit, la raillerie du maître s’exerçait sur les objets auxquels il tenait le plus. C’est ainsi que ce Parisien de Paris, attaché à tout ce qui était français, nous rabaissait plutôt, au profit de nos voisins, lui qui eût tant souffert de voir son quartier envahi par les étrangers et nos coutumes abolies. La souplesse et les contradictions de son tempérament si singulier, réjouissaient ceux qui le connaissaient à fond, [p. 40] mais le rendait impraticable à tous les autres. Alors qu’on croyait l’avoir avec soi, il se dérobait soudain, par une subite contradiction. Il réunissait en lui-même les traits de deux personnes destinées à ne jamais s’accorder entre elles.
Vers le mois de juin, les émotions du Salon dissipées, une voiture à galerie venait prendre dans la rue des Beaux-Arts les malles et les menus bagages de la famille Fantin. C’était le départ pour la campagne, pour ce village bas-normand où l’artiste possédait une maisonnette dans un jardinet aux fleurs classiques, sujets de ses plus parfaits chefs-d’œuvre. Imaginons les bonnes journées de travail fertile et aisé, dans quelque chambre dont la fenêtre ouverte laisse entrer les bruits distincts et isolés, mais non importuns, de la route ou du bourg:—gamin chantant au sortir de l’école, heurts d’une charrette lourdement ferrée, gloussements du poulailler, mugissement de quelque vache—échos que répercute le haut mur de silex hérissé de ravenelles et de scolopendres.—Le Maître, sous un vieux chapeau de paille, le cou enveloppé d’un foulard d’été, chaussé de pantoufles, dès après son petit déjeuner, va cueillir dans les plates-bandes ce que la nuit a fait éclore de plus coloré, de plus odorant. Il pose sur le coin d’un meuble de chêne, devant un carton gris qui servira de fond, un de ces récipients de verre simples et commodes que Mrs. Edwin Edwards lui envoie de Londres et qui sont établis sur les plans ingénieux de certaine monomane de jardinage et différents selon la tige et le feuillage; avec mille soins, après de graves conciliabules en ménage, on fait un choix dans la récolte florale. Les délices d’une bonne séance vont être savourées, en dépit des mouches [p. 42] importunes, de la chaleur et de cette sonnerie, là-haut, dans le clocher de l’église, qui divise l’heure en quatre et fait couler la journée plus vite. La palette a été préparée et elle est déjà, à elle seule, un bouquet aux tons composés,—aux bleus tendres, aux lilas exquis, aux jaunes roses ou beurre frais, s’entourant de bruns fauves, de tous les rouges et de noirs:—une mosaïque d’Orient en pâte huileuse dont il suffira de déranger la symétrie et de l’ordonner autrement sur la toile, pour faire un miracle de justesse et d’éclat.
Fantin est très méticuleux et la préparation de sa palette est longue. C’est un moucheté de petits tas de couleurs: la palette de Delacroix, mais enrichie de beaucoup d’éléments nouveaux.
Parfois, jadis, et toujours dans les dernières années de sa vie, il enduisait sa toile, à l’avance, d’un ton gris, mince, transparent, qui servait de fond, invariablement. C’est ainsi que certains bouquets, si ce n’était l’air qui circule autour d’eux, on les dirait exécutés comme ces ornements en pyrogravure sur une table, ou une boîte, dont le bois reste apparent. J’en connais même parmi les moins bons, qui ont, un peu trop, l’aspect plaqué des modèles d’aquarelle pour jeunes pensionnaires, en dépit de leur savante anatomie. D’autres fois, il gratte le fond avec son canif, comme pour suggérer le treillis, le tremblé, la buée mouvante de l’atmosphère; et cela allège la matière sans rien enlever à la précision du contour qu’amollirait le contact de deux pâtes humides se pénétrant l’une dans l’autre. Donc, sans estompage ni «bavochures», c’est une épaisseur de pâte plus ou moins grande, selon que la chair de la fleur est veloutée, soyeuse, pelucheuse ou lisse, métallique ou fine comme de la baudruche.
Chaque fleur a sa carnation, sa peau, son grain, son métal ou son tissu. Les lis, secs, cassants et glacés comme l’hostie, avec des pistils en safran, comportent un autre rendu que les cheveux de Vénus, les pavots et les roses [p. 43] trémières, minces et plissées comme certain papier à abat-jour; le dahlia, qui est un pompon, le phlox neigeux ou pourpre, la capucine taillée dans le plus somptueux velours, comme le géranium, la gueule-de-loup ou la pensée, ne sauraient être modelés de même que le coupant glaïeul, le bégonia ou l’aster. Les fleurs sont tour à tour des papillons, des étoiles de mer, des lèvres ou des joues de femmes, de la neige, de la poussière ou des bonbons, des bijoux émaillés, du verre translucide ou de la soie floche.
Fantin aima surtout celles des vieux jardins de curé, les touchantes petites créatures qui poussent sans trop de soins dans les parterres entourés de buis. Je ne crois pas qu’il ait portraituré les pivoines ou les nouveaux chrysanthèmes de verre filé, qui ne savent où arrêter les prétentions de leurs encombrants falbalas. Il s’intéressa autant aux petites clochettes qu’à l’élégant œillet. Dans sa jeunesse, il avait parfois amoncelé et serré dans un vaste pot blanc, sur un fond de sombre muraille, des bottes de fleurs, comme on grouperait des écheveaux de laine pour la joie des yeux; mais la plupart de ses études sont d’un seul genre de fleurs à la fois, afin, sans doute, d’en fouiller mieux le corps et l’âme, pour en donner une image plus individuelle. Et l’on se prend à supposer, en voyant ses tableaux de fleurs ou de fruits, ce qu’il aurait fait avec nos visages, si le modèle humain n’était pas si pressé, si incommodant aussi dans l’atelier qu’il envahit en conquérant.
Fantin a dû créer ses petits chefs-d’œuvre dans la joie tranquille des journées saines et unies, telles que l’été en offre de si savoureuses dans la campagne. Se mettre au travail de bon matin, sans crainte d’être dérangé par un visiteur indiscret ou d’avoir à lui donner quelque raison de le congédier, c’est la moitié du succès assuré, dans un genre d’ouvrage impossible à interrompre à cause des modèles changeants et éphémères que sont les fleurs. Laissons Fantin penché sur sa toile et analysant [p. 44] avec ardeur leurs moindres traits, dont l’expression change avec les heures du jour et qu’il convient de saisir au bon moment. Chaque sonnerie du clocher lui fait battre le cœur, de crainte qu’un pétale ne tombe, que des trous ne se creusent dans l’édifice chancelant qu’est un bouquet. Mais la pensée de Fantin se dédouble et, malgré son application à peindre, vagabonde: il se promène dans des musées lointains, chantonne du Schumann et se redit à lui-même certaines phrases de ses auteurs chéris.
L’expérience vous apprend à quel moment il sied de couper les fleurs, afin qu’elles restent plus longtemps sans se faner et il est plusieurs manières d’en prolonger la courte existence. Vous pouvez disposer un bouquet, en prenant garde de ménager des vides, où, une fois peintes les premières fleurs, vous en glisserez d’autres qui les encadreront. C’est tout un art, qui exige beaucoup d’habitude, d’adresse et de soins. Fantin, qui fit tant de tableaux de fleurs, devait avoir pour elles les mille attentions et la tendresse d’une demoiselle maniaque et sentimentale. Quel enivrement, à la dernière séance, quand la fin du jour approche, de retoucher l’œuvre entière et d’y mettre les vigueurs, les éclats décisifs, juste avant la minute où toutes ces belles chairs, hier encore palpitantes, ne vont plus former, flétries, qu’un charnier! C’est dans les roses que Fantin fut sans égal. La rose, si difficile de dessin, de modelé, de couleur, dans ses rouleaux, ses volutes, tour à tour tuyautée comme l’ornement d’un chapeau de modiste, ronde et lisse, encore bouton, ou telle qu’un sein de femme, personne ne la connut mieux que Fantin. Il lui confère une sorte de noblesse, à elle que tant de mauvaises aquarellistes ont banalisée et rendue insignifiante par des coloriages sur le vélin des écrins et des éventails. Il la baigne de lumière et d’air, retrouvant, à la pointe de son grattoir, la toile «absorbante», sous les épaisseurs de la couleur et ces vides qui sont les interstices par où la peinture respire.—Métier [p. 45] tout opposé à celui d’un Courbet, dont le couteau à palette pétrit la pâte, l’enfonce de force et lui donne la surface magnifique, polie et glacée de l’onyx et du marbre.
Dans ses tableaux de fleurs, le dessin de Fantin est beau, large et incisif. La fleur qu’il copie, il en donne la physionomie, c’est elle-même et non pas une autre, de la même tige: il dissèque, analyse, reconstruit la fleur, et ne se contente pas d’en communiquer l’impression par des taches vives, habilement juxtaposées. La forme peut être si éloquente à elle seule que, dans une lithographie très rare, dont je possède une épreuve, Fantin est parvenu avec du blanc ou du noir à faire deviner, dans le cornet de verre d’où elles s’élancent, toutes les couleurs d’une gerbe de roses. Comme cet art analytique et raisonné, encore que si frais, est de chez nous! Comme ces toiles sont bien d’un petit-fils de Chardin! C’est par elles que le bon bourgeois français Fantin-Latour s’est le plus complètement exprimé. Ici, nulle trace d’austérité ou de lourdeur allemande, mais la logique, la belle clarté de la langue du XVIIIe siècle.
La Tate Gallery renferme une toile des plus importantes par sa grandeur et la perfection du bouquet riche et varié qui s’y déploie. C’est peut-être là que le maître atteignit le plus haut degré de son talent et une pareille œuvre assure à son auteur une place enviable dans l’histoire de l’art contemporain: don de Mrs. Edwin Edwards, l’infatigable amie de Fantin, qui l’imposa à l’admiration de ses compatriotes, alors que personne, en France, ne savait qu’il peignît des fleurs.
Chaque automne, de retour à Paris, Fantin rassemblait ses travaux de l’été, et, après avoir comparé une à une ses études avec celles qu’il gardait accrochées à sa muraille,—choix de pièces parfaitement réussies,—il les posait à plat dans une caisse, les châssis retirés, et il les expédiait à Londres. Là, Mrs. Edwards les faisait encadrer, et conviait un public d’amateurs fidèles à les venir admirer. Pendant vingt ans, elles furent inconnues [p. 46] en France, Fantin ne se révélant à nous que par de rares portraits et les fantaisies qu’on avait pris l’habitude respectueuse de louer. On se demande, d’ailleurs, si les critiques n’étaient pas sincères, maintenant que nous assistons à une si incohérente explosion d’opinions contradictoires, chez les plus réputés d’entre eux. On peut tout faire admettre par un homme dont le métier est de juger un art qu’il n’a pas pratiqué. Les littérateurs se plaisaient à suivre Fantin rêvant en compagnie de Berlioz, Wagner, Schumann, ou se promenant en pleine mythologie, sans quitter la rue des Beaux-Arts, et pensaient reconnaître la fumée de sa familiale bouilloire à thé dans les ciels argentés de ses théophanies. Oui, certes, ces tableautins étaient bien de Fantin-Latour, par l’exécution, parfois aussi par la couleur; c’étaient les visions d’un romantique attardé, troublant les nuits de ce Parisien ardent et réservé. Ses nymphes et ses déesses, au galbe corrégien, ce sont de grosses ménagères, désirables, mais chastes, qui se montrent et ne s’offrent pas: apparitions de figures académiques groupées en «tableaux vivants» d’amateurs. Je ne dis pas que cette partie de l’œuvre de Fantin soit à dédaigner. Il est même de charmants morceaux dans cette série, la plus nombreuse en tout cas, et sa favorite: hélas! ce n’était pas ses esquisses qu’il envoyait aux expositions, mais des sortes de pièces d’apparat, fabriquées méthodiquement en vue des Champs-Elysées, et que l’Etat ou la Municipalité lui achetaient pour les musées.
L’Ecole des Beaux-Arts nous offrira bientôt une ample collection des ouvrages de Fantin-Latour. Il sera intéressant de connaître le jugement porté, deux ans après sa mort, sur l’honnête et délicat artiste qui opposa une si exacte discipline et un si beau culte de la tradition aux progrès de la folie et de l’orgueil déréglé.
Avril 1906.
De Forain, classé parmi les caricaturistes, les lecteurs de journaux, depuis si longtemps qu’il sème aux quatre coins de Paris la graine féconde de son esprit, n’ont retenu que des légendes dures, cinglantes, cocasses, ou gentilles et familières, commentées d’un rapide croquis dont le public ignore les rares vertus artistiques et la science. La concision de ce trait, grêle autrefois, aujourd’hui appuyé, large comme l’entaille d’une latte de fer, ne parle avec toute son autorité qu’aux amateurs initiés, qui aiment la ligne noire sur le papier blanc et tout ce que, ramassée sur une petite surface, elle y exprime de sentiments et de choses.
Hokousaï, «le vieillard fou de dessin», comme il s’appelait lui-même, presque centenaire, s’exerçait chaque jour et sans cesse à rendre le plus vite possible, dans un style alerte et précis, les aspects de la nature. Il pensait que, pût-il vivre plus longtemps encore, il parviendrait à la connaissance totale de la forme. M. J.-L. Forain, en cela pareil à ce Japonais, aura passé son existence à tracer des lignes sur des feuilles innombrables, qui s’entassèrent dans des ateliers successifs et dont l’amoncellement constituerait déjà une petite colline: un amas de documents vivants, notés d’une main nerveuse et comme toute moite de fièvre.
Puisse Forain, pour l’histoire et pour notre joie, poursuivre une carrière aussi longue que celle d’Hokousaï! mais peut-être ne ferait-il pas ce souhait pour lui-même, [p. 50] car malgré la curiosité qui anime ses yeux perçants, et la verve de sa parole, toujours jeune, je devine que l’avenir ne se présente pas à lui tel qu’il souhaitât d’en voir le lointain et mystérieux développement...
Il ne pourrait assister en spectateur amusé ou impartial à la transformation de la France, lente ou rapide—selon les périodes—, ayant, avec des idées désormais aussi arrêtées, des convictions aussi enracinées, des préjugés aussi irréductibles et forts que le caractère de son art, dans sa nouvelle manière tout au moins.
«Monsieur, les préjugés sont la force d’une société, dites?»—déclare M. Degas, le maître vénérable dont M. Forain enchante de sa gaminerie le farouche et hautain isolement.
Ces deux hommes, je me plais à rapprocher ici leurs noms qui, malgré la différence d’âge de chacun d’eux, seront sans doute indissolublement unis désormais. Depuis ses débuts, le cadet a voué à l’aîné une admiration et une amitié que l’autre lui rend avec un sourire de paternelle fierté. Forain doit beaucoup à M. Degas, comme artiste, et, si opposée l’une à l’autre que soit la tenue de chacun d’eux, leurs idées sont de même essence, ils sont tous deux des Français d’un type devenu rare, on pourrait simplement dire des Français.
Si, pour la plupart de ses fidèles, Forain est un simple caricaturiste, à la suite des Daumier, des Cham, des Gavarni, c’est à la publicité de ses planches hebdomadaires qu’il doit s’en prendre; car il est, à part et au-dessus de cela—et il tient à l’être—un peintre. Dessinateur puissant, coloriste tour à tour délicat ou fort, ses tableaux ont une valeur égale à celle de ses planches; elles sont de la peinture pure, comme on la concevait dans l’école dite de 1830, mais assaisonnée de toutes les épices les plus modernes. Il fut un des heureux de la pléiade des Impressionnistes. N’oublions pas qu’il eut la chance de combattre dans leurs rangs.
Je me rappelle le jeune peintre, déjà connu, que j’allai voir des premiers, entre ceux qui excitaient ma curiosité d’étudiant, il y a vingt-cinq ans, dans son atelier du faubourg Saint-Honoré, où des gens de sport, des «cercleux» et des jeunes femmes légères posaient tour à tour pour des compositions dont le décor était le pesage des courses, le pourtour des Folies-Bergère ou le foyer de la Danse. L’élégance de cette époque était rendue par lui d’un pinceau un peu sec, mais vue d’un œil perçant. Manet venait de mourir; M. Degas n’était connu que de quelques privilégiés; MM. Béraud, Duez, Gervex peignaient avec succès pour le public du Salon (il n’y en avait qu’un, alors!) les aspects du boulevard et du Bois, que le kodak n’avait pas encore vulgarisés. Forain était déjà apprécié comme croquiste et célèbre par son esprit. Il attirait surtout et retenait des modèles de bonne volonté, par sa conversation pétillante de mots à l’emporte-pièce, du genre que l’on nommait rosse. C’était un garçon mince, au visage souriant, anguleux, à l’œil incandescent; la barbe, qu’il portait encore, dissimulait ce pli amer de la bouche qui lui donne aujourd’hui un si singulier caractère, presque douloureux dans une face glabre d’Américain. Il n’avait pas l’apparence d’un peintre et soignait sa mise. La gaîté de son atelier du faubourg Saint-Honoré n’avait d’égale que celle de tous ses visiteurs. De charmantes études à l’huile ou au pastel étaient sur les chevalets, entourées de feuilles de croquis au [p. 52] crayon dont il se servait pour les bâtir, car il ne peignait jamais d’après nature et ne faisait poser que pour ses dessins. On se serait cru plutôt que chez un professionnel, chez un de ces nombreux amateurs qui commençaient alors à louer un atelier en guise de garçonnière et achetaient une boîte de couleurs comme des boîtes de cigarettes, de l’essence et de l’huile comme des liqueurs pour leurs hôtes.
Je vois encore l’Impasse, avec sa double rangée, à droite et à gauche, d’ateliers dont les portes, dès avril, s’ouvraient pour les bavardages des voisins, les allées et venues de tout un petit peuple d’oisifs. Un jour, c’était le commissionnaire, son crochet à terre, qui attendait dans la cour, en écoutant la vague musique d’Olivier Métra, moulue par un orgue de barbarie. M. Forain n’était pas prêt et retouchait son envoi au Salon qu’il fallait porter avant le coucher du soleil, au Palais de l’Industrie, dans un encombrement de tapissières et de brancards chargés d’œuvres d’art encore mouillées, interminable file interrompant la circulation aux Champs-Elysées: c’était l’annonce du Printemps, des déjeuners chez Ledoyen et des samedis du Cirque d’Été, charmant émoi!
Je me rappelle si bien «le Buffet» que Forain allait signer quand j’entrai chez lui vers cinq heures. Il était entouré de voisins et de curieux, qui avaient engagé des paris sur l’achèvement problématique d’une toile pour laquelle on espérait une place sur la cimaise, une récompense peut-être—une mention honorable tout au moins. Ce «Buffet» dressé dans une salle à manger moderne est assiégé par des danseuses en tulle rose et blanc à épaulettes remontées, comme des sacs à bonbons, d’où sortent des bras décharnés et des clavicules plates; des mamans apoplectiques, sous les piquets de plumes de leur coiffure, surveillent les cavaliers en «sifflet» noir, le chapeau «claque» à la main; et jaunis par la flamme des candélabres, les maîtres d’hôtel, espèces de [p. 53] croque-morts solennels, servent des tasses de thé et des sandwichs.
Voici un autre tableau de la même période, le Veuf. Un homme tout en noir, émacié, désolé, fouille dans les dentelles et les menus objets de la femme dont il porte le deuil, encore inaccoutumé au vide de la chambre où il a aimé. Je n’ai pas revu depuis lors cette toile, qui m’avait tant frappé. Il me semble que de beaux noirs mats appuyaient toute une symphonie de roses et de bleus tendres. Forain, alors, déchiquetait de petites touches allongées, dans une pâte semblable à celle que Berthe Morisot et Eva Gonzalès tenaient de leur maître Manet, mais plus grêles.
Il n’était pas encore sûr de son métier de peintre; son impressionnisme hésitait à prendre un parti; l’agrément de sa vie à Paris le ramenait vers des gens faciles, qui le poussaient à la production négligente et amusée du faiseur de croquis.
D’ailleurs, la peinture n’était encore pour Forain qu’un exercice assez exceptionnel auquel il semblait préférer le pastel et l’aquarelle.
On aimerait à retrouver parmi ses rares portraits peints celui de notre ami Paul Hervieu, effarante image lunaire, tourmentée, du jeune diplomate d’alors, forgeant à sa table d’écrivain les belles phrases coupantes de Diogène le chien.
Il me semble qu’il y avait dans ce portrait un peu de cette férocité caricaturale et de cette exagération malveillante que je retrouve dans une silhouette de moi-même ou de quelqu’un qui, m’assure-t-on, fut moi, vêtu comme un entraîneur, les jambes écartées, énormément gras et antipathique, cravaté de rose, sur un fond vert de laitue.
Ses pastels féminins voulaient être plus amènes. De Mme Bob Walter, il fit un grand portrait dans un costume Pompadour, robe de taffetas gris tourterelle, d’un joli [p. 54] mouvement désinvolte et affecté, mièvre sur la draperie flottante, qui cache un coin de ciel mauve. Cependant l’ossature carrée du visage et les minces lèvres pincées attestaient le satiriste. Forain n’était rien moins qu’un courtisan. S’il avait déjà une certaine curiosité des personnes titrées, des élégants et des fêtards, dont il était recherché, son âme ardente et sèche, son œil implacable, son esprit de gamin, né au cœur d’un quartier populeux, réservaient à ses compagnons de plaisir, à ses amphitryons un remerciement redoutable—sinon haineux—un jugement implacable.
Un des traits significatifs de Forain, dans la première partie de son œuvre, c’est l’allongement des pauvres corps efflanqués, d’un type tout particulier de dégénérés. Ses «gommeux», ses misérables filles d’opéra montrent des anatomies grêles, comme rentrées, des mines de rachitiques. Les hommes ont de longs nez minces, comme des becs d’oiseau de proie, le dos voûté, des bras de pantins, la moustache tombante en stalactites. Ses petites femmes sont construites comme les poupées-Jeannette. Leur chair, fardée et séchée par la poudre et le rouge, est bien du temps où les disciples de Médan s’exaltaient en décrivant les maisons Tellier et les Lucie Pellegrin. J.-K. Huysmans demandait à Forain des pointes sèches pour illustrer Marthe et Croquis parisiens; des Esseintes rêvait des sévices subis dans l’atmosphère factice d’une perversité macabre et artiste par de phtisiques «pierreuses». On tenait Félicien Rops pour un homme de génie, le morbide et le satanique étaient à la mode. L’art de Forain, déjà fin et original, s’il nous intéressait, n’était point ce qu’il est devenu longtemps après.
Si l’on reprend les anciens albums de Forain, on est étonné de voir le chemin parcouru depuis ses essais du début jusqu’au P’sst...! L’atmosphère de dissipation et de fête qu’ont tous, plus ou moins, respirée les peintres, vers 1880, explique dans une certaine mesure [p. 55] la légèreté, le hâtif, le tremblé d’un art purement parisien, qui devait éclore entre l’avenue de Villiers et la Cascade de Longchamps. Heureuse et facile époque pour celui qui tient une palette et se contente de copier, en se jouant, la société fringante qui s’agite sous ses yeux amusés, dans la rue, au théâtre, au bar. Les tableaux de chevalet sont demandés partout, la peinture se vend, pourvu que l’exécution soit propre et aisée. Heilbuth dresse de petites figures de femmes dans des jardins de villas, sur les terrasses de Saint-Germain. Duez fait courir des pêcheuses de moules, vêtues de rose, dans les roches noires de Trouville. Gustave Jacquet, joli exécutant, adapte le XVIIIe siècle à notre goût en des toiles qui vous étonneront plus tard, si jamais elles reviennent d’Amérique. On applaudit Gervex pour son portrait de Valtesse, le Rolla, le Retour du Bal, d’une soyeuse matière qu’admire Alfred Stevens, lui, l’égal des grands-petits maîtres hollandais et le connaisseur impeccable. James Tissot, encore réfugié à Londres, est en plein triomphe et reçoit dans sa maison de Saint-John’s Wood les jeunes gens, Helleu, Sargent et tant d’autres que surprend son invention. Partout, les peintres sont rois, ils gagnent de l’argent et construisent des hôtels prétentieux dans la plaine Monceau. Boldini, prestigieux dessinateur et coloriste exquis, accumule de menus panneaux où la vie de Montmartre, le mouvement de la place Pigalle, sont rendus dans un brio dont Degas et Manet ont été enthousiasmés. Le talent est apprécié, on voit rendre justice aux uns et aux autres, sans préoccupations théoriques et sociales. Forain, dans cette atmosphère capiteuse d’une sorte de régénérescence, dix ans après la guerre, est un spirituel et caustique spectateur, qui va partout projeter le rayon de sa lanterne sourde, familier avec les difficultés matérielles et les tristes horreurs de la capitale, admis dans un milieu de luxe et de plaisir où il n’apporte pas le snobisme subjugué d’un romancier en vogue, mais l’attention d’un chasseur aux aguets. [p. 56] Son travail est surtout fait d’observation, et s’il dépose de légers croquis sur le moindre bout de papier qui tombe sous sa main, il regarde les hommes, comme il a regardé, en flânant dans le Louvre, les Maîtres: avec perspicacité. Point de tendresse, point de commisération; il juge.
Jean-Louis est le cadet de tous les peintres renommés, entre lesquels il erre encore, les mains dans les poches, ricanant, plus apprécié pour les mots qu’il lance partout que pour ses œuvres mêmes.
Charpentier crée «la Vie Moderne», journal illustré auquel collaborent tous les écrivains dont il est l’éditeur et l’ami. Forain y croque de petits culs-de-lampe, d’une fantaisie un peu japonaise, à côté de Rochegrosse, alors enfant prodige. On trouve de ses dessins partout, ils traînent chez tous les marchands.
Classé, à cette heure-là, parmi les derniers venus de l’impressionnisme, il évite de préciser le trait, redoute l’habileté vertigineuse que le public réclame de ses fournisseurs attitrés. Il se range parmi les «avancés», mais avec nonchalance encore et espièglerie. Les soirs et les nuits sont plus longs que le jour. Entre un réveil las, un déjeuner où l’on s’attarde à bavarder au restaurant et la fin d’un après-midi qui vous ramène vers les Acacias en été, vers le café Américain en hiver, il n’a pas le temps de parfaire un ouvrage bien approfondi. Ses aquarelles, ses notations de mouvement et d’effets sont rapides et sommaires. Il n’appuie pas. Et les motifs reviennent, toujours ou à peu près les mêmes, pris entre la Bourse, l’Opéra et l’avenue du Bois. C’est alors le triomphe des ballets italiens à l’Eden et des Skating-rinks, dans un Paris déjà loin de nous, plus petite ville, où l’on entend moins parler de langues étrangères, où l’on se sent plus chez soi.
Si Forain s’en était tenu là, il serait resté au second plan dans une génération de peintres qu’adulait un public disposé à tout accepter, pourvu qu’il n’y eût pas d’effort [p. 57] de compréhension à faire, en face d’une œuvre d’Art. Comment expliquer que, sans rien changer à ses habitudes et de plus en plus répandu dans les sociétés qui souvent accaparent et détruisent un peintre, Jean-Louis ait sans cesse développé ses talents jusqu’à conquérir la maîtrise, par un exercice quotidien et ininterrompu de son crayon? Il n’est pas rare de voir un homme fort s’ignorer jusqu’à quarante ans, rester obscur et méconnu, puis enfin s’imposer sur le tard par l’autorité de son cerveau et de sa main,—mais ce n’était pas le cas de notre ami et personne, dans son entourage, ne prévoyait que le même Paris de toutes les frivolités, dont il est le favori et le produit—que Paris lui apprêtait des crises morales d’où surgissait un grand artiste.
Un jour, M. Jules Roques, le directeur du Courrier Français, à qui Forain donnait parfois des pages de dessins, lui demanda d’en souligner le sens par une légende. Heureuse idée à quoi nous sommes redevables de toute une série d’études de mœurs réunies par différents éditeurs, en albums qui s’appellent la Comédie Parisienne (première et seconde série), Nous, Vous, Eux, Album Forain, Album, Doux Pays, les Temps difficiles (Panama). Alternativement, dans un supplément du Journal, dans l’Echo de Paris, et surtout dans le Figaro, ce furent d’incessantes trouvailles de philosophie, d’ironie amère, simple et bon enfant tour à tour, où les différents aspects de notre vie étaient éclairés d’un vif rayon lumineux, commentés par l’esprit le plus direct, le plus férocement français. La moitié de ces «légendes» sont incompréhensibles pour un étranger, étant aussi gauloises que celles du grand Charles Keene, du Punch, sont britanniques. Le Fifre et le P’sst...! deux journaux qui n’eurent qu’un nombre restreint de numéros et où le texte du dessinateur fut parfois assez abondant, furent son propre et très personnel domaine, quoique Caran d’Ache y ait aussi, pendant une période, collaboré.
Passant en revue la collection complète des dessins à légende, on est frappé par une admirable variété d’inspiration et de technique. Forain, qui connaît son Paris du haut jusqu’en bas, n’est point de ceux qui, étroitement, se cantonnent dans un milieu, par snobisme, ne voulant regarder que les «gens du monde» ou, [p. 59] selon une mode récente, le «peuple». Il n’est pas dupe de ces catégorisations absurdes, qui prouvent la pauvreté intellectuelle de ceux qui les établissent, admirateurs ou contempteurs, envieux, flatteurs ou borgnes, comme blessés par la vue de ce qui n’est pas leur classe, et affectent de mépriser ce qu’ils croient situé au-dessus ou au-dessous d’eux.
Son jugement sur les événements et les gens est celui d’un enfant de Paris, d’un rang social et d’un temps où l’éducation, donnée sans passion anticléricale, fait les cerveaux plus libres et plus personnels dans leurs manifestations. La politique le laisse assez incertain. Un album daté de 1894, Doux Pays, peut passer pour une œuvre de parti; mais la morale qu’on en tirerait est celle d’un flâneur dans la rue, qui, se promenant le nez en l’air, marque les coups, sans indignation, diverti plutôt. Pendant la période du boulangisme, il reste sceptique et attend, amusé, les événements. On se rappelle le dessin qui presse des danseuses autour du trou percé dans le rideau de la scène; l’une dit, en parlant du général, frissonnante de l’incompréhensible émotion que secouait alors un nom magique: Il est dans la salle!—L’Œillet de l’absent, lors de la fuite de Boulanger, est une page célèbre.
Forain n’est pas un idéologue, un rêveur, ni un théoricien. Sa déjà longue expérience lui fait mettre dans la bouche des invités à l’Elysée, voyant s’avancer une quinquagénaire épaissie, qui est la République, avec son bonnet phrygien: Et dire qu’elle était si belle sous l’Empire!... exclamation où il y a à peine une petite déception de gens qui n’ont jamais espéré grand’chose: honnêtes gens un peu dégoûtés, au moment de Panama, mais incrédules et résignés. Sous Carnot comprend des satires du péril anarchique, qui, n’en étant qu’aux bombes, ne semblait pas bien menaçant au boulevardier. Papa, ne te trompe pas pour ta bombe: 201 C5, K0, C6, H3, AZ02, 30, dit la petite fille gentille et proprette à [p. 60] son papa, qui réfléchit et répond: Bien! avec de l’acide sulfurique et du savon noir... ça ira! Il blague la terreur «des riches».
Juré lors du procès des auteurs d’attentats, le père revient en retard du Palais de Justice, sa femme et sa fille se sont levées de table pour le recevoir, inquiètes: On ne t’attendait plus pour dîner.—Il s’agit bien de cela, je viens de faire mon devoir... Maintenant vite les malles... filons!
Il gouaille les familles des «chéquards», le député satisfait et glorieux, le parvenu, celui qui, s’adressant à une famille de hères, assis sur un talus le long de la route, descendu de son coupé à deux chevaux, pour solliciter la voix de ses électeurs, insinue: Vos besoins sont les miens, vos aspirations sont les miennes! Je sais que vous ne voulez pas d’une Constitution calquée sur l’Orléanisme...
Forain se contente de hausser les épaules: geste le plus raisonnable qu’un être avisé se permette en regardant devant lui. S’il y a quelque âpreté dans son ironie, c’est celle du vieux Français, de tempérament toujours un peu cruel et batailleur.
A l’adresse des habiles et des utopistes, qui promettent à la foule des miséreux l’entrée prochaine dans une sorte d’Eden terrestre, pour les détourner de la réalité: «Mais, monsieur le député, Charles X a dit tout cela à mon père...»—Les élections municipales.—L’éloquence parlementaire.—Les nouveaux ministres: «Vétéran de la démocratie, je viens humblement, monsieur le ministre, solliciter...»
Sous Casimir-Périer. Une gentille petite République console un rude travailleur, mécontent: «Que veux-tu que j’t’dise?... C’est fait. Mais avoue toi-même que Brisson n’aurait pas été rigolo». La même dit au président Périer: «J’ai eu très peur, on m’avait dit que vous étiez du Jockey-Club».
[p. 61] «Le panmuflisme», écrit Forain, dégoûté de certaines bêtises... puis il passe. Dans cette série de Doux Pays (décembre 1894), nous entendîmes un premier écho de l’affaire Dreyfus. C’est un Alsacien à la frontière, qui, avec ses deux bébés, regarde arriver des militaires français; il leur crie: «Bravo!»
Sous Félix Faure. Le président dit à son valet de chambre: «Allez me chercher le tailleur de M. Carnot». Sur le retour de Rochefort: des gardiens de la paix, maintenant une foule grelottante, présentent de gros bouquets pour l’écrivain populaire. «Parlez plus bas, monsieur le député: mes hommes ne votent pas».
«Mon cher ministre, un électeur a été provoqué par la vue d’un prêtre en uniforme. Aussi, comme le député est vénérable de notre loge, je vous demande les palmes pour ce courageux citoyen».
Le grenier de la mairie du Havre: des bustes de Louis-Philippe, Napoléon III, Thiers, au milieu de souliers éculés et de vieilles culottes. «Tout passe, tout lasse, tout casse!» Les fêtes de Kiel, juin 1895: la jeune République, dans un manteau qui est la carte de France, montre de son éventail d’invitée la flotte allemande: «Quel toupet de m’envoyer là avec un manteau déchiré!»
Madagascar: Forain partage l’émotion du peuple, déshabitué des tueries: «Cette pièce ne nous regarde pas. Nous sommes pour les décès», dit un planton du ministère de la Guerre à un pauvre diable d’ouvrier qui vient réclamer pour son fils, parti là-bas.
Le ministère Berthelot: «Ma potion n’est pas prête?—Vous ne voudriez pas, mon mari vient d’être nommé ambassadeur!» et c’est la femme du pharmacien qui répond cela au client. La Veille des fêtes russes. Après les fêtes russes, les Prêtres à la Chambre, le Cercle des études sociales à Carmaux: partout, toujours, c’est une plaisanterie dans le goût populaire, sans autre allure que celle du bon sens et du scepticisme.
[p. 62] Forain est né dans le peuple, le connaît mieux que certains de nos sociologues de profession, l’aime, pense avec lui, l’incarne dans sa gouaillerie nette, son bon sens, son amour pour ce qui brille ou résonne, clairon ou tambour. Confiant et crédule, il s’amuse aux spectacles à quoi, fût-ce de loin, il prend part. Voici l’ouvrier avec sa femme riante à son bras, qui regarde par les fenêtres du café Anglais et dit gentiment en passant: «M...de! ma table est prise!»—Forain sait, en de semblables circonstances, qui ne diffèrent que d’apparence selon les degrés sociaux, ce qu’un sportman, un travailleur, un boursier ou un artiste, peintre ou acteur, penseront, le geste que tel sentiment déclenchera et le tour que prendra l’exclamation de plaisir ou de dépit chez chacun d’eux. Tout cela est d’une justesse de ton, d’une pénétration admirables.
Il n’a pas, comme le pimpant, mais plus restreint Willette, un seul type de femme, qui serait la «petite femme de Forain». Les caractères de son théâtre sont infiniment nombreux, son répertoire est riche, vaste. On voit la femme grasse et la femme maigre «de la société», la demi-mondaine, la fille d’opéra ou des boulevards extérieurs, concierges et modistes, toutes pourvues d’une philosophie imputable à l’égoïsme et à la lâcheté de «l’homme». Les relations de fille à mère, les frustes dialogues quotidiens du ménage, sans vergogne et goguenards: «Dis donc, maman, tu sais, n’t’épate pas... Prends mon Chypre! Qu’est-ce qui va me rester? Ton Bully?» Ou cette opulente dame en robe de bal, à sa jolie demoiselle, affalée sur la chaise dorée de Belloir: «Je vois bien que, si nous ne nous en mêlons pas, ton père va encore rester sous-chef!» On devine le pauvre employé, qui s’habille dans la pièce à côté, fatigué de passer la nuit au ministère, où il se serait si bien dispensé de revenir, sa journée finie, en cravate blanche. C’est encore la tendresse maternelle de la pipelette obèse, qui, le balai à son côté, dit à l’énorme protecteur de sa Nini, toute frêle, se peignant [p. 63] en chemise: «Ah! monsieur le comte, jusqu’à quelle heure avez-vous gâté notre Nini? La voilà qui rate encore son Conservatoire!»
On aime cette dame à face à main, qui, entrant dans la chambre de son fils et faisant sortir du lit toute confuse la gentille servante descendue d’un étage, en camarade, établit ainsi les rapports réciproques des habitants de la maison: «Ça, c’est trop fort, faire des orgies chez mon fils et mettre, par-dessus le marché, une chemise à ma fille!... pourquoi pas mes bijoux?...» La petite bourgeoisie, celle de Mme Cardinal et celle de plus bas encore, n’ont pas de secrets pour Forain. Il en sent le comique modérément gai, les misères dont une longue habitude atténue la douleur, la légèreté qui sèche vite les larmes, l’ironie surtout, l’ironie peuple et française, l’esprit, l’extraordinaire drôlerie et la logique. Une immonde créature, enroulant sa nudité dans un sale peignoir, dit à un serrurier, la musette en bandoulière et les poings dans les poches: «C’qu’c’est que la veine! T’aurais moins aimé boire, que j’s’rais ta femme!...»
La naïveté dans le cynisme des hommes vis-à-vis de «la fille», l’égoïsme du désir, sont prodigieusement éloquents sous le crayon de Forain. Le passant arrêté devant une boutique de modiste et qui s’écrie en voyant un bras maigre prendre un chapeau dans l’étalage: «...Ce soir je vais me coûter un peu cher!» n’est-ce pas le pendant charmant du: «Et tu ne me disais pas que tu étais si bien faite!» soupiré par un pauvre diable de demi-vieillard cassé à une plantureuse drôlesse dont les chairs indécemment rebondies font craquer le corsage. Chacun se rappelle la tragique image de la femme remontant son escalier, bougeoir à la main, et suivie de l’inconnu au visage de bull-dog qui, le col relevé et effrayant de concupiscence, suit l’infortunée dans le silence et l’obscurité d’une maison louche. Pourtant, même dans son métier périlleux, la Parisienne reste gouailleuse et résignée. Un joli croquis nous la montre ragrafant [p. 64] son corset, et gémit: «Voilà huit fois que je le quitte depuis le dîner... ça me rappelle l’Exposition!...» Voilà tout.
Forain a trop de goût et pas assez de tendresse pour s’attendrir à la façon de Willette et des chansonniers de Montmartre. La note sentimentale et un peu sotte, parfois touchante, d’un Delmet, la larme brève, il les bannit, comme aussi toute menace et toute revendication rouge des dramatisants de l’Assiette au beurre. Son intelligence sèche, haute et fine se plaît partout dans la seule ville qu’il connaisse, et s’il a un goût marqué pour le linge propre et les jolies façons, il ne se sent pas déplacé et ne se montre supérieur dans aucun bas-fond. Sa supériorité est ailleurs, il ne l’affiche pas, mais la porte en dedans de lui-même. Il n’est pas de ceux qui plantent la rosette de leur décoration dans la boutonnière de leur pardessus, afin que nul n’en ignore.
On voudrait pouvoir étudier chacune de ses mille compositions, venues au jour le jour au bout de son crayon pendant ces dix ans où il s’est inspiré, pour les journaux qui le lui demandaient, de tant de circonstances de la vie parisienne. Notons sa série des M’as-tu-vu? où s’étale la misère du cabotin glorieux et humble, la galanterie élégante du foyer de la danse et le marchandage crapuleux des boulevards extérieurs, les courses, l’adultère, les affaires, la Bourse. Mais il est malaisé de faire un choix parmi l’éblouissante collection de ces planches, légères tour à tour et profondes, alertes, rieuses ou tragiques, qui surmontent une phrase souvent lapidaire, drôle, juste, humaine, dont la forme raccourcie et définitive est inoubliable.
«Maria, vite de l’eau de mélisse et un sapin!»—«Comment, t’es peintre!!» triste réveil dans un lit au milieu d’un atelier misérable. «Tu n’vas pas encore dire qu’ c’est l’émotion.»—«Fiez-vous donc à l’accent anglais.»—«Alors, madame ne rentre pas dîner?...»—«Madame n’oublie pas son tire-bouton?...»—«Ah! [p. 65] c’est votre mari? Eh bien, vous pouvez le r’prendre, y me donne plus de mal que trois enfants!»—«Qu’est-ce qu’y t’a dit?—Ne m’en parle pas, ils demandent tous des Bouguereau.»—Et c’est l’artiste accablé, revenant avec ses toiles de la rue Laffitte, qui n’en veut pas, et c’est l’accueil, le geste exquis de la maman du joli bébé occupé à jouer dans un coin de l’atelier sans feu.
Entre toutes les figures qui reviennent à cette époque dans les dessins de la Comédie Parisienne, Forain, encore souriant, comparé à ce qu’il devint ensuite, silhouette déjà un personnage qui est nouveau dans la caricature française, c’est le financier étranger, l’homme satisfait et lourd, le jouisseur. Nous retrouvons dans nos souvenirs, l’apparition de ce type, son entrée aimable, empressée, encourageante, dans le monde où il sera le Mécène, l’Amphitryon jamais lassé, le camarade de tous ceux qui voudront bien échanger, contre ses politesses, l’autorité de leur nom et se dire ses amis. Nous entendons l’accent appuyé de cet homme venu de Francfort, de Vienne ou de plus loin, s’établir dans la capitale, sous la protection de la République libérale et accueillante. Forain fait surtout parler le snob, l’abonné de l’Académie nationale de musique et de danse, le dîneur du café Anglais, propriétaire d’un bel hôtel aux Champs-Elysées, collectionneur, l’amateur de jolies femmes et de rares objets qu’il achète à coups de billets de banque. Nous entendons la voix chaude et câline qui dit à un jeune niais montrant son épingle assez rare, en lapis:—«Je sais, je sais, j’ai une cheminée comme ça!»—Il ne manque à cette légende que l’orthographe phonétique adoptée par Balzac, quand il met en scène le vieux Nucingen.
C’est encore: «Qu’appelez-vous chaud-froid Vladimir?—Mon Dieu, monsieur le comte, c’est une bécassine dans sa glace, avec un peu de piment sur canapé.»
Ou le dernier acte de Faust, quand Marguerite revient en robe de prisonnière; l’abonné se lève et crie: «...et les bijoux?» C’est un profil oriental, mi-indien, mi-ottoman, [p. 66] que le satiriste orne d’un nez charnu, partant d’un crâne fuyant et dominant une bouche lippue, ligne courbe presque d’une tête de bélier, avec des poils frisés, sans âge précis. «Un habit noir», le gardénia à la boutonnière, se carre dans la loge d’une «artiste». Elle dit à son habilleuse: «Est-ce pas, Juliette, que jamais personne ne donnerait quarante ans à c’t’homme-là?» Forain ne flagelle pas encore. Il ricane et «blague» en gamin le Zola candidat à l’Académie, aminci, en correct veston, ou faisant sa prière, entouré des anges du Rêve.
Malgré tout le charme et le piquant de la plupart de ces compositions, on ne peut dire aujourd’hui, sachant les chefs-d’œuvre qui suivirent, que la qualité de sa forme fût vraiment belle alors. Parfois, la construction de tel corps laissait à désirer, le trait était flottant ou escamoté; l’expression, toujours juste, mais le contour non sans hésitation ni faiblesse. Très particulier, reconnaissable entre mille, il n’avait pas encore cette ampleur, cette autorité que Forain acquit après quarante-cinq ans. Sa réputation grandissait, mais surtout à cause de ses légendes et de cette conversation éblouissante semée d’apostrophes assassines, qui, dans les dîners, dans la société, faisait de lui un convive recherché, fêté—et redouté...
Manque de tenue, diront les étrangers, dont un œil est toujours tourné vers Maxim’s, mais à qui nous ne pouvons demander qu’ils comprennent notre génie, notre franchise, notre scepticisme clairvoyant. Nous leur proposons d’éternelles énigmes. Au moment où ils croient à notre suicide, nous rebondissons à leur constante surprise, plus jeunes et plus dispos, sans honte de notre col désempesé et de notre cravate dénouée.
Les étrangers! Forain les déteste ou les ignore; il incarne certains de nos odieux défauts mais quelques-uns aussi des dons les plus précieux de notre race. Gardons-le pour nous...
Forain est alors en plein succès, il établit sa vie; marié à une femme de talent et d’esprit, père d’un enfant, Jean-Loup, à qui il réserve toute sa tendresse, il construit une maison blanche et nette d’après ses plans, non loin de cette porte Dauphine où passent tous les acteurs de sa comédie. Les journaux ambitionnent une collaboration que réclament les lecteurs et qui divertit la ville dont le goût pour l’image, l’affiche, les albums illustrés, devient chaque jour plus marqué. Chacun ne peut s’offrir le luxe de tableaux pendus à son mur, mais on se dispute les estampes, les pointes-sèches d’Helleu, les lithographies de Chéret, décoratives, réjouissantes. Il semble que Forain délaisse ses pinceaux, tout occupé de trouver pour la fin de la semaine le fait d’«actualité» dont l’Echo de Paris ou le Figaro attendent le commentaire dessiné et réduit en une forme décisive.
Quelle serait sa couleur politique s’il en avait une? Par rapport à ce que nous voyons aujourd’hui, il serait plutôt réactionnaire, mais vaguement, et si ce mot insuffisant et improprement employé, ne désignait une façon de sentir qui ne saurait être celle d’un homme intelligent; admettons pourtant que le réactionnaire soit celui qui n’est pas révolutionnaire, qui ne rêve pas d’un perpétuel bouleversement, d’une incessante mise en question de tous les axiomes—conventions si vous voulez—dont nous vivons, ni mieux ni pis, sans doute, que l’on ne [p. 68] fit avant, que l’on ne fera encore après nous. Le réactionnaire? Ce serait encore quelqu’un qui a assez lu l’histoire et assisté à trop de changements pour ne pas résister aux gestes invitants des vendeurs de panacées, ne pas se méfier des remèdes proposés à d’incurables maladies; peut-être un sceptique, ou un philosophe trop prudent, qui ne croit pas à la nécessité de la révolution, comme source de progrès.
Forain ne s’est pas façonné une âme d’aristocrate ni de bourgeois qui regrette et s’épouvante. Il a un atavisme peuple et parisien, point de convictions irréductibles, nulle éthique sévère, mais du bon sens et une franche connaissance des hommes. S’il a déjà la «foi du charbonnier» dont nous l’avons vu plus tard si ardent, il n’en est pas encore troublé.
Tout enfant, dans le quartier du Gros-Caillou où son père était artisan, Jean-Louis avait été distingué pour son intelligence par un abbé, M. Charpentier, aumônier d’une vieille famille de l’aristocratie. Il en avait reçu une éducation religieuse, contre quoi il n’avait jamais regimbé et dont le souvenir lui demeurait assez doux. Le contact des personnes de bonne compagnie, si antipathique à d’aucuns, lui avait sans cesse été agréable, comme la propreté corporelle et les apparences décentes. Il avait dix-sept ans à la guerre. Tous ceux qui ont assisté à ces détestables événements nous ont dit l’impression cruelle qu’ils en ont reçue et le puissant baptême que leur fut, à l’entrée de leur âge d’homme, le sang de l’année terrible. Il semble que l’invasion soit demeurée comme un cauchemar dans leur cerveau et que rien ne l’en puisse écarter tout à fait. Les générations qui suivent ont de moins en moins la faculté de vibrer à l’évocation de cette tragédie; ceux-là même qui se rappellent les premiers récits, les constantes allusions que nos parents y faisaient, regardent ces guerriers de hasard presque comme les héros de la Fable. Mais je comprends leur émotion, quand j’entends insulter grossièrement tout ce que nous avons été élevés [p. 69] à appeler honneur, dignité, beauté morale. Admirons la souplesse de nos contemporains, pour qui les principes de notre éducation déjà ancienne, mais qui nous ont formés, sont l’objet d’incessantes railleries, tels de vieux accessoires désuets qu’on repousse comme importuns et ridicules.
Plus j’étudie le Forain d’avant le P’sst...!, plus je me convaincs que son état d’esprit fut longtemps sans passion. Il n’avait pas de parti pris, et il ne semble pas qu’il mit de l’empressement pour un parti contre un autre. Et, en effet, nous nous rappelons tous l’espèce de confiance qui régnait alors, rendait aisées les relations entre gens de tendances différentes, mais sans qu’on établît de ces distinctions, sans se livrer à cet ostracisme furieux des passions déchaînées plus tard. Certaines questions de race ou de morale n’étaient pas posées, et c’est à peine alors si l’on remarquait qu’à un nom fortement tudesque correspondît un étranger, un être différent de nous. L’extrême amabilité, la facilité d’assimilation, le caractère entreprenant d’une partie nouvelle mais déjà bien installée de la société parisienne, qui s’en plaignait? Du désastreux antisémitisme, il n’était pas question, ou du moins un homme comme Forain était bien éloigné de prendre parti contre une fraction de citoyens, parmi lesquels il avait des amis, au profit des autres. Il sera à jamais regrettable qu’il ait fallu, pour animer son génie, des drames dont le pays entier allait être bouleversé. Vus de loin, ces événements auront peut-être une grandeur; de la beauté en rejaillira sur cette crise, et l’œuvre exaspérée de Forain apparaîtra comme plus légitime, sinon plus excusable, aux descendants de ses victimes. Des cœurs tièdes devinrent bouillants; ce fut une orientation nouvelle pour quelques-uns, qui, de paisibles et plutôt conservateurs, se transformèrent en révoltés.
Si le développement de Forain commence à se faire sentir au moment du Boulangisme, sa maîtrise éclate après 96, date si importante d’une tragédie qui ouvre [p. 70] nos esprits, agite nos cœurs, où l’on peut assurer que chacun—excepté peut-être certains acteurs (et encore?)—est de bonne foi, spontanément s’exprime, agit en toute sincérité, pour la défense de ce qu’il croit être les intérêts très menacés du pays ou de la civilisation. Malheureusement les points de vue sont opposés! On va se déchirer entre frères; l’avenir du pays est en jeu, toutes portes vont être ouvertes à ses démolisseurs.
On se réveille, sortant comme d’un état d’inconscience léthargique. Tout à coup le terrain que nous foulions sans nous demander ce qu’il y a dessous, se fissure. Comme dans les travaux du Métropolitain, qui mettent à nu des étages superposés de canalisation pour les eaux, le gaz, l’électricité, le téléphone et le télégraphe, prodigieux réseau de fils et de tuyaux invisibles dont l’enchevêtrement silencieux et obscur participe à notre vie à l’air libre; nous apercevons, alors, mille choses insoupçonnées. Nous devinons les causes de maint effet déjà ressenti, mais comme une légère et fugitive douleur qu’on oublie dès qu’elle disparaît. Tout esprit qui ne fut point remué, retourné ainsi qu’un champ labouré, tout homme assez prudent ou assez lâche pour être demeuré impassible, ne comprendra pas la crise par quoi Forain, de charmant dessinateur qu’il était, devint grand artiste.
L’affaire Dreyfus commence à la fin de 1897. Le P’sst...! journal dû à Forain et à Caran d’Ache, paraît en 98 et se poursuit jusqu’à la fin du procès de Rennes.
Il contient une série de chefs-d’œuvre ininterrompue, dont je voudrais bien n’étudier que le dessin, car une incroyable maîtrise s’y atteste pour la joie et l’étonnement charmés des admirateurs de Forain. La plupart de ces planches ont la largeur de trait du pinceau trempé dans l’encre lithographique. On a souvent prononcé à ce propos le nom d’Honoré Daumier. Je vois bien les analogies purement extérieures qui ont rapproché l’un de l’autre ces deux satiristes dans l’opinion courante. C’est ce genre [p. 71] de ressemblance qui fait dire au public, d’un portrait de femme décolletée, sur un fond de paysage, dans un cadre ovale: «C’est du La Tour», ou d’une enfant blonde sur fond gris: «C’est un Vélasquez». Forain aurait plutôt l’écriture appuyée, grasse et si nerveuse de Manet dans le Corbeau[1], dans le portrait de Courbet que je possède, dans de trop rares croquis dispersés dans les revues. Mais l’art de Manet est un peu figé, immobile. Il n’a pas ce mouvement, cette fantaisie, ces coupes osées, cette variété, cette fougue qui mettent Forain très haut parmi les maîtres modernes, à côté de John Leech, de Charles Keene et de Degas. Il joue du noir et du blanc comme un Goya; il est peintre avec le crayon Conté ou le pinceau. Les pages du P’sst...! sont de véritables tableaux dont on peut seulement regretter qu’ils soient pleins d’allusions à des scènes d’«actualité», qui exigeront plus tard, pour avoir toute leur éloquence et leur sens, des notes nombreuses et circonstanciées. Les noms propres abondent dans le texte, de personnes vouées momentanément, par l’exaspération de sentiments exceptionnels, à une haine politique qu’on ne pourra pas comprendre dans vingt ans, mais qui divisa les familles les plus unies, rompit de vieilles affections, arrêta la vie sociale.
Je ne puis, je ne veux écrire ici le nom d’un très galant homme, dont la silhouette déformée, amplifiée, tour à tour cuisinier, évêque, militaire, maître d’hôtel, s’élève très au-dessus d’une individualité, pour devenir le symbole d’une idée et d’une race. On frémit à penser à cet ouragan de passions qui s’abattit sur Paris. Du moins, les victimes du P’sst...! ont-elles eu bientôt leur revanche et peut-être seront-elles fières, quand elles oseront rouvrir des albums désormais historiques, de se voir comme les auteurs d’un drame joué pour la défense de leur race. Forain défendait la sienne. Ceux [p. 72] de l’autre parti avaient, d’ailleurs, leur caricaturiste, M. Hermann Paul, qui manqua de génie. Mais on ne peut pas tout posséder à la fois...!
[1] Traduction par Stéphane Mallarmé du poème d’Edgar Poë.
Forain dit que, dans ces temps troublés, il se couchait dans un état de rage et se levait, après un sommeil fiévreux, plus en rage encore. Comme la plupart d’entre nous, il ne connaissait pas les détails juridiques de l’affaire et ne s’arrêta pas à discuter tel ou tel point sur quoi nous ne serons jamais édifiés, la meilleure foi chez quelques-uns, la folie passionnée chez les autres, brouillant tout, dans la hantise d’une obsession. Forain sentait que c’était la fin de quelque chose dont il faisait partie: il hurlait à la mort, comme les autres criaient: «A l’assassin!», le couteau sous la gorge. Hélas! des poignées de main ne purent toujours être échangées entre les combattants après le duel. La maison est par terre. Verrons-nous ce qui se dressera sur le terrain calciné? On eût souhaité d’être enfant ou vieillard en 97.
Si les sujets dans le P’sst...! sont d’un ordre strictement d’«actualité», la puissance du sentiment communique à Forain une flamme qui le transfigure et le grandit. Son esthétique prend un caractère grave et, quoique très réaliste, un accent apocalyptique. Ce n’est plus de la plaisanterie parisienne. A côté de cet humanitarisme mystique des nouveaux apôtres, source la plus récente de l’inspiration française, voici du patriotisme vibrant. D’un autre point de vue et si, comme tout semble l’indiquer, l’affaire Dreyfus fut une reprise, après un siècle, de la Révolution, les passions de Forain, que nous voudrions, pour plus doucement vivre en société, tâcher d’oublier, prendront, dans l’avenir, une signification que son superbe talent doublera.
Le premier numéro du P’sst...! montre le «Pon Badriote» qui introduit le «Ch’accuse» de Zola dans la guérite vide d’un factionnaire; et il se termine par la magistrale moralité dont la légende est: «Merci; au revoir, père Abraham!—J’fous ai diré les marrons du [p. 73] feu!...»—La composition est grandiose. Le maigre sémite de France, les bras pendants, la tête inclinée sur la poitrine, regarde par-dessus son binocle le gros Prussien (les Allemands sont encore des Prussiens pour un jeune homme de 70), qui emporte les documents de l’Affaire avec un rire béat, ravi d’une nouvelle conquête. Quel progrès a fait le dessinateur entre le 5 février 1898 et le 15 septembre 1899, en quatre-vingts numéros de crise nationale! Si le Pon Badriote, qui accuse, est bien établi dans ses traits sabrés, sommaires, rapides, il n’a pas l’envergure et le style du père Abraham, d’un crayon onctueux, débarrassé du fil de fer dont Forain longtemps cerna ses personnages. Le trait serait impossible à copier fidèlement, de si réduit qu’il était, avant, à quelques éléments très analysables. Voilà un dessin dont nul imitateur ne pourra s’emparer.
C’est la fantaisie, la couleur dans la forme, l’atmosphère, les volumes différents et pour ainsi dire modelés dans la glaise, des diverses figures. C’est de la sculpture dessinée, comme certaines toiles de Carrière sont de la peinture modelée par un statuaire. Entre le frontispice et la «moralité», on ne sait quel choix faire. Cedant arma togæ, impression d’audience. C’est un magistrat vu de dos, qui lance en l’air, de son pied levé, un képi de général. La robe, formant une vivante arabesque, dans le mouvement tendu du corps, d’un beau noir, prend l’aspect d’une grosse fleur sombre, sorte d’orchidée fantastique. Je retrouve un Manet amplifié dans Bataille perdue, les deux amis qui, pour un instant indécis, disent: «Ah! si nous avions eu un homme! Le baron est mort, Hertz est en fuite, Arton est coffré, quelle guigne!...»—Je ne crois pas qu’à quelque parti que vous soyez attaché, Le coffre-fort: «Patience!... avec ça, on a le dernier mot!...», cette étonnante page moderne, vous laisse froid. La confiance en l’argent, seul sentiment, peut-être, que chacun éprouve, hélas! au moins à certaines minutes, est rendu d’une façon définitive par le geste grossier, [p. 74] brutal, de ce financier aux yeux clignotants, qui, en défiant les autres, invisibles, tapote dans sa main de bête pataude la serrure secrète, dont il a le chiffre.
Une nouvelle bombe: «Si j’en crois notre colonel, nous sommes sous l’état-major.» Deux sinistres vieillards en paletot, les jambes recouvertes par l’eau du grand égout, posent une bombe religieusement, comme un prêtre élèverait l’Hostie vers le tabernacle.
Un succès: rentrant d’un dîner, un monsieur dit à sa femme, effrayante dans son lit: «Charmant! bersonne n’a osé parler de l’Affaire Dreyfus!»
Cassation:—il n’y a pas de légende à ce beau dessin d’un juge hagard, brisant sur son genou la hampe de notre drapeau. L’éloquence poignante de ce morceau est présente à toutes les mémoires.
Au secours! «(Zola nageant vers la rive allemande.)—La Fourmi et la Cigale.—«Faut changer de quartier et nous faire protestants.»—La Plainte du sémite:—La Petite République, boudeuse, coiffée du bonnet phrygien, à l’être accablé qui se lamente derrière son fauteuil: «De quoi t’es-tu mêlé? il fallait te contenter de tripoter: c’était reçu.»—Curieux convives: un baron juif et sa baronne, inquiets, avant d’entrer dans le salon où ils vont passer la soirée: «Chut! je viens de donner quarante sous au domestique pour écouter ce qu’on dit de nous.»
L’Allégorie de l’Affaire.—Un soldat prussien, casque à pointe, attache le masque, presque japonais, de Zola devant la tête d’un boursier dont le visage est, à lui seul, une trouvaille. Si l’on a dit que Forain rappelait Daumier, on pourrait aussi bien évoquer à son sujet le nom de Rembrandt, dont les modèles héroïques ont un peu de cet accent, qui est la beauté. Qu’est-ce qu’un artiste moindre eût fait, en supposant que les légendes du P’sst...! lui eussent été données à illustrer? Dans quelle médiocrité intolérable ne fût-il pas tombé? C’est le style, cet indéfinissable don des vrais maîtres, qui sauve le côté pénible [p. 75] de cette campagne caricaturale. En bafouant ses adversaires, loin de les rabaisser, il les anoblit malgré lui. Il extrait de toute une race un type qui finit par avoir un caractère de médaille antique.
Il était difficile, après Daumier et sans lui ressembler, de dramatiser la silhouette du magistrat, du juge. Dans P’sst...! Forain varie indéfiniment les plis de la toge, la toque coiffant une tête non sans analogie avec celle des singes de Chardin: «Thank you, master Bard.»—«Mossieur est le correspondant du colonel Schwarzkoppen.»—Les Secrets d’Etat.—Sublime, cet oiseau de nuit avec son hermine volant au-dessus de Paris, sur qui il fait pleuvoir ses papiers secrets.
On rigole. Les généraux viennent de déposer; les robes noires, en un paquet de plis d’étoffes entremêlés, se tordent de rire, macabres et sataniques.
La proie pour l’ombre, où la silhouette projetée du magistrat se traduit sur le mur en casque à pointe: deux noirs différents, simplement obtenus par une direction différente, dans les deux parties de la composition, du gros trait de crayon Conté.
Pour en finir avec cette série, où les sujets servirent si bien J.-L. Forain, je dois rappeler quelques pages d’une invention linéaire, d’une couleur si belle, qu’ils resteront comme les points culminants de son œuvre énorme, si même l’Affaire cessait un jour d’intéresser,—ce que nous souhaitons de tout cœur,—en n’importe quel pays où ils soient gardés par des collectionneurs. La Détente. Trois hommes, dont un, chapeau de soie défoncé, visage de momie aux yeux clos ou de byzantin, hiératique dans l’exercice d’un sacerdoce, tient une pancarte où on lit l’inscription: «A bas l’armée!» Derrière, dans un cortège abruti et aviné, passant entre une haie de jeunes lignards au port d’arme, des ouvriers ou des camelots brandissent d’autres pancartes emmanchées d’un long bâton: «A bas la France, vive l’anarchie!...» C’est [p. 76] une marche sacrée vers la paix et le bonheur universels, par les rues de la Ville-Lumière; les «intellectuels» applaudissent à l’affranchissement de l’esprit humain.
Le rêve.—On prend le café après dîner; de jeunes Orientaux descendus des mosaïques de Ravenne sont affalés dans des fauteuils, les doigts chargés de bagues. Dans le fond du salon, des barons et des baronnes de même race. Dressé devant eux, la tasse à la main, un «gros bonnet» de la finance dit: «Nous ferons arrêter Boisdeffre par Zurlinden, Zurlinden par Pellieux, Pellieux par Jamont... et ainsi de suite jusqu’à la gauche.»
La mort de Félix Faure, titre: le Mauvais Café.
Dans les Vosges: «C’est de là-pas que j’esbère la venchance.»
Le pouvoir civil: où le banquier, un glaive dressé dans son poing fermé sur sa cuisse, pèse du pied sur le corps de la France terrassée.
L’esprit de Forain, ses formules aussi importantes que son dessin, dans l’ensemble de son œuvre, j’ai été obligé d’en citer de nombreux exemples dans cette étude du P’sst...![2]. On ne peut guère renvoyer le lecteur à un album du genre de ceux où différents éditeurs ont réuni les autres séries de dessins politiques ou simplement parisiens. Peu de personnes ont gardé les numéros devenus très rares de ce journal temporaire. C’est à peine si l’auteur lui-même en possède une série complète. Telle est sa modestie, si petite est l’importance qu’il semble attacher à ce qui fera sa gloire; il est si ennemi de la réclame et de la publicité modernes, qu’il lui faudrait un ami dévoué pour prendre soin de ce qui, chaque jour, tombe de son chevalet sur le plancher de son atelier: dessins, peintures, esquisses de tout genre.
[2] Le P’sst...! a été réédité en deux volumes.
Forain ne «marche pas avec le siècle». Il n’est pourtant pas arrêté, mais reprend ses pinceaux, au [p. 77] contraire, et couvre ses toiles de tons riches ou charmants, d’arabesques savantes, qui sont des variations sur les sujets suivants: les danseuses, les tribunaux, les scènes populaires enfin, dont certaines sont plus touchantes dans leur simplicité familiale,—mères et enfants, «maternités»,—comme l’on dit aujourd’hui—qu’on ne les attendrait de l’implacable ironiste.
Il y a quelque temps, on vit dans l’atelier de la rue Spontini des projets de tableaux religieux. La beauté de ces compositions fait espérer tout un développement nouveau, une veine peut-être féconde. La largeur et la noblesse qu’a prises la technique de Forain, peintre, nous annonce encore des chefs-d’œuvre. Je voudrais, plus tard, continuer cette étude, qui, si elle est incomplète par ma faute, l’est d’ailleurs forcément, puisque Forain n’a pas encore achevé sa destinée, mais forme au contraire mille projets de peintre.
Février 1905.
Note.—Je puis déjà, cinq ans après la publication de ce portrait, ajouter, à la liste des œuvres citées plus haut, une série de belles et précieuses «eaux-fortes» que M. Forain exécute en ce moment. Le dessin s’élargit encore, la technique de la pointe-sèche est parfaitement admirable, faisant penser à Rembrandt et à Goya. Le Christ et les Apôtres, le Calvaire, le Dernier Repas: tels sont les sujets auxquels revient ce catholique. M. Forain s’est apaisé; son visage, rose et gras, décèle une paix intérieure et un accommodement aux choses actuelles. Son esprit lui a concilié ses ennemis, qui semblent avoir passé l’éponge sur le P’sst. Il ne fume plus, il est végétarien et indulgent.
On a écrit beaucoup sur Whistler[3] à l’occasion de sa mort. Malgré les efforts de la critique française à déterminer exactement la personnalité de ce charmant et singulier artiste, je crains qu’il ne demeure, aux yeux du public intellectuel, une sorte de Mallarmé de la peinture, un visionnaire classé entre Edgar Poe et Mæterlinck, un nécroman enfermé dans sa tour d’ébène, au milieu d’un jardin aux sombres pavots, dont le soleil ne réchauffe jamais l’atmosphère glacée.
[3] Cette étude a été écrite en mars 1905, après l’exposition, à Londres, des œuvres de Whistler. Celle de Paris, très incomplète, mal éclairée, est encore venue brouiller les idées. Il semble qu’on doive toujours être injuste envers cet artiste, dans l’éloge comme dans la critique.
En effet, le succès parisien de Whistler éclata à une époque d’alanguissement général. En peinture, dominaient les teintes grises; en musique, une miévrerie maladive; dans les lettres, un goût malsain de bizarrerie et de mystère factices, joint à une manie, vite démodée, de l’exceptionnel et de l’occulte. Les esthètes s’ingéniaient à célébrer le silence de Bruges, les hortensias bleus et les chauves-souris.
On adopta Whistler à cause de la tendance qu’il semblait personnifier, de même que Manet avait servi à Zola, vingt ans auparavant, dans les batailles du naturalisme. Pour Manet, les clichés de «fenêtre ouverte sur [p. 82] le plein air» et «il a chassé le noir de la palette» étaient aussi inexacts et arbitraires que ceux dont on gratifia l’artiste américain, classé peut-être imprudemment au nombre des psychologues et des évocateurs d’âmes. Pourtant ce n’était pas à l’esprit de ses modèles qu’il était attentif; ceux-ci jouaient dans ses préoccupations à peu près le rôle d’une brioche ou d’un melon dans celles de Chardin.
Le «whistlérisme» et le «mallarméisme» sont des formules qui enchantèrent notre jeunesse, comme des préciosités dignes de nos dédaigneuses personnes; mais si des néologismes ont éveillé l’attention de la foule, ils ont faussé l’opinion. Le «portrait de la mère de l’artiste», honneur du Luxembourg, peint dans un mode mineur qui nous parut sans précédent, n’en est pas moins un des exemples les plus sains qu’on puisse proposer à l’étudiant et des plus traditionnels. Cette toile prit une légitime importance dans notre imagination, par ses mérites intrinsèques, alors qu’un nouveau snobisme commençait d’y découvrir quelque impénétrable magie.
A notre époque, c’est, le plus souvent, par des côtés périssables, qu’un artiste s’impose à l’admiration de ses contemporains: d’où tant d’erreurs, de dénis de justice. Les qualités solides et saines qui nous charment dans certaines toiles anonymes, datant des siècles passés, échappent aujourd’hui à l’amateur bourré de littérature, qui veut, en dépit de tout, que la peinture lui donne des sensations directes; or la peinture n’agit directement que sur des tempéraments extrêmement peu nombreux. Si elle agit sur la foule des Salons annuels, ou sur les soi-disant raffinés des cénacles et des petites revues, croyez-bien qu’elle porte en elle-même une tare. Les succès du Salon, ainsi que les extravagances et les folies à la mode, ne durent que le moment où on les loue.
Dans mes plus anciens souvenirs, j’entends encore le nom de Whistler prononcé par les hommes que Fantin-Latour a groupés autour de Manet et du portrait de Delacroix. Au fond de l’atelier de la rue des Beaux-Arts, on voyait l’hommage à Delacroix, où un jeune dandy, pincé dans sa longue redingote, les cheveux noirs bouclés, avec une mèche blanche sur le front, la bouche ironique, l’œil perçant, se retourne vers le spectateur, c’est un élégant au milieu des Français plus négligés, qui sont Baudelaire, Champfleury, Balleroy, Duranty, Legros, Bracquemond, Fantin. Ce personnage étrange m’intrigua longtemps. Son nom revenait sans cesse dans la conversation, sans que des renseignements précis me fussent donnés par les élèves de Lecocq de Boisbaudran et de Gleyre ni par les anciens du Salon des refusés, auxquels j’osais à peine poser des questions. Je démêlais pourtant que le «petit Whistler» avait laissé l’impression d’un type original d’étranger, à une époque où les Américains venaient moins nombreux étudier à Paris. Il avait vite disparu, après des débuts brillants dont il était moins question toutefois que de son allure exceptionnelle, de son monocle et de son esprit mordant, assaisonné d’impertinence. On le craignait, mais on en riait, en le citant, comme d’un faiseur de bons mots.
Que faisait-il vers 1860?
Nous connaissons, si nous en prenons la peine, la manière, avant 1870, d’un Manet, d’un Renoir, d’un [p. 84] Fantin ou d’un Carolus Duran, ses amis. Mais de Whistler, on ne conservait rien. Toujours était citée la «fille en blanc», symphonie de blancs, à quoi il avait travaillé pendant des mois, dans un atelier démeublé, tout tendu d’étoffes blanches. Je sais maintenant, pour l’avoir vu récemment, ce qu’était ce pauvre essai maladroit et informe; je ne me rends pas compte de la profonde sensation qu’il put faire à son apparition. Gleyre, le maître de Whistler, fut sans doute irrité par l’ignorance et les prétentions de ce jeune Yankee; mais qu’est-ce que ses camarades déjà pleins de talent discernèrent d’exceptionnel dans cette figure sans beauté, d’une valeur si veule, sur son fond inconsistant? Toujours est-il qu’on louait en baissant la voix et avec une certaine fierté d’élus, ses nocturnes et ses symphonies. N’était-ce pas un musicien plutôt qu’un peintre, ce Whistler?
Un jour, me promenant, collégien en congé, dans un de ces entresols de l’avenue de l’Opéra où les impressionnistes groupaient leurs œuvres, je vis, arrêté devant la danseuse en cire et juponnée de tarlatane, que Degas avait modelée, un petit homme noir avec un chapeau haut de forme à bord plat, un pardessus à taille, tombant sur ses souliers à bouts carrés, maniant une sorte d’appui-main en bambou et poussant des cris aigus, gesticulant devant la vitrine. Je devinai, par hasard, que c’était Whistler. Or, c’était lui, en effet, et je le rencontrai bientôt chez Degas, ayant été conduit par M. Ludovic Halévy dans ce sanctuaire plein d’horreur. Whistler avait apporté un carton de vues de Venise à la pointe-sèche, qu’il tirait avec mille précautions d’un étui de vélin à rubans blancs. Je ne compris rien à ces planches pâlottes, indications tremblées comme des reflets de lampes dans l’eau. D’ailleurs ses gravures et ses lithographies—je les ai aujourd’hui presque toutes vues—ne me semblent pas dignes de leur réputation. Les premières, celles de France, sont franches, appuyées, et rappelleraient Méryon; les autres sont plus libres, mais sans grand caractère distinctif, [p. 85] jolies parfois, mais faibles, dans cette manière pittoresque de la vignette, où Mariano Fortuny, si injustement oublié, ensuite excella.
Ce fut donc par la série vénitienne, l’une des dernières et sa moins heureuse à mon avis, que je pris contact avec son œuvre. Cela ne m’expliquait pas encore les origines d’une réputation exceptionnelle.
Je ne devais vraiment en prendre conscience que vers 1885, à Londres. Pendues haut et comme si on les eût craintes, deux toiles, à la Grosvenor Gallery, me révélèrent un art classique et neuf à la fois: deux portraits, longs, étroits, dans leur simple cadre d’or mat, strié, plat, comme la peinture elle-même, pour ainsi dire enfoncée, rentrée dans une sorte de gros canevas à tapisserie. Les figures se retiraient de plusieurs mètres en arrière du mur. L’une était rose et grise. C’était une femme en robe d’un ton indéfini, le grand chapeau de paille à la main, pâle comme une pétale de pivoine pâle: lady Meux, arrangement no 2. L’autre tableau, tout noir, mais d’un noir transparent et comme intérieurement éclairé, montrait une face anguleuse de «Bar-maid» sur un haut col paré de perles de corail: c’était Maud, la première femme de Whistler, son modèle préféré, l’inspiratrice de quelques-unes de ses toiles les plus caractéristiques.
Helleu, avec qui je voyageais, et moi, nous n’eûmes plus qu’un désir, celui d’en voir d’autres. Nous allâmes frapper à la porte du maître. Il habitait alors the White House, Tite Street, dans ce Chelsea qu’il adora. On passait, pour se rendre à l’atelier, par une série de petites chambres peintes en jaune bouton d’or, sans meubles, tapissées de nattes japonaises. Dans la salle à manger bleue et blanche, des porcelaines de la Chine et de vieilles argenteries égayaient une table toujours garnie, dont le centre était un bol bleu et blanc, où nageait, parfois, un poisson rouge.
Sur les murs du studio, nul ornement. Dans un coin, loin de la fenêtre, un rideau de velours noir tendu, devant [p. 86] quoi le modèle posait. Deux chevalets vacants; une immense table-palette avec une série de «tons préparés», mixtures différentes pour chaque toile et dont l’artiste se sert, du commencement à la fin, pour exécuter sa symphonie: tons de chair, blanc et rouge indien, ou rouge de Venise, mélangés; tons sombres pour les vêtements; un gros tas d’une certaine couleur neutre pour le fond, et ses dérivés pour la demi-teinte, provisions telles qu’un peintre en bâtiment s’en ménage dans ses camions, afin de «coucher» très uniformément d’importantes surfaces lisses. Whistler pétrit cette pâte avec un couteau à palette flexible et la délaye avec des brosses rondes à longs manches.
La cheminée est surchargée de centaines de cartes d’invitation à des dîners et à des soirées, rappelant que nous sommes chez un «lion» de la saison. Et le petit homme s’agite, parle fort, avec des crescendo de «ah! ah!» et un accent américain inoubliable, rajustant sans cesse son monocle à ruban de moire, de sa belle main fine et nerveuse de prestidigitateur, qui semble prête à châtier le critique imbécile.
S’il consentait à montrer quelque chose, c’était après d’interminables préliminaires et non sans s’être fait prier comme un pianiste. Pourtant la représentation commence. Le chevalet est placé en bonne lumière; puis c’est une longue recherche dans les casiers d’un meuble à secret, recherche qui exaspère notre impatience. Enfin, deux mains tendues tiennent par les deux index, aux ongles pointus, un minuscule panneau de bois ou de carton, qu’elles fixent lentement derrière la glace d’un cadre. Les souliers à bouts carrés vont et viennent, les cheveux bouclés tremblent, un «ah! ah!» perçant fait sursauter le visiteur que Whistler frappe sur l’épaule en lui demandant son approbation: «Pretty?» Et c’est un petit nuage gris dans une bordure d’or mat: «note», «arrangement», «harmonie», «scherzo» ou «nocturne», que vous êtes invité à admirer.
[p. 87] Une autre année, Boldini nous conduit, Helleu et moi, à Tite Street. Whistler nous a conviés à prendre le thé. Arrivés bien avant l’heure dite, impatients, nous avons l’indiscrétion d’insister pour voir beaucoup, beaucoup de choses, de ces toiles dont on aperçoit les hauts châssis étroits, relégués dans l’ombre d’un paravent, et de ces études légères que renferme le mystérieux meuble à tiroirs. Whistler, en bonne disposition et mis en confiance par notre enthousiasme, se décide à tout sortir, à tout nous avouer. J’ai peur que, de ces choses étonnantes, qui passèrent trop rapidement devant nous ce jour-là, la plupart ne soient détruites, qu’elles n’aient été reprises, gâchées et définitivement abandonnées.
Cette visite nous fit comprendre les procédés, le travail si nerveux de l’artiste, qui nous confessait involontairement ses joies et ses tristesses. Nous le surprenions dans l’intimité, épreuve à laquelle un homme très fort, qu’il n’était pas, pourrait seul se soumettre sans danger. Je devinai le sentiment de mes compagnons et je fus très troublé; j’aurais voulu arrêter l’imprudent qui, en me livrant trop de secrets, m’enlèverait peut-être quelques illusions.
Nous passâmes d’abord en revue toute la série des grands portraits. Whistler, qui n’en a pas achevé plus d’une dizaine pendant sa vie, en commençait sans cesse. La première séance était une recherche de l’harmonie, de la pose et des valeurs, un effleurement, une caresse de la toile d’où la figure était en quelque sorte extraite, encore vague brouillard. A la seconde, il précisait le caractère du personnage, tout en répandant, sur la première couche de peinture, une deuxième couche mince et fluide, qui nourrissait le dessous sans l’alourdir. L’œuvre était dès lors achevée en tant que tableau: l’artiste y avait mis le meilleur de lui-même. Mille raisons, excellentes selon lui, l’empêchaient de livrer tel quel, le portrait qui eût ainsi été sauvé. Mais il le gardait en vue d’améliorations que la centième séance apporterait [p. 88] peut-être. Généralement il le gâtait ou l’effaçait. Nous eûmes la bonne fortune d’en voir, parmi de très sommaires et de moins heureux, quelques-uns des plus beaux. C’étaient Connie Gilchrist, la danseuse de music-hall, «arrangement en jaune et or»; Lady Colin Campbell, tête de gypsie au teint mat; Henry Irving, dans le rôle de «Philippe d’Espagne», les jambes du maillot blanc, coulées dans l’huile comme certains Vélasquez; Mrs. Forster, arrangement en noir; Maud, en or roux; un acteur en costume d’Incroyable, harmonie opaline de gris et de rose; certains portraits de la série des «arrangements en noir et brun», comme la Rosa Corder, Mrs. Cassatt, les Leyland, Mrs. Waldo Story.
Whistler, entraîné et s’amusant de notre surprise, nous fit déguster la bonne comme la mauvaise cuvée, et, après de nobles inventions dans les tons les plus précieux, apparaissaient des harmonies moins rares, jolies encore, mais un peu fades. C’étaient des études d’après ces charmantes filles anglaises au pur galbe grec, dont il entourait les formes graciles d’écharpes au coloris atténué[4].
[4] A l’exposition du quai Malaquais, il n’y avait que de sommaires esquisses pour ces toiles. Les lacunes étaient telles qu’on aurait mieux fait de s’abstenir d’un hommage au défunt, hommage qui s’est tourné en dédain.
Un autre chevalet était destiné à la magique série des esquisses où de petites créatures falotes, Mousmés-Bilitis, affectées et charmantes, agitent l’éventail et le parasol sur un ciel de turquoises malades, le long de la grève marine; ou nues, érigent leur joli petit corps à côté d’un arbuste grêle.
Les dessins hebdomadaires que Grévin donna au Journal amusant pendant si longtemps et ses projets de costumes de féeries, flattaient Whistler. Il y faisait souvent allusion et s’en inspira dans maints de ses menus et pimpants croquis, rehaussés de pastel ou d’aquarelle. Son ancien camarade P.-V. Galland, un des artistes [p. 89] français dont il appréciait particulièrement le dessin et le goût élégants, était un des rares contemporains qu’il citât volontiers avec Grévin et auquel il pensât en travaillant. Les statuettes de Tanagra, les estampes nippones, Grévin et Galland: singulière association à première vue, mais qu’explique la fantaisie composite de Whistler. Il transcrivait ainsi dans sa langue de peintre occidental son rêve d’Orient, et usant alors d’un pinceau plat, étroit, traînant une pâte translucide, évoquait, comme dans une frise d’émail, ses jolies petites promeneuses.
De cette série encore, quelques plus grandes figures nues ou un peu drapées, charmantes par la sensualité de leurs formes pleines et mignonnes de femmes-enfant, qu’il dessinait d’abord au crayon sur du papier d’emballage, dévotement.
Dans ses flâneries au British Museum, en compagnie de son confrère Albert Moore, Whistler avait senti la singulière analogie de certains marbres avec le type anglais moderne, d’une beauté classique qu’on chercherait vainement dans la Grèce moderne. Il puisa avec discrétion aux sources où Leighton, Alma-Tadéma, pour ne citer que les plus célèbres, allaient rafraîchir leur académisme gréco-britannique. Mais son geste discret ne devait être remarqué que plus tard.
Dans ces études antiques, aux précieuses figurines soufflées comme le verre de Venise, Whistler mettait ce qu’il y avait de plus aigu chez lui. Regrettons qu’il n’ait pas eu le courage ou la force physique, qui lui eût permis d’appliquer son ingéniosité de décorateur dans une œuvre dont il parla longtemps, qu’il prépara, mais n’entreprit jamais. La bibliothèque de la ville de Boston fut ainsi privée d’un panneau qui fut commandé et qu’on aurait aimé voir à côté de ceux de Puvis de Chavannes et de Sargent.
Sur un troisième chevalet, un plus petit cadre encore attendait des notes de ciel et de mer, inaltérables comme des agathes, des paysages urbains, ruelles et pauvres [p. 90] boutiques de Chelsea, cours dieppoises, animées de bambins croqués au hasard des promenades par Whistler, qui jamais ne sortait sans une «boîte à pouce», toute prête pour fixer, en une arabesque ornementale, le rapprochement inattendu de quelques tons fugitifs. Il avait une préférence pour cette menue monnaie, si précieuse à mon avis, de son talent naturel, et il avait raison de collectionner jalousement et d’étiqueter ces planchettes, dont il demandait des prix énormes, les entassant dans des casiers, faute d’amateurs assez clairvoyants ou assez riches pour se les offrir.
C’est dans cet exercice ininterrompu de la notation, comme musicale, d’un nuage, de l’écume d’une vague ou d’un reflet dans une vitre d’échoppe, qu’il satisfaisait son besoin de perfection technique. Sa science et ses moyens étaient en une juste relation avec la taille de ces œuvrettes où il est sans rival. D’ailleurs, il insistait sur ces «notes» et ces «nocturnes», et devant ce chevalet, nous étions prêts à partager sa préférence, car la plupart des grands portraits étaient des promesses plutôt que des œuvres accomplies. Pour se donner le change à lui-même, il reprochait d’ailleurs au modèle de ne pas s’être prêté à leur achèvement, et aux circonstances, de les avoir arrêtés en route. Sans facilité, son travail était lent, et, pour mettre ce qu’il voulait y mettre dans une toile, d’uni et d’égal, il se trouvait souvent gêné, quand il fallait reprendre de haut en bas, dans la séance, une figure en pied.
Cinq ou six fois et à de longs intervalles, pendant le cours de sa vie, il avait signé de son orgueilleux papillon-monogramme, de grandes œuvres, totalement réalisées; mais chaque jour il livrait un assaut dans un champ moins étendu, où son escrime était plus savante et plus adéquate.
Whistler n’était pas un dessinateur très armé, tel Ingres le voulait, tels que furent les anciens maîtres. Il lui manquait cette aisance dans la construction du corps [p. 91] humain, qui, à un Rembrandt ou même à un Hals, permet de se jouer des difficultés et de mettre même dans un groupe nombreux de figures, sans être fatigué en cours d’exécution, le brillant des dernières touches, l’épiderme vivant. Il n’était pas très savant et ses réussites heureuses dépendaient du hasard qu’implique le manque d’absolue docilité de la main au cerveau. De plus, son système de minces et légères couches superposées, à chaque séance, l’une détruisant la précédente, comporte les transformations les plus inattendues, heureuses ou déplorables. Le modèle se décourageait parfois, le peintre aussi; on remettait à plus tard la suite du travail, et je sais telle personne qui eut le temps de faire des séjours à Londres, en Amérique, et de revenir, des années après, à l’atelier de la rue Notre-Dame-des-Champs, pour voir s’achever péniblement son portrait. Whistler s’embarrassait, tout à coup, d’une main, d’un emmanchement de bras, d’un pied. Je ne crois pas qu’il faille mettre au compte de l’âge seul, ces difficultés insurmontables où nous l’avons vu peiner dans sa vieillesse. Il en avait toujours souffert.
Quand il est au-dessous de lui-même, il l’est comme un mauvais amateur, ses défauts ne sont pas dignes de lui. Voyez la Princesse de la Porcelaine (autrefois dans le Peacockroom, chez Mr. Leyland), banalité de la tête, habile et faible, mal bâtie, mauvaise qualité du dessin, modelé superficiel et rond. Voyez encore le Sarasate, le Duret ou le Montesquiou...
Dans le portrait où Whistler se présente de face, la main en avant, certains critiques candides virent des pièces d’or qu’il soupèse, au lieu d’un modelé faux, qui déforme la paume de cette étrange main, centre de la composition. On devine des irritations et des impatiences cruelles dans la lutte corps à corps avec le modèle, l’exaspération de n’atteindre plus souvent à ces réussites définitives dans de trop rares circonstances, obtenues: avec sa mère, par exemple, Carlyle, miss Alexander, lady Archibald Campbell, lady Meux, Maud, Rosa Corder.
[p. 92] Nous pensions au hasard que furent ces victoires, en prenant le thé, dans l’atelier de Tide Street, déjà envahi par le crépuscule. Le maître est là, debout, avec ses rides, sa bouche pincée sous sa moustache relevée de mousquetaire. A-t-il réalisé ce qu’il a voulu? Sans doute non, quoiqu’il se donne pour le plus grand entre les grands. A-t-il eu ce qu’il ambitionnait? Non. S’il a étonné, scandalisé, en des procès retentissants, couvert Ruskin de ridicule et nié tous ses contemporains, il n’a pas l’autorité que son art devrait lui conférer; chaque rare commande de millionnaire est prétexte à difficultés, lassantes quand la jeunesse a fui. Ses façons, ses mots amusent, on le caricature sur la scène et dans les magazines, on le fête dans les salons, mais c’est le whistlérisme et non Whistler qui est populaire et fêté.
Ses œuvres sont faites pour nous autres, peintres de Paris, à qui il est joyeux de se livrer, et pour ses élèves qu’il voudrait réduire au rôle de simples compagnons de plaisir, mais qui du moins le comprennent. Son monogramme, la couleur de ses murs, ses «ten o’clock», son excentricité: voilà ce qui retient le public anglais en 1885. Whistler voudrait gagner beaucoup d’argent, il en dépense sans compter, et il n’en a pas. Non, comme on le dit, qu’il soit agité de soucis pécuniaires; Whistler, homme aux forts et impérieux besoins, s’est toujours offert tranquillement ce qu’il désirait. Il n’hésite pas à choisir une rare pièce d’argenterie ou de vieux Chine «blue and white», quitte à renvoyer, l’intimidant par sa faconde, le marchand qui ose lui rappeler la réalité d’une échéance. Il donne des déjeuners où la société la plus élégante, autour du bol au poisson rouge, s’esclaffe dès qu’il parle. Pour ses convives, il est «Jimmy», et Jimmy veut être encore un jeune dandy qui fait des projets d’avenir. Et il a soixante-quatre ans.
Une soirée passée avec Whistler au Café Royal ou dans le monde laissait une impression gênante. Ce diable d’homme bruyant en public, hâbleur, vaniteux enfantinement, voulait donner le change sur lui-même. Sans doute, il savait son art incompris, profitait au moins de ses avantages de causeur paradoxal et accentuait ses bizarreries pour retenir l’attention du public. L’effet qu’il s’irrita parfois de ne pas produire dans la société parisienne, était toujours sûr, à Londres. A chaque nouvelle occasion, son succès comme conférencier, plaideur ou essayiste, remplissait les journaux, étendait sa popularité, le «lionisait».
La mode fut donnée par lui à ses confrères, de répondre aux articles des critiques par des lettres ouvertes et même d’intenter un procès à qui les avait sévèrement traités. Whistler, d’un tour d’d’esprit incisif, plein d’ironie et habile à s’exprimer par la parole ou par la plume, poursuivait sans répit ses ennemis, c’est-à-dire les journalistes, les amateurs, la société. Il écrivait beaucoup, d’une écriture fine, charmante, ornementale, qui, du moindre billet, aux savantes réserves de blanc sur un papier choisi, faisait un objet d’art. L’aspect extérieur qu’il s’était donné, autant que le décor de sa maison, ses opuscules imprimés, ses lettres, tout portait un cachet individuel et faisait partie de son esthétique. Son extrême raffinement se manifestait de toutes façons, et l’on était peiné qu’il prît à tâche de se dissimuler sous [p. 94] des dehors—avouons-le—un peu charlatanesques, devant la foule grossière et naïve qu’il était décidé à intriguer comme un homme, puisque, comme peintre, il ne pouvait la conquérir.
Il s’entourait volontiers de jeunes gens. A Walter Sickert, qui l’interrogeait sur les grands hommes de son temps, les Carlyle, les Disraeli, s’étonnant des modestes inconnus qui encombraient maintenant l’atelier: «Je préfère les jeunes fous aux vieux imbéciles», répondit-il. En vérité, il n’avait aucune curiosité en dehors de son art et de la culture de sa personnalité. Il ne lisait pas, riait de toute peinture moderne, sauf de la sienne. Dès qu’il avait accompli sa tâche journalière, il ne pouvait demeurer seul, et ayant gardé tard le besoin de sortir, de s’afficher dans les lieux fréquentés, il lui plaisait qu’un cortège tapageur de disciples l’accompagnât par la ville. Le soir, en habit, mais sans cravate, soigneusement coiffé et sa mèche blanche en point d’interrogation sur le front, il se répandait dans Londres, dînait excellemment et faisait des mots cruels, colportés ensuite par ses fidèles complaisants. Jeune de caractère, vraiment gai, il voulait le rester d’habitudes.
Comment un homme qui avait une si noble conception de sa mission artistique et qui fût mort de faim plutôt que de transiger et de se mentir à soi-même, ne s’acquittait-il autrement de son rôle de chef d’école? Ses disciples, pour qui ses principes si vrais et si raisonnés étaient une manne attendue avec émotion, pourquoi les traitait-il en camarades tout au plus bons à répandre ses boutades? Whistler eût pu maintenir une sorte d’équilibre de la pensée à une époque de confusion où les débutants doivent tout apprendre par eux-mêmes, faute de maîtres pour enseigner ce que chacun savait jadis à vingt ans.
Ses théories étaient pleines de cohésion et il avait formulé des règles sur lesquelles il était intransigeant pour lui-même. Je me rappelle certaine page extraite d’un de [p. 95] ses essais et dont il distribuait des exemplaires à ses amis. C’étaient de brefs commandements d’un homme de goût, sur «les conditions et les proportions de l’œuvre d’art», très littéraires et d’un dandysme à la d’Aurevilly. Mais le Maître cédait le pas à l’histrion.
A le voir parader en dehors de l’atelier, on l’eût pris pour un émule d’Oscar Wilde, qu’il méprisait pourtant et dont il ne cessait de faire remarquer la vulgarité, l’inintelligence esthétique et l’insincérité.
Les manifestations dans le ton du whistlérisme d’alors, il en était très fier et s’en amusait comme d’une bravade de grand peintre incompris, égaré parmi de demi-professionnels. Avec les ratés et les mondains tapageurs de sa bande, aussi bien, il se grisait, redressait sa taille, restait plaisant et familier. Mais si, rentrant tard de leurs balades nocturnes, ceux-ci passaient chez le maître, ils le retrouvaient penché dès l’aurore sur la plaque de cuivre ou campé devant sa toile. Le «lion» d’hier soir était devenu un vieillard à grosses lunettes, courbé sur son ouvrage, fervent devant la nature.
Et c’est alors qu’il laissait percer ses secrets de bel exécutant nourri dans les musées, passionné pour la pureté de la matière. Tintoret, Vélasquez, Canaletto, ses préférés, il les avait approfondis, assimilés. Il voulait que, petit ou grand, son ouvrage fût, à toutes ses phases, digne de lui, beau dès la première séance, parfait dans tous ses états. La subtilité nerveuse du dessin, les valeurs observées avec tant de soin, sans qu’il donnât jamais un coup de pinceau en l’absence du modèle, enfin l’absolue probité de ses intentions: quel exemple pour nous! Ce «barbouilleur» et cet original bruyant était un des derniers à se préoccuper des conditions matérielles, sans quoi le tableau à l’huile se plombe vite et n’a pas de durée. Il avait retrouvé la transparence des maîtres—avec une technique nouvelle. Il voulait se classer à leur suite.
Dans une exposition d’ensemble, on est déconcerté par les techniques si différentes de ses débuts et de sa maturité correspondant à deux phases importantes de sa vie. Avant 1860, Whistler, pour fuir l’autorité de ses parents, qui veulent faire de lui un ingénieur, quitte l’Amérique, vient à Paris quand l’école réaliste est dans son plein épanouissement, reçoit la bonne leçon, puis va se fixer à Londres au moment où le préraphaélitisme, avec Ruskin, échauffe tous les esprits. C’est ainsi qu’il prend part à ces deux mouvements de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, si considérables pour les deux pays, mais si opposés en leurs résultats; semblables à leur origine, comme toutes les rénovations artistiques, répondant à un besoin de sincérité, et comme une sorte d’effort vers l’interprétation plus fidèle de la nature. Ce souci de la nature, notons que tous les révolutionnaires du dix-neuvième siècle l’ont eu, David comme Manet, Holman Hunt comme Courbet.
Dans les écrits théoriques et les conversations du «Preraphaelite Brotherhood» (confrérie) il n’est question que d’étudier la vie en ses moindres effets, tous dignes du pinceau ou du crayon de l’artiste. Le préraphaélitisme, que devaient prêcher des hommes plus littérateurs, plus poètes que peintres, fut un acte d’adoration devant la nature. Remontons aux candides primitifs, oublions les conventions, dessinons, comme un enfant, les êtres et les objets. La plante, le brin d’herbe, l’insecte, [p. 97] les plus humbles choses seront rendues, observées avec tendresse et naïveté. Dans la figure humaine, ce sera le caractère, l’attitude juste qu’il faudra marquer; les sujets de tableaux, si modestes soient-ils, seront ennoblis par la conscience du bon ouvrier qui les traitera.
Des tempéraments très divers distinguaient chacun des frères-apôtres. Le robuste John Everett Millais n’était que par un hasard de camaraderie enrôlé sous la bannière de Rossetti, de Madox Brown et de Holman Hunt.
Whistler vécut avec eux dès son arrivée à Londres, il fit poser les mêmes modèles, se mêla à ce groupe, le plus intéressant d’alors, où il ne fut pas mieux compris qu’à l’Académie. Cependant, pour une partie de son œuvre, l’histoire le rattachera peut-être à cette école. De la «Queen’s House», où Rossetti reçut Whistler et se lia d’amitié avec le poète-peintre, il subit une influence incontestable, mais purement extérieure.
Il ne devait plus guère quitter ce coin de Chelsea où il recueillit ses plus fortes impressions. La Tamise, qui coule déjà plus paisible dans cette ancienne banlieue de Londres, entre des quais ombragés de quinconces et construits de charmantes maisons du dix-huitième siècle, à la brique violette, passait naguère sous des ponts de bois d’un profil bizarrement japonais. Souvent, sans doute, sortant de la «Queen’s House», où des assemblées d’esthètes et de belles femmes à la lourde chevelure, au long col gonflé, avaient célébré la «Blessed Damosel» et la Florence médiévale, Whistler entrevoyait dans la brume de l’aurore ses futurs nocturnes; l’arche du vieux Battersea bridge, une péniche sur le fleuve, telle cheminée d’usine en deux tons apparentés, quels motifs pour de fantastiques «harmonies»! Était-il donc nécessaire d’aller chercher l’inspiration dans de vieux livres italiens? Pourquoi tant de littérature, tant de pensées, pour en faire un tableau?
Il garda un souvenir affectueux du séduisant Dante-Gabriel; mais leurs rapports n’avaient peut-être pas été [p. 98] toujours très aisés. A propos d’un sonnet écrit par le poète pour une composition qu’il tardait à peindre, son ironique ami avait demandé: «Pourquoi faire le tableau? Transcrivez le sonnet sur la toile au lieu de le graver sur le cadre!... cela suffira!...»
D’autre part l’esprit de Ruskin dominait le cénacle, et Ruskin n’avait aucune considération pour le jeune Américain. Dans leur célèbre procès, le grave prosateur s’était étonné que 5.000 guinées fussent la valeur d’une pochade faite en deux heures. Whistler avait répliqué: «Je ne sais pas si j’ai mis deux heures ou une demi-heure! Mon nocturne m’a peut-être pris dix minutes à peindre, mais il résumait une vie d’observations».
Ainsi, sous les dehors d’une cordiale camaraderie, il y avait entre ces hommes, simples habitudes de voisinage, avec quelques goûts en commun, mais, au total, inintelligence l’un de l’autre. Cependant, c’est dans ce cercle, le plus précieusement littéraire, que Whistler applique ses qualités de bon peintre et l’enseignement rapporté de Montmartre, enseignement auquel il ajoute celui de la National Gallery et du British Museum. Fuyant les primitifs, dont se réclamaient les frères préraphaélites, c’est aux Vénitiens, à Vélasquez et à l’Antiquité qu’il demande conseil.
A Paris, il avait respiré l’air des ateliers où la riche palette et la mâle technique étaient encore honorées. La force qui agit d’abord sur le jeune élève fut l’énorme et sain Courbet. Dans sa première manière, Whistler montre son goût pour la belle pâte grasse, épaisse; l’emploi du couteau à palette précède celui du pinceau. Il est intéressant de voir, dans la collection de Mr. Edmund David, «la femme au piano», noble dans sa lourdeur un peu maçonnée, à côté d’un tableautin déjà fluide: des jeunes filles en robes blanches, à la Rossetti. Ces deux toiles révèlent l’apport de la France et celui de l’Angleterre dans la formation de Whistler, qui trouva la voie entre l’un et l’autre pays, vers l’Espagne et l’Italie.
[p. 99] Manet, Claude Monet, Renoir, Degas, Fantin, Legros, Guillaume Regamey, Cazin, Lhermitte et les autres élèves de M. Lecocq de Boisbaudran, tels avaient été ses premiers compagnons. Vous savez l’exécution solide, savoureuse, que chacun d’eux possédait vers 1865 et qui, en dépit de multiples classifications dont le sens est déjà amoindri, les réunira dans un glorieux faisceau. Whistler tient presque autant à ce groupe français qu’à l’école de Chelsea. C’est Paris qui lui apprit à tenir le pinceau.
Il est regrettable qu’on n’ait pas tenté une monographie de M. Lecocq, qui fut un professeur modeste, effacé, mais d’une rare intelligence. Fantin racontait les promenades à la campagne de tout l’atelier, quand on jetait dans un champ, au clair de lune, quelque loque blanche, afin d’en étudier les valeurs différentes, selon la lumière plus ou moins intense qui l’éclairait; et les observations ingénieusement pratiques qui ouvraient les yeux, activaient la compréhension des lois éternelles. M. Lecocq ne fut pas le maître de James Mac Neill, mais il l’influença tout de même de ses théories.
C’est Londres qui développa les dispositions de coloriste que Whistler tenait en réserve. Londres, le point du monde le plus beau, le plus pittoresque pour ceux qui savent regarder. Whistler, assurément, fut un des premiers à en découvrir les mille merveilles: effets continuellement changeants d’une atmosphère prismatique et diaprée; noblesse de son architecture courante, si touchante dans son apparente nudité, si appropriée au climat, si colorée, si élégante dans ses délicatesses dissimulées. Londres, majestueuse cité aux plus hardies constructions modernes, où la brique et le fer s’offrent nus, sans ces mesquins festons dont le Paris moderne croit se devoir à lui-même de masquer des ponts et des magasins. Whistler l’adora quoiqu’il fît profession de le détester. Il eut une tendresse pour ses femmes à la chair de fruit, coiffées de cheveux plus ambrés que ceux des Vénitiennes et des Sévillannes. Il n’avait qu’à ouvrir sa porte [p. 100] pour croiser des filles, belles comme des statues grecques ou transparentes comme des fleurs de magnolia. La marmaille des rues, si drôlement costumée d’étoffes aux tons crus, plus éclatants encore dans la brume humide qui les exalte, il les introduisit dans l’art, ainsi que ces pauvres devantures de boutiques peinturlurées, prétextes à ses plus merveilleuses variations. Whistler ne peut s’expliquer que par Londres, qui est à la fois une Venise, une Hollande et toutes les parties du monde amplifiées, poussées jusqu’à une sorte de paroxysme du pittoresque par la richesse de la vie et la pléthore dont elle éclate.
Pour moi qui en reçus mes premières impressions et qui en fus intoxiqué, l’art de Whistler prend un sens plus net peut-être que pour le Français, à qui répugne la saveur anglaise, amère et sucrée comme le gingembre. Londres ayant pour moi le même genre d’attrait que Rome a pour tels autres, je suis reconnaissant au maître de ses moindres croquis, parce qu’ils témoignent d’une émotion que j’ai ressentie, d’une prédilection pour certains coins de rues que je garde au fond de ma mémoire depuis les heures de ravissement que je passai là-bas, comme enfant, puis comme homme, sans jamais me lasser d’admirer et d’y retourner.
Un étranger voit mieux qu’un natif ce qui fait le caractère d’un pays. Whistler, Américain, devait traduire Londres dans une langue bien plus expressive que celle d’aucun Anglais. Il la vit, comme je crois la voir, élégante dans ses pauvretés et ses tares mêmes, fine dans son outrance, barbare et supérieurement civilisée, classique et si contemporaine, passionnée sous des dehors de réserve et surtout picturale plus qu’aucun autre endroit sur terre.
La brume, l’eau immobile et moirée, les mousselines et les gazes impondérables d’un climat humide qui transforme en palais et en lacs de rêve le plus simple mur et le ruisseau, n’est-ce pas la moitié du génie de Whistler?
Voici un des rares artistes d’aujourd’hui, dont il suffirait qu’une seule toile subsistât pour qu’on pût le juger. Et cette œuvre d’élection, c’est le portrait de sa mère. Ce calme chef-d’œuvre dont la présence dans le Musée du Luxembourg assurera à Whistler la durée. Les gris argentés, les noirs verdâtres, les lignes simples et nobles qui forment son rythme, séduisirent, à leur apparition, autant que les polyphonies impressionnistes et prirent dans leur réseau arachnéen la jeunesse artiste. Grande habileté d’avoir su ménager son effet, choisi le moment d’entrer silencieusement au milieu des plus bruyants accords, dans une galerie toute moderne et internationale, parmi les étalages bigarrés de ses contemporains. Il la voulait au Luxembourg: cette toile y alla. Si vous avez vu et admiré ce portrait de vieille femme, votre admiration pour Whistler est allée d’emblée là où il se surpassa. Ce profil fin, sous les bandeaux argentés et le petit bonnet d’impalpable dentelle, avec ses brides hiératiquement rigides, tombant sur une plate poitrine de vieille femme déjà prête pour le suaire; l’atmosphère glacée de la chambrette austère, à la tenture de deuil, aux sparteries nettes, la chaise anguleuse, et ce tabouret sans capitons où s’appuient deux pieds chaussés de velours, rapprochés comme ceux d’une figure tombale, cette majesté toute intime stimulera votre imagination. Vous ne perdrez jamais, après les avoir regardés, le souvenir de ces traits délicieusement aristocratiques, de [p. 102] ce nez si joli, de cette bouche tremblante, de ce regard noyé dans le rêve, terni, mais si vivant d’être un œil relevé dans un visage un peu abaissé, qui n’a plus la force de se tenir droit sur le col—déjà presque d’une morte.
Le modèle collabora puissamment avec le peintre. On a dit que l’image de sa mère offrait à l’artiste une occasion sans seconde d’exprimer le tréfonds de soi-même. Cette opinion courante et presque banale est tout à fait juste pour Whistler. A son habituelle émotion en présence de la nature, il ajouta, cette fois, sa tendresse filiale et ce pathétique des heures qui précèdent la déchirante séparation finale. Sa brosse, trempée dans les essences les plus précieuses, agglutine des poussières d’ailes de papillons sombres, pour les étendre amoureusement sur un canevas très fin, sorte de batiste rentoilée et si fragile, que j’ai connu longtemps ce tableau troué, sans qu’on osât le réparer—comme un verre de Murano.
Une autre fois, Whistler se mesura encore avec un modèle d’exception: c’était Thomas Carlyle. Il s’y exprima en une très belle page, mais inférieure cependant au portrait de sa mère. La donnée était à peu près la même: une figure de profil sur un fond uni, même chaise, même natte sur le plancher. La ligne arabesque, très recherchée et trouvée, de cette redingote marron, bouffante sur le devant, conduit à la tête rose du noble vieillard, inclinée, elle aussi, sous ses cheveux gris. L’œil est doux, triste et inquiet, s’écartant du spectateur. Ce portrait est beau, mais on y sent l’effort, la matière y est alourdie, dans le visage surtout, qui a dû être peint et repeint jusqu’à la fatigue. Le modelé, non sans quelque ressemblance avec celui de Courbet, s’est amolli dans les reprises, il est trop empâté pour la main de Whistler, qui, comme Titien et parfois Vélasquez, ne gardait tous ses moyens qu’autant que la trame de la toile restait visible, invitant le pinceau à jouer avec elle.
[p. 103] Dès que les trous «se bouchent», les gris cessent de tinter comme de l’argent, le métal perd son timbre. Dans un éclairage de côté, le jour frisant, les reprises rendent vite la couleur cotonneuse. C’est peut-être pour pallier cet inconvénient et parce qu’il éprouvait une gêne dans les modelés à relief, qu’il cessa soudain d’éclairer le modèle autrement que de face, et en plein. Un objet placé dans l’axe de la fenêtre n’a plus ni son volume ni son relief, puisque les saillies, marquées par l’ombre et les lumières, donnent seules la sensation de l’épaisseur. Les valeurs de cet objet étant à peu près les mêmes que celles du fond, on obtient une image plate comme une feuille de papier. De plus, chez Whistler, le clair et les luisants sont très atténués par la distance qui sépare le modèle de la fenêtre. Il chercha beaucoup la position que doit occuper une figure dans une chambre, en vue d’un bel effet tranquille et uniforme, qui donne de la grandeur, n’aimant pas l’éclairage conventionnel qui projette les personnages en avant du cadre, leur prête une apparence de ronde-bosse et en fait un trompe-l’œil. Le tableau qui rappelle le panorama et amène le modèle au premier plan, lui faisait horreur, le choquait comme une concurrence déloyale à la réalité. Il avait souvent un geste de la main, comme pour repousser dans le lointain ce que la plupart des peintres, même Rembrandt, attirent en avant. Le relief ne lui semblait pas digne de la peinture ni compatible avec ses moyens. Il était très occupé du fond dans ses portraits.
Le fond est un problème de première importance, d’abord parce que c’est sa qualité qui fait le tableau, techniquement, harmoniquement, et aussi pour des raisons extrapicturales. Holbein et les primitifs aimaient les ornements compliqués, ou même des sites, qui, chez eux, ne nuisent pas au contour du visage, quoique les détails en fussent aussi appuyés que ceux de la bouche et des yeux. Les Vénitiens et Vélasquez, les Flamands, employèrent tour à tour le fond uni, la draperie d’un rideau, les ciels [p. 104] de convention, le décor de l’appartement. Les Anglais du dix-huitième siècle, obéissant au goût élégamment pompeux de leurs clients, invariablement les placèrent dans de magnifiques parcs ou sous le portique de leurs châteaux. Il importe peu que le fond soit uni ou compliqué, quoique M. Degas ait dit avec ironie de telle dame se présentant très parée comme sous un rayon électrique, devant un noir frottis à la Bonnat: «Elle pose devant l’infini et l’éternité!» boutade qui n’a plus de sens, dès que cet «infini» est un ton juste et harmonieux s’équilibrant avec le sujet.
Si le sujet est une personne intéressante par elle-même, il pourra paraître plus décent de lui laisser tout son intérêt individuel, sans l’adjuvant des meubles de son intérieur. Un mur gris peut être d’une grande éloquence, selon la façon dont la lumière s’y glisse; ou veule et muet, comme si souvent on le déplore dans tels portraits mesquins de Fantin-Latour. L’important, c’est que le peintre trouve, tôt ou tard, le genre de fond qui convient à son procédé. Le fond lui est en quelque sorte imposé par sa façon de peindre, une figure ne pouvant être reprise dans une séance, sans que le fond le soit aussi. Les portraitistes rapides et très féconds, comme Van Dyck, et surtout comme les Anglais, s’étaient approprié une formule de paysages ou de draperies, qui se prêtaient à des orchestrations variées, selon le ton du costume et des chairs, faciles à établir quand le modèle, pressé, est parti.
Une occasion devait, certain jour, mettre Whistler dans une nouvelle direction. Dans sa première maison de Cheyne Row, vint poser miss Rosa Corder. Le hasard la fait passer, toute de brun vêtue, devant une porte de l’appartement, qui se trouve être noire. Whistler est frappé par la simplicité, la netteté des grands plans bien distincts, quoique atténués, de la silhouette, comme en certaines fresques pompéiennes dont le fond est noir aussi. Il se met à l’ouvrage, et bientôt surgit ce merveilleux [p. 105] portrait, «arrangement en brun et noir», exemple accompli de sa manière la plus significative. C’est pour cet effet qu’il eut, dès lors, et pour longtemps, une sympathie et une préférence, instinctives d’abord, puis raisonnées. J’insiste sur ce fait, qu’il «se trouva» par hasard, comme l’on dit aujourd’hui, mais qu’il ne chercha pas à se singulariser par une étrangeté de vision arbitraire. Sa difficulté à peindre purement, sans que le modèle posât devant lui, était ainsi diminuée et sa grande sincérité d’artiste, mise à l’aise, car la nature ainsi préparée par lui, il n’avait plus qu’à la «copier». Dès lors il connut ce qui lui restait à faire.
Son exécution ne changea plus guère. On en trouverait les éléments dans certain portrait d’homme par Vélasquez au musée de Madrid. Parfaite justesse, solidité sans empâtements. On confond souvent «solidité» avec épaisseur de la matière. Les Allemands modernes, par exemple, et les plus mauvais parmi nous, croient qu’une forte technique est une technique voyante, martelée et lourde. On traitera communément de superficielle la peinture transparente et fluide, qui laisse visible le grain de la toile. Pourtant ce n’est pas l’épaisseur qui donne la solidité, et les fines coulées de thérébentine d’un Whistler sont aussi consistantes que la maçonnerie de Courbet. Il n’y a, comme dit Corot, que la forme et les valeurs. C’est pour ne plus se soucier du ton, abstraction faite des valeurs, que les jeunes impressionnistes tombent de plus en plus dans la peinture creuse. Leur idéal est le papier de tenture ou la fresque. Étrange erreur que de vouloir réduire aux dimensions d’un tableau de chevalet les données décoratives d’une surface murale. Whistler pensait qu’un objet d’art, peinture, pastel, gravure, dessin, doit être un objet précieux, dans sa matière et dans son exécution.
Il me semble que je parle d’un ancêtre!
La quantité d’esquisses, d’essais sommaires, qui sont une part délicieuse du bagage de Whistler n’infirment [p. 106] pas ce que j’avance. Son obstination persévérante dans le travail, son souci constant d’achever, ne l’empêchaient pas d’être, le plus souvent, fier d’un coup de crayon ou d’une esquisse rudimentaire. Car «achever», c’est communiquer l’impression qu’on a eue, laconiquement ou à force d’insistance. Or il avait des mots brefs, aussi éloquents que ses discours les mieux concertés. Rappelez-vous le port de Valparaiso, qui date pourtant de 1866.
N’ayant connu qu’à la fin de sa longue vie les éloges hyperboliques, il n’avait pas été gâté par des succès prématurés, si pernicieux souvent. Les éloges sont prodigués aujourd’hui aux incomplets, aux débutants, comme naguère ils l’étaient aux académiciens gourmés: réaction prévue et nécessaire, mais combien dangereuse! Les obstacles, les dédains et la lutte, seuls, fortifient les convictions. James M. Neill n’était pas un homme pressé. Inébranlablement, il croyait aux maîtres, pensait pouvoir les continuer, peut-être même les surpasser, et il s’était trop longtemps senti seul dans le désert pour se laisser troubler par des remarques désobligeantes ou des dédains tendancieux. Il se croyait plus classique que le grand Watts et plus moderne que les impressionnistes, dont il traitait le laisser aller et l’art souvent hâtif, de sottise et d’enfantillage.
La lutte engagée depuis quelques années entre les défenseurs de la peinture soi-disant claire et de la peinture prétendue noire, ajoute à l’œuvre de Whistler un grand intérêt historique. Dans la confusion des idées et la tourmente des opinions jetées au hasard à une foule distraite, la question risque de s’égarer ou de ne pas être tranchée du tout. Est-il d’ailleurs bien utile qu’elle le soit?
Le mot «vérité» n’a pas de sens en esthétique et les règles les plus opposées ont produit des choses également belles. La nature est prodigue d’aspects contrastés: mon œil sera charmé par ce qui attristera le vôtre. Libre est chacun d’aimer ces effets sobres et atténués ou les paroxysmes lumineux et la polychromie. Nier le noir est aussi puéril que nier le bleu et le mauve; dire de Whistler qu’il eut une mauvaise action sur son temps, serait aussi injuste que d’accabler Rodin, Monet ou Cézanne d’un pareil reproche. Pourquoi appeler «suie» ce qui n’est pas «fleur»? Les maîtres d’exception ont autant d’influence par leurs défauts que par leurs qualités.
A l’origine de ces querelles d’école, on distinguerait assez vite le simple caprice, l’arbitraire position d’esprits sans solidité, qui donnent, dernier argument de l’ignorance, leurs préférences comme des lois.
L’exposition de Whistler, dont nous allons avoir le régal, servira de prétexte à bien des controverses professionnelles, embarrassera certaines consciences inquiètes. [p. 108] Un mois après la fermeture des Indépendants, ces continuateurs éperdus de Cézanne et de Seurat, il faudra louer et analyser un autre impressionniste, qui se dresse en beauté, majestueusement, gravement, à côté des sottes tentatives, des pauvretés et des chétifs essais. Impressionnisme dans un mode mineur, tout aussi vif, plus profond que le nôtre et qui ne rejette pas la leçon du passé, mais en profite au contraire: tel est celui de Whistler.
Qui eût prévu que Cézanne et Whistler seraient, au commencement du vingtième siècle, les seuls chefs de file derrière qui la jeunesse artiste marcherait fascinée? Il suffit de constater le fait pour prendre une vue nouvelle de deux races, de deux types intellectuels, dont les manifestations provoquent, de plus en plus, un antagonisme hargneux.
Whistler nous est envoyé comme le dernier messager des maîtres, tendant un anneau de la chaîne brisée par l’académisme et par l’humilité lassée des adversaires du savoir et du talent. Ce maître de la lumière et des valeurs, ce pur coloriste, donna une grave leçon de respect, de conscience, de volonté. Nous aurions préféré, si c’eût été possible, écarter maints détails de sa physionomie, pour ne pas amoindrir l’enseignement robuste et sain de celui qui eût pu être un guide, comme Corot en fut un pour Pissarro, Monet, Sisley, Manet même, à leurs débuts. Corot ne cessa de prêcher l’étude des «valeurs», c’est-à-dire l’exacte proportion des tons, relativement les uns aux autres, comparés au blanc pur, qui est, sur la palette, l’extrême lumière, et au noir, qui en est le contraire. Whistler posséda la logique, le «goût», la distinction. Ne confondons pas ce mot, si discrédité aujourd’hui, avec fadeur, mièvrerie, affectation académique ou mondaine. Sa distinction est une beauté qu’on aime dans la statuaire de la Renaissance ou de Tanagra, comme dans l’imagerie japonaise ou dans l’art du dix-huitième siècle.
[p. 109] S’il présida, en Angleterre, à une sorte de renouveau du style décoratif, oublions ses bizarreries pour ne voir que la discrétion avec laquelle il débarrassa, dans la maison, le «modern style» d’un pénible fatras et de détails inutiles et trop contournés. Il ne doit pas être responsable de certains excès dont on le chargea. Avec quelques pots de couleurs bien choisies, il apprit à faire du plus ordinaire appartement moderne, un intérieur décent. Son goût, tout japonais, correspondit à un besoin du public, las des formules néo-gothiques de William Morris, qu’avait inspiré Rossetti. Soyons-lui, de cela, à jamais reconnaissants. La double leçon de Whistler mérite d’être écoutée: celle de l’homme, à la fois si traditionnel et si moderne, et celle du peintre classique, quoiqu’original, qui, avec les seules ressources de la nature morte appliquées à la figure, ramena à une bonne technique les égarés de l’Ecole et de l’Impressionnisme.
Whistler transforma la palette, en la réduisant dans ses éléments constitutifs. Il la débarrassa des laques, des mauvais verts, des chromes et des cadmiums, pour la charger de solides et immuables terres qui, mélangées, lui donnent tout ce qu’il requiert, grâce à une transposition nécessaire et nullement plus artificielle que celle de Claude Monet. Les «tons préparés» et le noir reçoivent donc de nouvelles lettres de noblesse, à l’heure même où l’impressionnisme français les bannit, pour ne plus employer, en tons purs, que les couleurs de l’arc-en-ciel.
Deux expositions récentes, à Londres, nous ont heureusement permis de comparer entre elles un grand nombre de toiles faites avec l’une et l’autre palette. A la New Gallery, la Société internationale, fondée par Whistler et que préside aujourd’hui M. Rodin, rendait un hommage solennel à notre Maître, tandis qu’un marchand parisien avait déballé, dans le Grafton Gallery, les réserves de son magasin. Il s’agissait d’établir, de l’autre côté du détroit, un débouché pour le syndicat qui [p. 110] veut conquérir le vieux et le nouveau monde, lui imposer sa pacotille. La tentative fut bonne et eût été meilleure encore si le choix eût été plus judicieux. Mais on voulait trop prouver, et cette «chasse au noir» fut mal organisée. Manet, noir et blanc, comme le Greco; M. Degas, l’incomparable dessinateur, dominaient un ensemble de paysages, souvent jolis, mais dont la totalité, uniformément grise et terne, plombée, veule, lassait vite le visiteur. Quelle erreur lamentable que cette collection de petites études toutes pareilles, crayeuses et sans lumière, où les effets de soleil, les ciels bleus tendres de l’Ile de France, comme les ciels d’orage, offraient cet aspect défraîchi et rance d’une salle Caillebotte indéfiniment prolongée! Le défaut de composition, le manque de choix, le hasard de la mise en page et, plus que tout, la monotonie de ces notations quotidiennes de coins quelconques d’une éternelle banlieue, finissaient par irriter. Au contraire, Renoir s’affirmait avec sa fameuse «loge», elle, riche des plus somptueux noirs, de bruns et de rouges que Delacroix n’eût pas reniés. Cet écrin de rubis, de perles et de jais, éblouissait à côté des quelques lainages teints des Renoirs plus récents. C’étaient aussi des natures mortes macérées et saumâtres de Cézanne, belles de leur lourdeur de marbre, décoratives comme de vieilles céramiques, à peine des tableaux; puis on subissait une nouvelle série de paysages tout fleuris d’arbres printaniers des bords de la Seine ou de la Marne. Cette prétendue peinture gaie était morne: la claire chanson promise ne s’élevait pas. Somme toute, point de «joie de vivre», point de «fenêtre ouverte»; rien de strident, car la patine du temps a déjà fondu et recouvert d’un émail épais, quand ce n’est d’une poussière tenace, ce qui devait le défier. Je n’eus pas à la Grafton Gallery, la sensation de la lumière.
C’est que la puissance lumineuse d’une toile ne vient pas des tons choisis pour la peindre, mais des oppositions de clair et de sombre, d’où tous les maîtres, depuis les [p. 111] Vénitiens jusqu’à Manet, en passant par Rembrandt, Vélasquez, Watteau, Delacroix, Diaz et Courbet, ont tiré leurs effets les plus sûrs.
Il est inexplicable que l’on se soit imaginé récemment, que la lumière ne peut être obtenue que par des tons clairs. Toute l’histoire de la peinture prouve le contraire, et je ne sache pas que la Saskia de Rembrandt le cède en rien, pour l’éclat, à l’homme à la mentonnière de Van Gogh. J’ai sous mes yeux une tête d’enfant par Renoir, le portrait de Ziem par Ricard, tout en terre de Bruxelles et en Sienne brûlée; une matinée d’avril sur les collines d’Argenteuil, par Monet, voisine avec d’anciens Corots d’Italie. Or, ce sont les Ricards, les Corots qui trouent la muraille.
Toute peinture, après vingt ans, cesse d’avoir de la fraîcheur. Elle ne se soutient plus que par la distribution des valeurs. Un paysage de Gainsborough, un Canaletto, un Manet de 1867 fait avec les vieilles recettes, j’en ai la preuve devant moi, ont plus de puissance lumineuse qu’un Sisley. Toute personne de bonne foi en peut faire l’expérience et le public ne tardera pas à s’apercevoir qu’il a été mystifié par les critiques d’art. Les tons entiers, apposés par taches les plus pures, même chez Seurat et Signac, passent, se ternissent; leur puissance colorante n’a qu’une courte durée et dès que celle-ci s’anéantit, le tableau s’éteint. Les impressionnistes qui n’ont cherché que la lumière, l’ont moins exprimée en leurs œuvres que Courbet, Ribot ou Manet. Le ton pur, pour qui la jeune génération ferait bon marché de toutes les autres qualités, est aussi dangereux que l’emploi du «bitume» tant reproché aux peintres de 1830.
L’exposition Whistler à la New Gallery était lumineuse. La délicieuse Miss Alexander, dès le seuil, recevait les visiteurs avec sa grâce de petite princesse espagnole. Je sais peu de toiles plus claires que celle-ci. Les cheveux de l’Enfant fondus comme la croupe des chevreuils de Courbet, les verts de jade et les blancs laiteux de la [p. 112] jupe sont d’une matière inaltérable. Les pigments ne sauraient s’en désagréger et sa pâte unie à la solidité de l’agathe. Quel repos, quelle sobriété, quel goût sûr! Whistler s’est toujours détourné de ce qui est laid et vulgaire. Il comprend ce que la nature permet à l’homme de reproduire avec quelques poudres colorées. Vouloir rivaliser avec le soleil lui semble absurde. Quand le vent souffle d’est et que le Palais de Cristal étincelle, l’artiste ferme les yeux et rentre dans son atelier, a-t-il écrit dans son Ten o’clock. Laissons les naïfs tenter de suggérer l’impression de tel effet qui nous aveugle dans la rue.
Le premier devoir du paysagiste, c’est de planter son chevalet devant le motif dont il y a un tableau à tirer. L’exact rapport entre «le motif» et la toile ou la feuille de papier, entre les outils et les moyens d’expression qui sont à sa portée, Whistler en a, avant tout, l’intuition. Admirable impressionniste, en ce sens qu’il suggère l’impression d’une brume, d’une vague sur la plage, des façades de vieilles maisons; mais n’essaye pas de peindre ce qui est au-dessus du ton où son instrument est accordé.
On m’objectera les jardins de Cremorn, avec ses feux d’artifice. Mais c’est là surtout que sa théorie est compréhensible. Si les roues pyrotechniques y étincellent, c’est qu’elles éclatent dans la nuit. Pour ces seuls tableaux, d’ailleurs, Whistler usa de sa mémoire, regardant longuement, puis, fermant les paupières, redisant à quelques amis chargés de regarder le même spectacle, les détails qui l’en avaient frappé pour les enregistrer de force dans sa mémoire. Les cinq ou six nocturnes—souvenir de Cremorn—sont peut-être la création la plus extraordinaire de la peinture moderne. Jamais l’azur violet de la nuit ne fut exprimé avec autant de profondeur, jamais l’ombre transparente des terrains ne le fut mieux, pas même par Vélasquez dans sa célèbre chasse de la National Gallery.
Whistler n’eut de succès que dans les dernières années de son séjour à Paris. Il avait épousé la veuve de l’architecte Godwin. Le couple, heureux, s’établit 110, rue du Bac, dans un appartement vieillot, donnant sur des jardins de couvents. L’ameublement et la décoration furent les mêmes qu’à Londres. Le maître avait son atelier rue Notre-Dame-des-Champs. Mallarmé lui amena toute la jeunesse littéraire, et ce fut un beau jour que celui où le poète lut sa traduction française du Ten o’clock dans le salon de Mme Eugène Manet (Berthe Morisot).
Je vis très peu Whistler à cette époque, car il était entre les mains d’entrepreneurs de gloire et devenu le favori des petites revues, transformé, n’ayant plus toute sa saveur, dépaysé. J’espère qu’il fut heureux. Mais ce n’est pas ainsi qu’il avait ambitionné de l’être, et les honneurs officiels dont Paris le gratifia étaient bien lourds pour sa fine personne. En tous cas, ce bonheur ne dura pas longtemps.
[p. 114] Je l’aperçus pour la dernière fois, veuf lamentable, brisé, qui errait dans la rue de Paris, à Trouville, pendant la saison des courses. Je n’osai plus lui parler. Je l’avais beaucoup aimé et, j’ose croire, compris. Il ne s’en doutait pas.
Mars 1905
Note.—Mai 1909. Ces notes et ces souvenirs, je les relis quatre ans après les avoir donnés à mon ami Brancovan pour la Renaissance latine, revue qu’il dirigeait alors. Une exposition de l’œuvre de Whistler a eu lieu depuis à l’Ecole des Beaux-Arts. Elle n’a pas même eu les honneurs d’une vive discussion. Cette œuvre d’élégance, de distinction et de demi-teinte fut malmenée par la critique d’avant-garde et laissa la jeunesse artiste indifférente. «Ce n’est que cela?» dit-on un peu partout... C’est que déjà Gauguin était le Dieu du jour et les toiles du peintre américain ne devaient pas passer en vente publique. M. Matisse préparait ses théories. On était prêt à le suivre. Carrière allait mourir et l’on n’osait pas encore le mépriser. Quatre ans se sont écoulés. Whistler et Carrière appartiennent à des temps déjà lointains. Les morts vont vite.
[5] Cette étude fort incomplète du grand homme que fut Watts, je la donne dans des proportions restreintes telle qu’elle parut dans l’Art et les Artistes, m’excusant d’avoir traité si rapidement un si beau sujet.
Prévenons, dès l’abord, le lecteur français, qu’on n’entre pas de plain-pied dans l’œuvre de cet homme colossal. Si vous n’aimez pas les grandes figures plafonnantes qui font lever la tête pour regarder, là-haut, très au-dessus de nous, négligez Watts. Sa gloire, purement nationale, n’a guère encore dépassé la côte argentée de son pays. Il n’en a, d’ailleurs, que plus de saveur et d’originalité. Vous ne trouverez rien de lui chez les marchands de tableaux: il a tout réservé pour l’Angleterre. Ayant eu le bonheur de réaliser presque tous ses projets, il a ramassé dans Londres et donné à la Nation la moitié de son prodigieux Œuvre. Allez voir la National Portrait Gallery; allez à la Tate Gallery (Luxembourg anglais); admirez ses fresques dans le Hall de Lincoln Inn’s Fields au Temple. Mais, si vous négligez de regarder notre cher Baudry, à l’Opéra, si vous réservez toutes vos sympathies pour quelques pommes rouges sur une serviette bleue ou pour les déformations puériles et prétentieuses, il est inutile de prendre contact avec de graves chefs-d’œuvre, qui ne sauront vous convaincre.
[p. 118] Watts est un de ces Anglais italianisants qui de Florence et de Venise rapportent un trésor à quoi ils restent toujours fidèles et retournent souvent puiser. Impossible, penseront nos amis, d’être plus démodé et plus «vieux jeu». Pourtant, je ne vois guère que Rodin, à propos de qui l’on puisse, comme à propos de Watts, citer les plus illustres maîtres de jadis, quand on parle de leurs ouvrages et les y comparer. Ils ont tous les deux le plus noble idéal et disposent des plus sûrs moyens d’expression. Ils sont riches en pensée, classiques, quoique foulant le même sol que nous. Watts et Rodin: un Anglais et un Français d’aujourd’hui, de demain et de toujours.
Esprit d’une rare élévation, lettré, poète, Watts, pendant près d’un siècle, fut lié avec les personnes les plus distinguées du monde entier, entretint un commerce intellectuel avec les génies de l’antiquité grecque et de l’Italie. Il fut peintre, comme on l’était au seizième siècle, comme rien n’empêcherait qu’on le fût encore.
Son exposition posthume, à l’Académie de Londres, formait, quoique incomplète, un musée où l’on ne tardait pas à être saisi d’un respect religieux. Est-il donc possible que nous ayons vécu à côté de ce superbe vieillard qui, récemment encore, travaillait comme Titien et Tintoret, si près de nous? Non pas enfermé dans une impénétrable retraite de maniaque, comme Gustave Moreau, mais toujours en contact avec la vie, portraiturant les jeunes beautés à la mode, comme les écrivains et les savants, avec une activité et une curiosité inlassables. Loin d’être un de ces lourds producteurs, intelligents, mais médiocres ouvriers, comme Boecklin ou Moreau, Watts fut, par un caprice de la nature, un excellent cerveau à la fois et un vrai peintre. Le fait est assez rare pour mériter d’être souligné. Pour indiquer à ceux qui l’ignorent, ce qu’il fut, je dirais: supposez un Elie Delaunay, qui serait génial, fécond, sain, riche et généreux, avec certaines des qualités et la «pâte» qu’on aime dans le Fantin des «Brodeuses». Il eut les qualités qui nous réjouissent [p. 119] chez ces «petits maîtres», plus la fantaisie ailée, l’invention, le style, une science consommée.
On pourrait aussi lui trouver quelque parenté avec Ricard (mais seulement comme portraitiste). Enfin, dans telle étoffe de vêtement, dans tels accessoires ce sont des raffinements inattendus, des délicatesses aussi rares que chez Whistler ou Stevens. Je voudrais pouvoir décrire «Lady Margaret Beaumont, avec sa fille» (1859), dont la robe d’un gris lilas est faite de la matière d’un iris blanc et trente portraits de femmes, dont un seul suffirait à établir une réputation. Mais des pages seraient nécessaires pour choisir équitablement parmi tant de toiles belles ou curieuses.
«Fata Morgana», «Paolo et Francesca», «Le Jugement», «Prométhée», «La Mort couronnant l’Innocence», des centaines de compositions philosophiques ou didactiques, voisinent—sans rien de conventionnel ni d’académique—avec des portraits, parfois héroïques (Tennyson) ou très familiers, documents sans pareils sur la société anglaise au dix-neuvième siècle. Enviable vie d’homme qui s’écoule harmonieusement, à construire une œuvre impérissable, au-dessus de nous, avec des matériaux que nous avons tous à notre portée—sans recettes mystérieuses.
La plupart de ses compositions, a-t-on écrit de lui, doivent être tenues plutôt pour des hiéroglyphes ou des symboles (ce que furent tous les arts à leur origine: n’en va-t-il pas, d’ailleurs, ainsi, de ce qui est au-dessus des conditions purement physiques?). Watts avait la prétention d’enseigner. C’était un moraliste et un idéologue.
Quelque style dont il ait voulu se rapprocher, l’antique, celui du moyen âge, ou tout autre, il y a ajouté le sentiment moderne, excepté dans deux cas: La Foi et Dedication to all churches.—La Foi, attristée par la persécution, lave ses pieds ensanglantés, reconnaissant le pouvoir de l’Amour dans le parfum des belles fleurs, la [p. 120] paix et la joie dans le chant des oiseaux. Le glaive n’est décidément pas le meilleur argument, et elle le rejette.
La mort a beaucoup préoccupé Watts. Il a essayé de la dépeindre comme une amie bienfaisante et secourable. Le soldat, le prince, le mendiant, lui rendent hommage; la maladie repose sa tête sur ses genoux hospitaliers; l’enfant joue ingénument avec le linceul. Un bébé, dans la Cour de la Mort, dort contre le sein de la macabre majesté; le silence et le mystère gardent le seuil du palais.
Dans l’Amour et la Vie, une mince jeune femme, exquise de lignes, est l’emblème de la fragilité humaine, sa faiblesse et sa force, à la fois; l’humanité monte la rude pente, de l’animalité à la spiritualité.
La fameuse Espérance (tableau entièrement bleu), accroupie sur le globe terrestre, pince la dernière corde de sa harpe, pour en tirer la musique la plus intense qu’il se puisse.
Mais nous n’essayerons pas, ici, de donner plus qu’une faible idée d’un cycle philosophique qui se développe, d’un bout à l’autre, avec une rigueur absolue. La place nous manquant, nous effleurons seulement, ne pouvant étudier. Nous aurions à passer en revue les innombrables portraits-bustes, les paysages symboliques (le Retour de la Colombe, etc., etc.) et les toiles d’intimité: telle cette femme assise sur un canapé—qu’on dirait être un Fantin supérieur.—C’est surtout dans la seconde moitié de sa vie, que le maître adopta une sorte de technique dense, empâtée, savoureuse, qu’avait précédée l’usage des glacis.
Nous ne croyons pas que Watts ait eu à lutter avec les difficultés que tant de jeunes artistes ont souvent à surmonter. Ses dispositions exceptionnelles furent aidées par un père et un grand’père clairvoyants. Élève des écoles de l’Académie, dès dix-huit ans, puis du sculpteur Behnes, il débuta par un coup de maître. Comme perfection technique, il ne dépassa jamais l’étonnant Héron blessé. Cette toile peut être mise à côté de n’importe [p. 121] quel chef-d’œuvre hollandais. Après un premier concours pour la décoration du Parlement, en 1843, il alla passer quatre années à Florence chez lord Holland, ministre britannique près de la cour du grand-duc de Toscane. De retour à Londres, il concourut encore pour un panneau à la Chambre des Lords et fut victorieux. C’était Saint George et le Dragon. A partir de 1848, ce fut une succession ininterrompue de tableaux de chevalet et de portraits, dont chacun a une haute signification. Point d’essais, point de tâtonnements, mais une maîtrise qui, quoique s’appuyant sur les écoles d’autrefois, n’en a pas moins un parfum tout frais.
Watts ne fut pas un des membres du «preraphaelite brotherhood». Il marcha, à côté des voies tracées, vers un but qu’il était seul à viser. Il vit tout ce que les arts produisaient autour de lui, sentit avec ses contemporains et avec ses cadets, mais sa pensée plana sur des cimes dont nous sommes désaccoutumés. Quand il lui plut d’être un réaliste, il le fut autant que Courbet: témoin son magnifique attelage de brasseur, aux chevaux plantureux, fumant dans l’atmosphère ambrée de la rue, sous la conduite d’un gars rougeaud, aux vêtements de cuir.
* * *
Je n’oublierai jamais les deux heures que je goûtai, il y a cinq ans, chez le vénérable vieillard. Sa maison de Holland Park n’était qu’ateliers et galeries. Dès l’entrée, on se sentait apaisé, dans la sérénité de l’art pur. C’étaient des salons, pleins de précieux objets, où deux dames, passant comme des ombres, allaient et venaient, occupées à garnir de fleurs des vases et des coupes. Du jardin, dans le goût archaïque anglais, glissait une lumière dorée de fin de belle journée; on apercevait, au travers des petits carreaux aux losanges de plomb, le cavalier héroïque (l’Energie physique), dressé au milieu des allées au sable rouge; Watts modelait encore ce groupe qui est aujourd’hui dans la cour de Burlington House (Academy). [p. 122] Enfin une sorte de moine entra, coiffé d’une calotte écarlate d’enfant de chœur: c’était notre hôte, dont je reconnus le visage si fin; très blanc, mais droit et tel que maintes images me l’avaient montré. Quelle conversation s’engagea aussitôt! Avec les plus jolies façons, des gestes modérés, une voix tremblante et toute frêle, il parlait, évoquant un passé illustre, me racontant des anecdotes sur des Français de naguère, sur la société du duc d’Orléans; puis, apprenant que j’étais peintre, il porta des jugements inattendus sur nos confrères, aussi renseigné sur eux que sur les quatrocentistes. Le maître me montra ses ouvrages de prédilection, les portraits dont il était entouré et une certaine toile, déjà ancienne, dont il repeignait le fond. Il semblait qu’il se crût immortel.
L’œuvre de Watts m’était expliquée. Cet être heureux et fêté, depuis 1817, n’avait vu que les beaux aspects de la vie. Il avait évolué dans les milieux les plus policés, fréquenté les plus hautes intelligences de tous les siècles et pénétré les mythes de toutes les religions. Une telle existence vaut la peine d’être vécue.
Au coin de Cheyne Walk et de la rue qui débouche sur le vieux pont de la Chelsea, une maison à balcons de treillage vert, coiffés de petits toits à la chinoise, se dissimule sous le lierre et les arbustes de son jardinet. C’est là que je veux me rappeler, vivant affairé et endormi, l’artiste délicieux, l’ami parfait que nous venons de perdre. En été, ce coin de la Tamise est inondé de soleil; les fenêtres des demeures riveraines dominent une grande étendue de ce fleuve qui va, quelques milles plus loin, devenir rivière. A Cheyne Walk, le fleuve est encore presque un bras de mer et ses rives sont comme la «Marine Parade» de Brighton, si ce n’est que la circulation assez restreinte de ce quartier retiré rappellerait plutôt une station moins fréquentée que la grande plage de l’Est. Vers midi, en juin, par un temps chaud, comme il y en a si souvent à Londres, arriver chez Conder, c’était comme débarquer aux bains de mer en venant de la Capitale. Joyeux, inoubliables midis, que j’ai goûtés dans le parloir où je peignis le portrait de Conder, alors que la mousseline des rideaux, gonflée par les courants d’air perpétuels, se relevait sur ce paysage grandiose, tout imprégné de sel marin; la tête de mon ami, rouge, mais amaigrie, les cheveux longs, se séparant en baguettes, comme au sortir du tub, se détachait en sombre sur les lambris jaunes que tachaient de noir quelques vieilles gravures en mezzotinte.
[p. 126] Ses doux yeux bleu foncé au travers de la fumée de la cigarette, regardaient vaguement au loin, comme perdus dans un rêve, sans doute quelqu’un de ces sites indiens ou australiens, coloniaux en tous cas, qui étaient le décor habituel de ses hallucinations. Il sentait proches, comme à portée de sa main, là, de l’autre côté du pont, au delà des Océans, ces palais enchantés, ces bayadères, ces fontaines et ces esclaves noirs, dont il avait rapporté de son enfance passée là-bas, l’enivrement. Il «posait» comme une statue, par politesse, s’efforçant de me donner le moins de mal possible, me racontant seulement de sa voix lassée, en mots difficiles à percevoir, des faits sans importance, de soi-disant grossièretés de ses camarades, d’imaginaires manques d’égard, des disputes de sociétés et de clubs artistiques; puis passait à la description d’un meuble aperçu chez le bric-à-brac, d’un nouveau dessin de «Chintz», d’une toilette de femme, de Mlle Adeline Genée, la ballerine de «l’Empire»; ou encore me parlait de la «Fille aux yeux d’or», de son cher Balzac ou d’Anquetin qu’il admirait comme à vingt ans. La cendre de ses cigarettes couvrait le tapis. A chaque repos, il montait à son atelier où il allait barbouiller et détruire en une seconde quelque admirable esquisse jetée sur la toile, dès sept heures du matin; il redescendait tout tremblant, dans cette agitation fiévreuse qui le consumait, parce qu’il sentait sans doute qu’il n’avait plus que peu de mois à vivre; et il avait tant de projets!
A deux heures, un lunch excellent était servi dans la salle à manger, fraîche sous ses voûtes sombres. Il y faisait honneur en véritable ogre, toujours reprochant à Mrs. Conder qu’il n’y eût pas sur la table plus encore de bonnes choses. Walter Sickert ou George Moore entrait, à qui l’on faisait place, et des anecdotes de notre jeunesse nous conduisaient jusqu’à l’instant où, n’y résistant plus, Charles s’élançait au deuxième étage et se remettait à peindre ou à dessiner.
[p. 127] Ce printemps-là, j’avais un atelier à Londres et j’y exécutais des portraits. Pénibles heures de la «Season»: dans la chaleur écrasante d’une vaste pièce sous le toit, des hommes et des femmes, beaucoup trop occupés pour être exacts, entraient, sortaient, amenaient des parents et des amis, prenaient le thé, critiquaient les ressemblances. C’est dans un défilé de ces aimables importuns que Conder dit un soir à ma femme, en regardant le portrait d’une dame avec qui il était lié: «Comment? Jacques fait encore poser Mrs. X?» Et il nommait une personne aussi rose et blonde, que brune et jaune était mon modèle: ma femme est surprise de l’erreur et alors le pauvre garçon répond: «Je me trompe peut-être; ne vous étonnez pas, je ne sais plus toujours bien ce que je dis!...» Il perdait la raison; c’étaient les prodromes de l’horrible maladie où il s’est débattu deux longues années.
* * *
Charles Conder et Aubrey Beardsley sont, dans ma mémoire, comme seraient deux frères. J’avais connu le premier, il y a très longtemps à Paris, mais je l’y avais peu vu, car il sortait surtout la nuit à Montmartre, dans des milieux où je n’étais pas attiré. C’est à Dieppe que nous nous liâmes, le premier été surtout, où Beardsley et sa suite y passèrent. Avant cela, Conder était plutôt, pour moi, un garçon qui s’occupe de bibelots et a de bonnes adresses d’antiquaires; surtout Conder était l’élève d’Anquetin. Pourtant, j’avais été frappé, au premier jury d’examen auquel j’assistai comme membre de la Société Nationale, par des paysages printaniers animés de personnages modernes, à l’allure romantique. Du temps se passa, sans que j’entendisse parler de ce jeune Australien dont j’avais perdu la trace. Nul catalogue d’exposition ne mentionnait plus son nom. J’ignorais ce qu’il était devenu et pourtant il vivait en plein Paris, où si souvent les circonstances séparent ceux qui seraient le mieux faits pour s’entendre.
[p. 128] Or, je fus bien surpris de le retrouver chez les Fritz Thaulow, hébergé, soigné, recueilli comme le serait un petit orphelin, par ces excellentes gens, après une de ses crises. Les deux artistes avaient dû se rapprocher dans «la maison de l’Art Nouveau» chez Bing. Ce japonisant était un peu perdu quand il quittait l’Extrême-Orient pour s’aventurer parmi nos compatriotes et, à tort et à travers, commandait à Maurice Denis, à Besnard, à Cottet, de Feure, Thaulow ou Conder, tableaux, décorations de pièces, tapis ou modèles de meubles. Sa tentative eut le sort réservé aux enfants trop intelligents: elle ne vécut pas. Avouons cependant qu’il y eut à la rue de Provence quelques réussites; l’une des plus remarquables, mais assurément la moins remarquée, fut le boudoir de soie, blanc crémeux, que Charles Conder illustra de capricieuses aquarelles, bordées de franges de perles blanches, d’un exquis raffinement de composition et de couleur, ingénieuse transposition dans une langue moderne, des bergeries, des galants décamérons poudrés du dix-huitième siècle.
Le nom de Watteau fut prononcé (Watteau, pourquoi Watteau?), on cria au pastiche et le frêle ouvrage fut mis de côté comme non avenu. Ces quelques panneaux, achetés ensuite par Mme Thaulow, puis mis en vente à la mort du mari de celle-ci, j’ai maintes fois voulu les faire remarquer par quelqu’un qui construisit un hôtel: personne n’en a voulu. Ils attendent de passer un jour sous le marteau du commissaire-priseur, chez Christie, et d’être couverts de banknotes, quand la gloire de Conder, qui commence à rayonner dans son pays, aura fait de l’original artiste un maître précieux. Les dessins de Beardsley, qu’on ne peut déjà plus se procurer, à quelque prix que ce soit, ne sont pas d’une qualité plus rare que les aquarelles de Conder, dont il subit si fort l’influence; il n’avait pas, d’Aubrey, la sûreté de main et le fini; mais son art est bien plus naturel, plus varié, plus sain.
[p. 129] Cette œuvre est considérable comme nombre. Peintures à l’huile (les plus imparfaites de son bagage), peintures sur soie, éventails (il y excella), pastels, sanguines, lithographies (illustrations pour un Balzac), châles, robes peintes, meubles, décorations de chambres entières (maisons de Edmond Davis Esq., de Mrs. Halford, etc., etc.), je ne sais où cette œuvre s’est répandue dans les cinq dernières années où mon ami travaillait jour et nuit, dans une sorte de rage inconsciente, remplissant ses énormes armoires de projets, de croquis, dont pas un n’est banal ni insignifiant.
Ses éventails sont presque tous des chefs-d’œuvre. A quoi pourrais-je les comparer? nullement aux éventails français du dix-huitième siècle. Le style de Conder est purement anglais. Le côté ornemental rappellerait les festons et les astragales des frères Adam, ces artistes de génie classique et grec qui renouvelèrent l’art décoratif de l’autre côté de la Manche et l’anoblirent. La couleur, de multiples harmonies, si osées dans la douceur, je ne les ai vues que chez Conder. Celui-ci a, comme tant de ses compatriotes, une maladresse dans la construction du corps humain, un «tremblé» dont le moindre artisan français aurait souri; cependant, la forme a du style, une étrange originalité, on reconnaîtrait cette écriture entre mille. Cette forme est, avant tout, du dessin senti, nerveux dans sa faiblesse, comme celle d’un Constantin Guys ou, dirais-je, d’un Goya. Il faut s’entendre sur le sens de ce mot «dessin». La «forme» est l’opposé de ce que nomment dessin, les braves gens pour qui Bouguereau fut un dessinateur. Les incorrections d’un Goya, d’un Manet, même de l’ingénu Cézanne, sont de la forme. Je ne veux pas dire que la déformation systématique des néo-impressionnistes et des symbolistes soit seule du dessin, car je suis convaincu du contraire: mais une déformation nécessaire, à quoi, sans s’en rendre compte, le peintre est toujours conduit, en face de la Nature: la déformation qui est la vision et le dialecte d’un individu, [p. 130] voilà ce qui, presque toujours, est, sinon beau, du moins intéressant; et c’est souvent le style.
Donc Charles Conder eut cette qualité si rare. Elle ne fut pas perçue par nos critiques d’avant-garde, dont le pauvre garçon attendait toujours les suffrages, étonné de ce que la redingote de M. Charles Morice ne se déboutonnât pas en un grand geste de sympathie pour lui et de n’avoir pas les honneurs d’un paragraphe louangeur dans le Mercure de France auquel il attribuait une grande importance, assez plaisamment d’ailleurs. Conder ne démêla jamais les raisons pour lesquelles il n’était pas reçu à Paris dans le milieu «avancé» où l’attiraient ses sympathies, où il avait sa place. Son exposition tenue chez Durand-Ruel, il y a quatre ans, et pour le catalogue de laquelle il m’avait imprudemment demandé une préface, fut sa dernière manifestation publique dans son «dear old Paris», et le signal de ses premiers troubles cérébraux. Cet échec le désola. Ensuite, de son subit et retentissant succès à Londres, il se rendit à peine compte, car les applaudissements s’adressaient alors à un égaré.
Étrange personnalité que celle du jeune Australien; il fut bizarre et déréglé jusqu’à la fin, malgré son amour pour le travail; mais ses excentricités, selon la coutume anglaise, plaideront plus en sa faveur que n’aurait fait une existence normale. On voit déjà comment sa légende se façonnera. Dès aujourd’hui, il est classé dans la phalange des «hors la loi», des «outcast», pour lesquels ses compatriotes ont une inclination toute romantique. Quoique la Mort ait arrêté sa carrière à l’âge de tantôt quarante ans, il est, à côté d’Aubrey Beardsley, une sorte d’enfant prodige malade, mais sans la poétique agonie de cet adolescent poitrinaire qu’a touché la Foi; il fut suffisamment désordonné, pour que son joli génie enchante des amateurs de l’exceptionnel et du cocasse.
Jusqu’à son heureux mariage avec la femme tendre et dévouée qui mit sa fortune à la disposition de Conder, celui-ci fut, tant à Paris qu’à Londres, une sorte de [p. 131] Verlaine, un irrégulier, passant de l’état d’ébriété à l’état lucide, comme du sommeil à la veille, ne travaillant jamais avec plus d’inspiration que s’il était excité par l’alcool. Je ne saurais retracer ses pérégrinations dans les divers quartiers des deux grandes cités, où il connut la misère et l’abandon, lui qui attachait tant de prix à toutes les raretés d’un joli intérieur et à l’élégance de ses habits. Il était fait pour un siècle enrubanné, galant—et je ne puis m’empêcher de me l’imaginer soupirant une sérénade sous la fenêtre de sa belle, coiffé du béret à la Watteau et la cape striée sur l’épaule.
Je viens d’assister, dans son quartier de Chelsea, à une de ces mascarades qu’il savait si bien monter et je ne pouvais détacher ma pensée de Conder, pendant qu’un orchestre d’instruments à vent accompagnait des Cydalises et des Corisandes. Jamais la fiévreuse musique de Gabriel Fauré ne me parut plus passionnée qu’ainsi mise en action sous les guirlandes de fleurs, parmi les jets d’eau et les bosquets qu’éclairait la pleine lune de juin. Le ciel de minuit, toujours si pur à Londres, même après une journée brumeuse, dressait une coupole bleu sombre sur les murs des «mews» et des maisons dont le jardin est encadré. Quelques vieux camarades de Conder et moi, nous étions émus en écoutant le flûtiste Fleury jouer en plein air, retirés comme nous l’étions dans un salon où nous avaient attirés des éventails de notre ami. Nous le sentions présent, il aurait dû être là, parmi ceux de l’orchestre ou du chœur, tous comme sortis de la Galerie Lacaze.
Les personnages de la Comédie Italienne, de Molière et de Balzac, tous un peu confondus dans le kaléidoscope de son cerveau, un mélange de l’époque de Louis XV et de 1830; un joli bric-à-brac de chaises à porteur, de berlines, de cabinets de laque Vénitien rococo; des gondoles, des portiques de treillages, des rideaux de Quinze-seize contorsionnés «par Zéphir»; tels sont les modèles et les accessoires qui reviennent sans cesse, dans l’œuvre [p. 132] de Conder, où le chapeau de Rastignac s’aplatit presque en tricorne, où la souquenille du valet poudré a presque les mêmes pans que la rheingrave de la Restauration. Postillons au fouet claquant, facchini, soubrettes, jeunes seigneurs courtisant une almée à la Coypel, nègres au turban empenné, fifres et tambours, vous êtes tous les invités au bal d’Esther, dans la Chaussée-d’Antin, et vous êtes les favoris de Charles Conder.
La maison de Cheyne Walk, Conder l’avait achetée et il y avait entassé tous les objets pittoresques, les vieux tableaux et les meubles dont il aimait à faire un décor riant à sa vie de labeur. Certaines pièces de cette vieillotte demeure étaient, réalisées et vécues, les aquarelles mêmes du maître de céans. Un sens des couleurs acides et criant fort animait ces vieux lambris, ces chambres foncées que les après-midi brumeuses de l’hiver obscurcissent encore. Un salon bleu, tout miroitant de satins drapés et de glaces vénitiennes, était dédié à ses dieux: Watteau et Whistler.
* * *
L’apogée de la vie du cher artiste, ce fut la redoute qu’il donna pendant le carnaval de 1904. J’eus le regret de ne pas y être; mais on me dit que cette fête, dont le thème était une mise en action de «The Rape of the Lock» de Beardsley, fut une réussite extraordinaire. Chacun de ses admirateurs s’était imposé d’y venir dans un équipage qui plût à Conder et le souper, au matin, réunit sous les guirlandes du plafond et les arcs de «treillis» la plupart des jeunes peintres, musiciens et littérateurs pour qui l’amphitryon était alors devenu un maître.
On était loin, déjà, des jours de lutte où Conder, à Dieppe, chez Thaulow, payait l’hospitalité reçue, en brossant sur le gros coutil des sièges et de lourdes portières, des compositions délicates ou robustes, mièvres ou un peu théâtrales, improvisations charmantes d’un décor à [p. 133] bon marché; et, dans le jardin de la villa, dessinant des parterres ou accrochant aux arbres des grappes de lanternes en papier, dont la lueur n’éclaira que les tristes repas où Conder, après l’une de ses premières attaques, misérable, s’attablait auprès d’Oscar Wilde, tragique à sa sortie de prison.
A ce moment-là, j’avais redouté que Conder ne glissât sur la pente fatale comme le pauvre Lélian, vers des bas-fonds que son génie illuminait fantastiquement. La maladie déjà avait saisi son corps surmené. Mais la généreuse Mme Thaulow et son enthousiaste Fritz étaient là, prêts à secourir, à protéger tous ceux qui étaient des «artistes». Wilde, réfugié à Berneval, près Dieppe, venait clandestinement se réchauffer à leur foyer, contant certaines de ses belles histoires symboliques, dans un cercle de petits enfants qui l’écoutaient bouche béante. Conder suivait un régime réconfortant et, enfermé dans la villa de Caude-Côte, reprenait des forces. Je me le rappelle un jour quand j’entrai, agenouillé aux pieds de notre hôtesse dans une attitude que je ne m’expliquai pas au premier abord; et la dame, le dominant de toute sa stature de cariatide, était vêtue d’une étrange robe: Conder essayait sur elle une draperie de sa façon qu’il avait agrémentée de médaillons, de rinceaux, dont la finesse est plus de mise pour un dessus de bonbonnière, que pour les formes plantureuses d’une Walkyrie scandinave.
Mon ami me parlait souvent de Miss X... qu’il croyait à Paris et dont il comptait faire son épouse. J’avoue que dans ces inquiétants jours de Dieppe j’écoutais avec mélancolie les projets du malade. Pourtant, il devait rebondir encore une fois, se marier et connaître, pour de trop courts instants, mais en jouir pleinement aussi, la sécurité et une totale liberté de réaliser ses rêves de peintre et d’amateur. Il connut, enfin, le succès.
Aubrey Beardsley, Oscar Wilde, Charles Conder, Dowson, Arthur Symons, ces protagonistes du Yellow [p. 134] Book et du Savoy, sont aujourd’hui tous disparus, après avoir, chacun dans son genre, accompli une œuvre originale: bien différents les uns des autres, une parenté artistique les a unis. Ils eurent tous le culte et l’intelligence de l’esprit français, entendirent notre langue que Whistler leur apprit à aimer. Ils forment une petite phalange indissolublement liée dans la mémoire et la reconnaissance de ceux d’entre nous qui fréquentèrent assidûment l’Angleterre dans les dernières années du dix-neuvième siècle. Le mouvement littéraire et musical, la peinture, enfin tout ce qu’il y eut de plus significatif et de plus neuf chez nous, trouva en eux des cerveaux pleins de réceptivité et des voix enthousiastes pour nous célébrer.
J’aurais voulu ajouter ici un portrait de l’un des plus doués d’entre eux, de mon vieil ami Walter Sickert, l’admirable peintre de paysages urbains et des music-halls; mais heureusement, il est encore parmi nous, bien vivant, et je me suis imposé le devoir de ne parler que des disparus.
[6] J’aurais voulu faire à nouveau un portrait d’Aubrey Beardsley pour qu’il rentrât dans le cadre de ce volume; mais le temps m’a fait défaut et je donne ici la préface écrite en 1907 pour la traduction de Under the Hill que me demandèrent les éditeurs, Arthur Herbert, Ltd, de Bruges. Je n’y change rien.
Peut-être a-t-on agi avec prudence en ne traduisant pas plus tôt l’œuvrette que voici. Avant que la gloire ne vînt fixer le nom d’Aubrey Beardsley dans la mémoire de tous, il eût semblé aventureux de livrer au grand public, et privé surtout de ses grâces originales, l’essai qu’est Sous la Colline. Cet essai vaut par le style, autant, sinon plus, que par la pensée. Qu’est-ce que l’auteur a prétendu dire? quel est l’apport personnel de son génie? Voilà ce que je ne me chargerai pas de démêler, car Aubrey Beardsley reste pour moi l’artiste étrange et fort, l’intelligence merveilleuse, l’enfant prodige que j’eus la joie de connaître pendant deux ans et qui m’a tellement ébloui, que je craindrais de le diminuer à mes propres yeux en me livrant à une analyse trop rigoureuse. Deux ans: bien court laps de temps dans une vie normale d’homme; mais, dans la sienne, suffisant pour que j’aie l’illusion d’avoir assisté à une longue existence, et à la plus intéressante. On a vu, dans Under the Hill, une manière de paraphrase de Tannhaüser, spirituelle et légère, de ce caprice très anglais, qui renouvelle les plus anciens sujets en les assaisonnant d’un piment moderne, en les [p. 138] dépaysant si l’on peut dire ou mieux, en ne les situant pas. Le petit abbé Fanfreluche et la belle Hélène n’appartiennent qu’à Aubrey.
C’est l’atmosphère dans laquelle on place une œuvre, qui la distingue des autres, et c’est surtout la Technique, ou le Style. Beardsley, dessinateur, eut une technique presque parfaite;—écrivain, il aurait peut-être atteint une égale perfection. Dans ce conte, il n’est encore qu’un amateur charmant, plein de projets et de recherches ambitieuses, mais un amateur, à la veille de passer maître ouvrier.
Il siérait de prendre Sous la Colline, pour une boutade, sans commencement ni fin, presque pour des notes jetées par un débutant, qui croit à la forme et cisèle des phrases, sans grand souci de les coordonner. J’en ai entendu beaucoup dites par lui à moi-même, alors qu’il venait de les griffonner sur une table de café, au Casino de Dieppe. Il en riait, ou il en était heureux et fier, comme un collégien qui a trouvé une belle rime. Dans sa prose, on découvre le même procédé, les mêmes trilles, les mêmes vocalises perlées, que dans ses dessins aux entrelacs précieusement compliqués. Nous aimons cela dans son œuvre plastique; nous l’aimons aussi dans sa prose, malgré qu’il n’ait pu l’amener au même degré de fini que son dessin. Ne cherchez pas, je vous en prie, une signification profonde, cachée sous ces mots, qu’un délicat a enfilés les uns aux autres, comme des pierreries multicolores sur un fil d’argent; plaisir des yeux, presque; plaisir de musicien aussi, car les harmonies pures ou bizarres le captivent comme les couleurs. Beardsley est un dilettante. Tout ce qui est beau le retient; et aussi une certaine laideur, dont il a fait de la beauté.
Il est un vrai produit de fin de siècle. Le tourmenté, le faisandé, le malsain de son art, me repousseraient peut-être autant qu’ils attirent les autres, si le hasard ne m’eût mis à même de nouer des relations amicales avec [p. 139] cet homme de grande intelligence, de solide culture, de goût si sûr et si varié.
Ce qui me touche par-dessus tout chez Beardsley, écrivain, c’est son amour de la langue française, qu’il ne parlait pas volontiers, bien qu’elle eût peu de secrets pour lui. Il rêvait d’incorporer à sa langue certains de nos mots dont la sonorité l’enchantait, au cours de ses lectures quotidiennes. Comment est-il parvenu à se faire l’éducation dont il donnait la preuve, le plus simplement du monde, dans la conversation en français? Le culte de l’article de Paris, la connaissance superficielle des choses de chez nous, qui nous touchent chez les Étrangers, par la bonne volonté dont ils témoignent, et nous irritent aussi parfois un peu, Aubrey les dépassa bien vite. Le Courrier français, auquel il collabora et où il réussit du premier coup, représente assez cette fantaisie montmartroise dont la mousse enivre les cerveaux des Américains, des Anglais et des Allemands, dont regorgent nos ateliers de peinture. Il n’y fut pas insensible, mais son flair et sa lucidité lui ouvrirent de plus lointaines perspectives et, comme il n’aurait pu se contenter de si peu, s’étant mis avec sa sœur Mabel à lire du français, ils allèrent tous deux, bien vite, au meilleur et au plus difficile.
Ai-je jamais entendu un de mes compatriotes parler de Molière et de Racine comme lui? Racine surtout qui reste fermé à la plupart, il le savait par cœur, et il récitait les chœurs d’Athalie et d’Esther comme des prières. Il vivait dans le dix-septième et dans le dix-huitième siècles. On sait qu’il songea à traduire les Confessions, à faire un ouvrage sur Jean-Jacques et un essai sur les Liaisons dangereuses. George Sand, Chateaubriand, Balzac, il les étudia à fond. Pour Balzac, il avait une passion et, les personnages de ses romans, Aubrey les connaissait comme des membres de sa famille. Je n’oublierai jamais des après-midi passées dans la chambre où Charles Conder exécutait ses ingénieuses lithographies pour la Fille [p. 140] aux yeux d’or. Celui-ci voyait en Dieppe un décor pour tous les actes de la Comédie humaine; il n’était alors question que de Balzac; et pour ce petit monde, gêné pour désigner un objet dans un magasin, Balzac était discuté comme il aurait pu l’être dans un cénacle de lettrés français. Gautier, Baudelaire, Verlaine n’eurent pas de plus fervent adorateur que Beardsley. La Dame aux Camélias prenait à ses yeux de malade une importance toute particulière. Il l’enveloppait de je ne sais quelle prestigieuse poésie; il n’eut de cesse que je le menasse chez Alexandre Dumas, à Puys. Inénarrable visite, où le romancier fut vite conquis par le charme juvénile du dessinateur, dont je traduisais, au cours de l’entretien, les questions et les délicats compliments. Mrs. Mabel Wright doit avoir encore sur quelque rayon de sa bibliothèque, le volume de la Dame aux Camélias, que Dumas offrit à son frère avec une belle dédicace.
Mais, me voici tenté de conter mes souvenirs, et, pour cela je suis assez embarrassé.
En effet, c’est une préface qu’on m’a fait l’honneur de me demander; quand j’en fus averti, je commençai par m’en réjouir; puis, je réfléchis qu’une préface pour Under the Hill serait une entreprise au-dessus de mes forces. Alors, puisque l’on m’assurait que tout ce que je savais de Beardsley méritait d’être dit, je mis ma mémoire à contribution.
Des souvenirs surgirent en foule et, pendant quelques jours, je revécus par la pensée avec le cher garçon dont j’avais fait la connaissance deux ans avant sa mort, déjà atteint du terrible mal auquel il allait succomber, mais encore fiévreusement passionné et brillant, dans ses heures de répit. J’évoquais les journées de flânerie et de travail à mes côtés, les bavardages sans fin que nous avions ensemble, le matin, sur la plage, au milieu des baigneurs, l’après-midi en arpentant les pelouses de la rue Aguado et à l’Hôtel des Étrangers, où sa mère, bonne et tendrement inquiète, l’attendait toujours, le [p. 141] regardait en frémissant quand nous rentrions d’une promenade trop fatigante.
J’avais déjà rédigé ces souvenirs, quand je repris le livre d’Arthur Symons consacré à mon ami et je constatai que je ne faisais que répéter des choses si bien dites avant moi; en effet, nous passâmes, tous les deux, l’été de 1895 à Dieppe, en compagnie de Beardsley. Nous le voyions à chaque instant; une perpétuelle agitation et la terreur de la solitude lui faisaient saisir le moindre prétexte pour abandonner ses dessins. Il venait nous chercher, ou nous le rencontrions au dehors, portant sous son bras la vieille reliure Louis XIV de maroquin rouge à fers dorés, qui lui servait d’enveloppe pour ses notes écrites. Symons et moi, nous étions ses auditeurs attentifs, nous recueillions ses boutades et ses paradoxes. Peut-être, en ma qualité de Français, ai-je été plus touché que Symons par l’étrangeté du personnage; peut-être m’apparut-elle plus exceptionnelle, cette excentricité anglo-saxonne, si habitué que je sois à l’humeur britannique. Le décor de notre vieille ville normande, si provinciale, en dépit de son Casino et de ses bains cosmopolites, où je vis passer tant de curieuses figures, depuis trente ans; la lumière de cet endroit où s’écoulèrent toutes mes vacances de Parisien, mettaient en un vif relief la silhouette du fin artiste, de cet élégant et anguleux dandy, encore tout imprégné de l’âcre odeur de Londres.
Son visage émacié présentait un nez très busqué et très osseux entre deux petits yeux perçants, couleur de noisette, sous des cheveux de ce blond-acajou, dit «auburn», que séparait en bandeaux, sur un front bombé, une raie soigneusement faite. Toujours vêtu, le jour, d’un costume gris clair, une fleur à la boutonnière, ganté, il tenait verticalement, par le milieu, une grosse canne de jonc, dont il frappait le sol pour scander ses phrases et accompagner ses mots. Il avait infiniment d’esprit, un langage recherché et les plus gracieuses façons du monde. Un peu voûté, il tâchait de redresser [p. 142] sa haute taille, dans un perpétuel effort de ne pas paraître malade. La maladie lui faisait horreur et, dès que le sourire retombait, son expression devenait sauvagement douloureuse. A la moindre brise, il s’enveloppait d’un plaid de voyage ou dans un mac-farlane, dont les ailes gonflées par le vent du large, le faisaient ressembler à une énorme chauve-souris.
Beardsley vint sonner à ma porte, accompagné par des amis qui ont déjà presque tous disparu, et dont certains—lui le premier—auraient à peine atteint à la maturité aujourd’hui. Et cela semble si loin dans le passé!
Le bon géant Fritz Thaulow—mort lui aussi—vivait à Dieppe avec son heureuse et noble famille. Il ouvrait, très hospitalier, sa maison à tous les artistes qui passaient. Thaulow et Charles Conder me présentèrent un petit groupe d’Anglais qu’un même bateau avait amenés. C’était le poète Alfred Dowson, bohème à la Verlaine, qui fut vite enlevé, après avoir signé de beaux vers; c’était Arthur Symons et quelques autres, suivis de l’éditeur Smithers, à l’éternel gibus, et flanqué d’une demoiselle de bar, ensevelie sous un immense chapeau à plumes. On aurait dit d’une société venue sur le continent pour une Bank Holyday. C’étaient pourtant les rédacteurs et les principaux artistes du magazine Savoy, dont j’attendais avec impatience chaque nouveau fascicule, à la couverture rose et parée d’un dessin pointillé d’Aubrey Beardsley. Ces jeunes gens s’ingéniaient à scandaliser leur pays et n’auraient reculé devant rien pour se signaler, à une intéressante époque de l’histoire artistique et littéraire de l’Angleterre; retenons cette date: 1896. Le long règne de la pieuse et sévère Victoria, Impératrice des Indes, déclinait. Burne-Jones venait d’être fait baronnet; Whistler commençait d’être sacré grand peintre, après ses batailles livrées à la Grosvenor Gallery, où les Indépendants et les snobs s’allaient pâmer devant toute œuvre refusée à la Royal Academy. C’est alors qu’Oscar Wilde, triomphant, se promène dans Piccadilly, [p. 143] un grand tournesol à la main. Les opéras de Wagner sont donnés dans deux théâtres à la fois, où se presse, religieusement silencieux, ce public d’esthètes, si bien croqués par Aubrey Beardsley dans une de ses fameuses planches: Wagnerites. Sarah Bernhardt et Réjane jouent des pièces françaises; George Moore célèbre Manet, Degas, Zola et Goncourt. Le seul nom de Balzac gonfle la gorge de ceux-là même qui n’ont rien lu de lui; William Morris, poète, sociologue et tapissier, poursuit de sa haine l’acajou victorien et met à la portée du bourgeois un ameublement moyen-âgeux, dans le goût des préraphaélites.
La société anglaise se réveille d’un long sommeil et secoue son indifférence pour tout ce qui n’est pas le sport. Un nouveau snobisme va la jeter dans les bras des artistes; elle attend quelque chose et se prépare à s’amuser d’autre façon. Dans cette atmosphère surchauffée, parmi les révoltés et les novateurs, voici venir le jeune Beardsley. Il s’avance d’un pas mesuré; il va, élégant et fluet, allonger subrepticement un coup de pied dans les vitres de Buckingham Palace, d’où la vieille souveraine observe et condamne ses sujets. On sait que sa majestueuse indulgence est réservée pour les Philistins. Voici Beardsley, grave et ironique à la fois, tenant au-dessus de sa tête de magnifiques plats chargés de paons, de rares poissons et de fruits exotiques. Des parfums énervants fument dans des cassolettes. En cadence, comme quelque personnage d’un conte d’Henri de Régnier, il présente en une sorte d’entrée de ballet, mille objets bizarres, qu’on dirait tirés du fourgon des rois mages. Ses mets sont composites, à l’arôme inquiétant: le chef qui en prépare les sauces et en dressa la parure, dédaigne la classique cuisson des rôtis nationaux.
Beardsley va rénover la fantaisie anglaise, cruelle et poétique, froide et qui dissimule ses émotions, si elle en a; il est ironique, gouailleur, et poète à la façon du [p. 144] clown shakespearien; sceptique, exubérant tour à tour et retenu; surtout amer, jusque dans ses éclats de gaîté.
Ma pensée se plaît à l’associer à un autre de mes amis très regretté et qui me fut si cher, au candide et charmant Jules Laforgue, que je vis, dix ans plus tôt, passer, toussant lui aussi, et blême comme ce Pierrot qu’ils aimèrent tous les deux. L’humour de Under the Hill reçoit comme un reflet des Moralités Légendaires. J’imagine ces deux jeunes malades se rencontrant dans la nuit élyséenne, se saluer cérémonieusement, danser un grave menuet dans un rayon pâle de la lune, puis s’évanouir comme deux ombres...
Ils avaient beaucoup regardé et beaucoup ri tous les deux, pendant leur vie terrestre, et si la mort n’avait pas si vite jeté son dévolu sur ces deux frêles proies, l’un ne serait pas devenu le chrétien, ni l’autre le chimérique amoureux qu’ils se montrèrent, avant de nous quitter. Ils demeureront comme le produit, très marqué, de la civilisation, dans deux grandes capitales à la fin du dix-neuvième siècle. Laforgue, quoique provincial du Midi, incarne le gavroche parisien, de l’heure inquiète qu’il vécut. Quant à Beardsley, il fut le gamin de Londres, le vrai cockney, au rire bref et qui retombe dans une morne tristesse, après les bonds de sa morbide gaîté.
On ne peut dire de lui: «Il n’eut pas le temps de s’exprimer; que serait-il devenu?» En quelques années, il les avait comptées, il donna hâtivement, mais avec méthode, tout ce qu’il avait en lui. Heureux, ceux qui, dans ce temps de fébrile course au clocher, savent tôt se fixer et entrevoient, dès leurs débuts, l’arabesque qu’ils auront à tracer. L’enfant prodigue des soirées de Brighton, le petit pianiste faiseur de Christmas cards et de Menus pour les dîners, trouve à quinze ans sa formule. Indiquons—rapidement, puisque M. de Montesquiou y insista avec ingéniosité et éclat,—les influences qu’il subit et rappelons ce que Burne-Jones proposa à son admiration, tant qu’il l’eut pour élève. Une vision, toute [p. 145] anglaise, de l’antiquité classique, de la Renaissance italienne, des estampes japonaises et des dessins du dix-huitième siècle français; et un sens très aigu du grotesque moderne: voilà ce dont Beardsley fait preuve, dans ses compositions. Il ne représente pas avec fidélité ses contemporains; au contraire, il les déforme, les habille à l’antique; les dévêt ou les pare d’atours empruntés; mais leurs gestes sont d’aujourd’hui. S’ils parlaient, leur parler serait le nôtre. Les salles bizarres et les jardins fantastiques où ils minaudent, donnent sur la rue bruyante de hansom cabs et d’omnibus roulants. Ses dessins sont des affiches toutes prêtes à être agrandies pour les murs de Londres. Malgré tous les paraphes et la complication calligraphique dont il l’enveloppe, son écriture, même de loin, reste lisible; le graveur héraldique et l’imagier médiéval prêtent leur art exact au caprice du jeune décadent, à l’irrespectueux satiriste. Il n’est pas peintre: il est maître en blanc et noir; c’est pour l’imprimerie qu’il travaille. L’illustration et l’affiche ne sont-elles pas l’Art même de ce temps?
Beardsley ne fit pas de peinture à l’huile, mais projetait sans cesse d’en faire. Un jour, le voyant tenté par ma boîte à couleurs, je le laissai seul dans l’atelier du Bas-Fort-blanc dont la baie s’ouvre sur les rochers où les enfants pêchent la crevette. L’après-midi d’août était glorieux. Je pars en promenade. Quand je rentrai, la grande toile mise à sa disposition était couverte d’un très beau dessin au fusain qu’il ne colora jamais, mais que je ne puis me consoler d’avoir vu effacer d’un coup de gant. C’était un épisode rapporté par George Sand: Liszt, marchant dans la campagne, s’enfonce dans un champ de pavots dont les têtes sont pour lui autant d’instrumentistes. Le musicien inspiré, brandit sa canne, comme un bâton de Kapellmeister, et bat la mesure, croyant conduire un orchestre innombrable.
Le mouvement du personnage, coiffé d’un feutre mou, ses longs cheveux bouclés, était d’un geste superbe; [p. 146] mais le bâton menait une symphonie macabre et l’on eût dit qu’il voulait plutôt faucher ces têtes aux corolles agitées. Tout ce que faisait Beardsley exhalait l’odeur de la mort.
Je ne le connus qu’affaibli et se préparant à prendre congé de nous. Implorait-il avec résignation le Crucifix qu’avait mis, entre ses doigts fiévreux, le prêtre catholique? Espérons que la Foi rendit moins déchirantes ses rêveries de jeune condamné, à la porte du cimetière.
Je le surpris souvent penché sur sa table, dessinant dans sa chambre d’hôtel; il était rentré las de ses allées et venues sur la terrasse du Casino. Grisé des flonflons du bal et du bruit des Petits chevaux, dans lequel Under the Hill fut presque en entier écrit, il revenait sagement à son ouvrage. Travail appliqué, minutieux, sans ratures, conduit comme celui d’un moine enluminant une page de missel. Ainsi courbé sur la feuille de papier bristol, les petites plumes d’or, les grattoirs rangés avec ordre, il accomplissait une sorte de pieuse tâche, sous le regard du Christ en croix, accroché au mur devant lui. Ce nouveau Tannhaüser, on serait tenté de le croire, était obsédé par des visions du Vénusberg et les cuivres de la bacchanale, qui vibraient parfois dans ses oreilles. Il y a comme la déformation d’une cagoule de frère de la Miséricorde, dans certains de ses personnages ambigus, mi-Arlequin, mi-Carlin, qu’il faisait rôder dans ses mascarades et qui y répandent une odeur de mort. Tous ces personnages sont enfants de son cerveau ou comme autant de doubles de sa personne.
Même malade, ainsi qu’il était en 1895, et tenaillé par l’effroi du lendemain, son imagination d’illustrateur était follement libertine, hantée de monstres aux gestes douteux, qui offrent au public toute liberté de malveillante interprétation. Nous sommes loin de ses légères vignettes pour la Mort d’Arthur. Son premier public fut sans doute très peu naïf, car il attribua un sens obscène aux moindres détails des dessins parus dans le [p. 147] Savoy et dans le Yellow Book, même aux fleurs de la si curieuse Madone, peut-être le chef-d’œuvre de Beardsley. On contait tant de choses sur sa vie factice et il s’était volontairement créé une telle réputation d’excentrique et de blasphémateur, qu’on le voyait toujours plus ou moins célébrer une messe noire. Je ne me sentis jamais très à l’aise entre ce que je devinais de ses rêves païens et ses sentiments pieux de jeune catéchumène, entre l’artiste et l’homme; d’autant qu’il ne s’expliquait pas sur ce point et demeurait plein de retenue.
Il y eut, à la fin du dix-neuvième siècle, beaucoup de conversions, à Londres. Ce fut une mode et un engouement parmi les gens cultivés d’embrasser le catholicisme, au moment où s’achevait la surprenante cathédrale byzantine, le plus bel édifice moderne de la ville, sinon la plus belle église élevée de nos jours; théâtrale, sombre, pleine d’encens et d’une mise en scène émouvante. Elle attirait ceux que le culte protestant rebute par sa froideur. Parsifal, Amfortas et la repentante ensorceleuse Kundry, semblaient se cacher derrière les piliers de la nef, près de ces fidèles britanniques, pour qui il n’est guère de plaisir sans que l’âme du Pasteur ne rôde dans la ruelle du lit comme une menace. Aubrey devait venir bientôt tremper son doigt dans le bénitier de la basilique au retour de ses randonnées nocturnes.
Si l’on établit sans difficultés les parentés artistiques d’Aubrey Beardsley, l’homme et l’écrivain qu’il souhaita d’être, et qu’il laissa seulement entrevoir, sont plus complexes. Il fut un pur «cérébral» et, comme tel, un des plus accentués entre les jeunes hommes de sa sceptique et raisonneuse génération; avide de jouir (trait commun à tous les Anglais d’aujourd’hui), sans respect et n’arrêtant son froid regard que sur les aspects brillants ou comiquement grotesques des gens et des choses. La pitié n’était pas son fait; mais il faut attribuer à son état physique une part de son égoïsme. Il était personnel, et cela, d’une façon presque touchante, tant il y avait [p. 148] de l’enfant malade chez lui. Je me rappelle qu’il disait: «Ce dont j’aurais besoin, ce serait d’une bonne nourrice qui me dorloterait.» Et il avait pourtant avec lui son excellente mère et sa sœur Mabel, l’ex-compagne de ses heures de joies, alors toutes tendues vers ses caprices et s’ingéniant à rendre sa longue agonie plus douce. Les dernières fois que je le vis, encore plus creusé et plus faible, il ne pouvait plus se supporter lui-même.
Je rejoignis Aubrey dans l’automne de 97, à Paris, avant son départ pour le midi où il devait hiverner. Il était descendu à l’hôtel Foyot, au milieu du quartier Latin dont il était si curieux. Nous dînions parfois ensemble, dans le restaurant. Les lumières et les conversations de nos voisins de table lui communiquaient une passagère excitation, à peine suffisante pour chasser, pendant quelques instants, ses lugubres visions de mort. Il tenait alors les propos, qui m’aidèrent le mieux à le comprendre.—C’est un écrivain, surtout, qu’il ambitionnait d’être et c’était là, chez lui, une sorte de coquetterie, presque une manie. Sa passion pour l’art français du dix-huitième siècle, était alors dans toute son intensité, et l’influence de notre littérature le dominait complètement. Notons que les meilleurs artistes anglais, depuis un quart de siècle, ont subi l’influence française, comme nos romantiques de 1830, celle de l’Angleterre.
Aubrey, ne pouvant plus supporter le climat de son pays, venait donc à Paris, comme il aurait souhaité d’y venir à ses débuts. Si les bouquinistes des quais de la Seine le requéraient, les plaisirs auxquels il ne prenait pas part, mais qu’il devinait autour de lui, lui donnaient l’illusion de l’activité et de la vie. Il me fit part de tous ses projets d’écrivain. Chaque jour, c’était un nouvel ouvrage dont il établissait le plan. Des phrases détachées, d’abord, des mots d’esprit, comme les motifs qu’un musicien note avant de composer une partition. Les sujets? ils avaient beaucoup d’analogie avec ceux des Moralités Légendaires et, sachant qu’il ne connaissait [p. 149] pas Laforgue, je m’interdisais de les lui signaler. Si charmant et bon ami qu’il fût, si affectueux dans ses rapports avec nous, je dois avouer qu’il y avait un manque absolu de tendresse et d’émotion dans les belles histoires qu’il voulait conter; je n’y distinguai jamais une philosophie, une morale—et pourtant l’heure avait sonné pour lui des réflexions graves—. Même dans ses livres, il est probable qu’il eût été un pur et simple amant de la Beauté, de la Forme et de l’Art pour l’Art. Peut-être, après tout, craignait-il de se faire trop connaître, peut-être dissimulait-il les mouvements de son cœur...
Celui qui doit vivre peu de temps, s’il a beaucoup à faire ici-bas, a le droit d’être excusé s’il s’arrête souvent sur sa courte route, pour regarder et parfois pour rire. Il y a tant de beauté, autour de nous, et tant de hideurs aussi, de quoi se réjouir ou se moquer, avant que la lassitude ne vienne!—Elle ne vint pas au pauvre Beardsley, car les dernières lettres que je reçus de lui, révélaient une curiosité toujours aussi éveillée.
Telle est la dernière impression que j’eus de mon ami. Je veux croire que la richesse de ses visions d’artiste embellit même ses derniers moments.
[p. 153] La vieille amie de Madame Manet mère, chez qui je déjeunais entre les cours du Lycée Condorcet, me montrait une photographie, la Charlotte Corday de Tony-Robert Fleury, fils d’une autre de ses camarades d’enfance. Mme X. me disait: «Regarde cela; au moins, cela, c’est distingué. Ce n’est pas comme ce pauvre Edouard! Il est bien gentil garçon, Edouard; mais ce qu’il fait est si commun; c’est pénible pour une femme comme Madame Manet.» La vieille amie de Madame Manet, de mes parents et de tant de gens que j’ai connus, était une personne, comme ceux-ci, d’un «comme il faut» qui n’existe plus.
Portrait de la mère d’Edouard Manet, dans son bonnet à rubans, à côté de son vieux magistrat de mari, figure d’entêtement et d’obscurité. Elle fine, bien plus fine en réalité, que dans le tableau d’Edouard.—«Voilà le portrait de ses parents: on dirait deux concierges!» Pourtant cela me semblait très beau—à moi!
* * *
Mon père, sentant que j’aime la peinture de Manet, me dit une fois: «Oui, c’est drôle; il y a quelque chose là-dedans. J’ai été en pourparlers pour acheter à Edouard son Déjeuner sur l’herbe; il y avait un panneau de mesure dans la salle à manger. Ta maman a craint la nudité de la baigneuse. Après tout, elle avait peut-être raison; mais on aurait pu le mettre de côté, ce tableau, [p. 154] et tu l’aurais eu, pour plus tard.» Quels regrets, aujourd’hui!
* * *
Je devais avoir treize ou quatorze ans, quand on me conduisit dans l’atelier de Manet, son premier atelier de la rue de Saint-Pétersbourg; il donnait sur le pont de l’Europe, en plein midi; un salon à boiseries brunes et dorées, rez-de-chaussée que je vois encore comme si j’y étais. Sur le mur, la toile qui représente M. et Mme Astruc jouant de la mandoline. On était convié à regarder un portrait de Desboutin, avec le lévrier rose; mais je me rappelle, à droite du personnage, une chaise de jardin verte, un X qui m’avait beaucoup frappé et dont il n’y a plus trace dans la toile réexposée depuis.
Fut-ce cette fois, ou plus tard, que je vis, sur le chevalet le Linge, tout frais alors et si éblouissant de clarté, d’un bleu si vif et si gai, qu’on avait envie de chanter? Comme la peinture moderne se plombe! A peine le temps de songer à autre chose, et un tableau hier encore brillant, est déjà comme calciné, détruit. Nous admirons des ruines, des ruines de la veille. Vous ne savez pas ce que fut le Linge à son apparition. Je croirais devoir m’en prendre à moi-même, ou à déplorer l’état de mes yeux, si, depuis cinq ans, je n’avais assisté à la destruction d’un chef-d’œuvre de Delacroix, au musée de Rouen. Je l’ai vu se ternir, se craqueler et maintenant c’est une bouillie brune.
Comment Manet pouvait-il travailler dans ce salon qu’envahissait le soleil? C’est là que furent exécutés le paysage et les personnages du Linge. Non, je ne crois pas qu’il ait été peint en plein air. Le Bal de l’Opéra fut peint aussi dans l’atelier, l’après-midi, sans même essayer de donner l’illusion d’un effet du soir. Telle est l’Ecole réaliste au moment où l’on croit au Réalisme. Zola prend la plume, mais c’est du romantisme qu’il défend, non de la vérité crue. Manet est un romantique attardé et déformé.
* * *
[p. 155] Tout le monde connaît le visage de Manet, ce joli homme blond, gracieux, élégant, cravaté d’une Lavallière bleue à pois. Rieur, plus charmant que ses portraits. Oui, charmant, aimable, souriant, sa voix un peu enrouée avait des caresses. Ce qui me frappait, c’était l’embarras où il semblait mettre ses familiers. Il avait des amis, on l’aimait, mais il est certain qu’on l’admirait peu et l’on ne savait quelle attitude tenir quand il fallait s’exprimer sur son compte. On croyait peu en lui. Peut-être Claude Monet, Renoir avaient-ils de l’admiration; pourtant M. Degas, qui, depuis, a souvent répété: «Nous ne savions pas qu’il était si fort», M. Degas parlait de lui avec dureté. «Il est plus connu que Garibaldi, dites, quoi?» Voilà ce qu’on ne pouvait lui pardonner, même du haut de l’Olympe, où M. Degas s’était déjà juché; mais M. Degas avait des droits à l’Olympe. Manet, lui, était ici-bas beaucoup plus humble, sensible à la critique comme les autres, ambitieux de médailles, de décorations. Il désirait faire des portraits de jolies femmes. Il ne perdit jamais sa naïveté d’écolier.
* * *
Séance de Mlle Suzette Lemaire; pastels; Manet peine, se courbe, se retourne vers le petit miroir qu’il tient à sa gauche et où se reflète, inverti, le joli visage de la jeune fille. Manet veut prouver à Mme Madeleine Lemaire qu’il peut faire concurrence à Chaplin, le maître portraitiste de ces dames.
* * *
Manet ne travaillait que pour le «Salon». Les tableaux qui restent de lui sont «des Salons». Il fit relativement peu d’études, presque pas de dessins ou de croquis. Ce gentil causeur d’atelier et de café, qui veut plaire, aime la vie en commun, le boulevard, Tortoni, le café de Bade. Il prépare des «Salons» comme un élève de l’Ecole, comme un Prix de Rome, et il les fait d’actualité, se sert des modèles qu’il a à sa portée; heureusement, l’époque a encore une grâce à elle; le Paris de [p. 156] Manet a une saveur qui parfume ses œuvres les plus frêles.
* * *
Le Paris de Manet s’étend des Champs-Elysées à Montmartre en hiver, et jusqu’à Bougival et Argenteuil en été. L’île de France, chère aux impressionnistes, le paysage doux, mais médiocre des bords de la Seine dans la banlieue; maisons blanches et roses, pauvrettes dans leurs jardinets fleuris de géraniums, autour d’une boule de verre. Il aime les bancs verts et les arrosoirs, les petites barques à voile sur la rivière; mais l’âcre saveur de sa couleur et la nervosité de son pinceau donnent à toutes choses, si humbles soient-elles, le style et la noblesse—sa pâte, si soigneusement appliquée sur la toile, sa touche brusque et réfléchie à la fois, l’extrême soin avec lequel il cerne ses contours, peinant, effaçant, recommençant jusqu’à ce que la surface soit belle et pure, donnant au tableau de la force, de la propreté, quelque chose de définitif. Tout y a du poids, et pourtant on dirait d’une esquisse enlevée de verve. Ce parfum d’esquisse, la fraîcheur et le primesaut sont tels après de nombreuses séances de lutte, qu’à la première heure d’ébauche. Manet sait reprendre, sans salir; la fleur de sa palette ne se fane pas. Je ne le vis peindre que déjà malade, à la fin de sa vie, dans le second atelier de la rue de Saint-Pétersbourg; ce n’était plus la période espagnole, le beau temps de ses chefs-d’œuvre monochromes, immobiles et privés d’air; quand il m’admit à le regarder peindre, il était à la remorque des impressionnistes et leur prisonnier—pourtant il les dépassait de toute la hauteur de son superbe métier—Pertuiset, le tueur de lions; Jeanne; le Bar: tels sont mes souvenirs les plus précis. Vous qui n’avez pas vu ces œuvres à leur naissance, vous ne pouvez imaginer la violence et la crudité des couleurs dont elles éclataient. Les unes se sont calmées en prenant un bel émail, tel le Pertuiset; Jeanne et le Bar ont baissé [p. 157] de ton et se sont amortis. Les gris du Pertuiset furent des violets fouettés de rose; les chairs étaient rouges comme des pivoines, le paysage acide et brutal comme un décor russe. Manet, vite fatigué, allait s’asseoir sur un canapé bas, à contre-jour, sous la fenêtre, et contemplait son œuvre en tordant nerveusement sa moustache, ayant un geste de gamin qui dirait: «chic! chouette!» Mais était-il sûr de lui-même? Peut-être, car son nom flottait comme un drapeau de révolte, il était soutenu et «monté» sans cesse comme un candidat éloquent pendant une période électorale.
* * *
Le deuxième atelier de la rue de Saint-Pétersbourg, où je le connus, était un vrai atelier recevant le jour du Nord, banal et froid, au fond d’une cour pleine d’ateliers d’artistes; à côté de lui, c’était Henry Dupray, le joyeux peintre militaire, qui sonnait de la trompe, jouait du tambour et amusait tout le monde avec son esprit de brave garçon tapageur et sentimental. Devant la porte de Manet, de vagues pots de fleurs et des bacs verts avec des arbustes, comme à la terrasse d’un restaurant. Une grande promiscuité entre voisins; l’atelier de Manet était le rendez-vous de tous.
Je le revois surtout malade, s’appuyer sur une canne plombée, se tenant difficilement en équilibre sur ses semelles de caoutchouc. Il était fier de son joli pied chaussé de bottines anglaises; souvent vêtu d’une Norfolk Jacket à plis et à ceinture, tel qu’un chasseur, très élégant. Dans le coin, à droite de l’entrée, affalé sur le divan rouge, il est entouré d’Albert Wolff, d’Aurélien Scholl, de boulevardiers et de jolies demi-mondaines. Charles Ephrussi, Marcel Bernstein, le père d’Henri, commencent à acheter ses pastels, non pas qu’ils apprécient une peinture indigne de figurer à côté des gouaches de Gustave Moreau, sur des boiseries Louis XV authentiques; mais on aime Manet et puis on ne sait pas, après [p. 158] tout, s’il n’est pas un grand maître! Les conversations s’engagent légères, piquantes. Vers cinq heures on peut à peine trouver place auprès de l’artiste. Sur un guéridon de fer, accessoire qui revient souvent dans l’œuvre de Manet, un garçon de café sert des bocks de bière et des apéritifs. Les habitués montent du boulevard tenir compagnie à leur camarade. Emmanuel Chabrier chantonne et fait des mots.
Un jour, Manet me dit: «Apportez une brioche, je veux vous voir peindre une brioche: si l’on sait peindre une brioche, c’est qu’on est un peintre!» J’ai encore la petite toile pâlotte que je barbouillai sous ses yeux et dont il eut la bonté de paraître content. «Cet animal-là, il vous fait une brioche comme père et mère!»: 27 octobre 1881, 27, rue de Saint-Pétersbourg.
* * *
J’ai eu l’avantage de faire mes débuts à une époque où vivaient encore des artistes pour qui peindre, la peinture, le métier, étaient, en soi, une haute et magnifique fonction. Les jeunes gens n’ont plus l’intelligence de ces mots, leur pensée et leurs devoirs sont ailleurs. M. Henri Bidou me conseillait d’aller admirer au Salon d’Automne la dernière œuvre de M. Laprade, le port de Marseille. «C’est dessiné, établi à la façon d’un classique, cela rappelle Corot et même Poussin». Curieux, je me précipite vers le nouveau chef-d’œuvre: je me trouve en présence d’une esquisse vague, cotonneuse, d’une couleur de boue. Le désordre, l’hésitation, la facilité. Les mots ont sans doute un sens nouveau. Dans la salle voisine, on a réuni quelques toiles de Bazille, mort à 26 ans, pendant la guerre de 1870, de Bazille l’ami de Manet. Le public passe indifférent et se demande ce que font ici ces choses démodées et sans intérêt. Bazille n’était pas plus un génie que M. Laprade. Il était, comme lui, un peintre; il avait moins de prétentions et respirait un air plus sain, reposait ses yeux sur des objets plus familiers, [p. 159] qu’il prenait une peine touchante de «rendre» simplement, honnêtement, patiemment. De ses toiles s’exhale un parfum délicieux de pureté, de propreté morale, d’ingénuité. Manet ne fut pas différent; mais il était né pour de plus hauts destins, sa flamme intérieure était plus claire. Il avait un peu de génie. Il en avait comparé aux autres, ses contemporains et ses successeurs. Il en eut, certes, beaucoup, quand il peignit l’Olympia.
Simplicité, application, honnêteté, labeur, naïveté: divines qualités que pouvait se permettre, il y a quarante ans encore, un révolutionnaire, un révolté. Ces braves gens faisaient partie d’une société organisée. Envions leur sort; enviez leur sort, débutants d’aujourd’hui: ils croyaient savoir ce vers quoi ils marchaient et leurs ambitions n’excédaient pas leurs dons.
* * *
Je crois bien me rappeler l’attitude de Manet en face de Cézanne et il me semble que Cézanne était admiré pour ses réelles qualités, mais, un peu, comme un «douanier Rousseau», conscient de ce qu’il fait. Quel plaisir me donnèrent les paysages et la nature-morte—pommes rouges et pot au lait en fer-blanc—que j’avais achetés chez le père Tanguy, vers 1888! nous étions quelques-uns qui jouissions physiquement de la rareté de leur pâte et de leur ton—comme d’un émail ou d’un fragment de poterie persane. La forme nous amusait comme un dessin d’enfant. Nous n’étions pas prévenus à leur endroit. M. Berenson n’a rien ajouté à notre culte pour avoir dressé Cézanne à côté des grands primitifs italiens. Les deux sentiments étaient identiques, mais l’expression du nôtre était plus modérée et peut-être plus appropriée.
* * *
Pendant les deux ans où j’ai fréquenté Manet, je ne crois pas qu’il fût très conscient de ce qu’il peignait; jouissant de sa réputation d’artiste original et révolutionnaire, chef d’école dont se réclamaient Gervex, Duez, [p. 160] Bastien, Lepage et autres enfants prodiges, il semblait envier les succès matériels de ceux-ci; il avait vers eux les yeux plus souvent tournés que vers Renoir, Monet, Pissarro, Degas. Manet était un bon garçon, léger: le succès devait lui être plus précieux au Boulevard qu’auprès de M. Degas, dont l’acharnement spirituel le torturait. Oui, l’on était très simple dans ce temps-là. «Il était plus grand que nous ne le croyions! ce Manet», dit M. Degas, quand, à cinquante ans, il disparut. Opinion trop tardive!
* * *
L’atelier du 77 rue de Saint-Pétersbourg n’était guère celui où l’on se figure un maître dont l’influence domine la fin du dix-neuvième siècle et le commencement du vingtième. Encombré de vieilles toiles, oubliées alors, roulées pour la plupart, et dont plusieurs chefs-d’œuvre, il ressemblait à ceux où mes camarades faisaient semblant de travailler. Quelques rares meubles de hasard, un buffet de restaurant, où appuya ses mains la fille au corsage bleu du «Bar aux Folies-Bergères»; quelques pots de fleurs et une table où s’asseyent les amoureux de «chez le père Lathuile»; quelques bouteilles de vin de champagne; le miroir à pied de «Nana». Sur des chevalets, quelques pastels, dont George Moore et Méry Laurent, la luxuriante amie de Henry Dupray, visiteuse quotidienne de Manet, à l’heure où l’on vient bavarder et rire. Sur les chaises, un corsage de soie, un chapeau, qu’après le départ du modèle, Manet copie, ou croit copier, avec effort et application. Je me rappelle la robe de «Jeanne» et son ombrelle qui traînèrent là longtemps à côté des rhododendrons fanés, qui avaient servi de fond; et je me rappelle surtout combien différente du modèle était l’interprétation de Manet. Le maître me disait: «N’est-ce pas, c’est bien ça? c’est soyeux, riche, élégant, c’est bien une élégante?» et son gentil geste du bras, comme fauchant l’air, et la main droite faisant claquer ses doigts, donnait plus d’autorité à une [p. 161] voix faible et comme lointaine, de malade. Nulle gêne, mais peu de respect, semble-t-il, trop peu, autour de l’ami qu’on aimait, mais qu’on ne pouvait prendre au sérieux. Sans doute à cause de sa gentillesse.
«Eh! là, l’amateur! voilà qu’il file avec son cadre sous le bras...! allez donc dire aux marchands que ce n’est tout de même pas plus mal que Duez», et Manet rit de me voir emporter une tête au pastel, Méry Laurent coiffée d’une toque de lophophore, dans une jaquette grise garnie de skungs que j’ai obtenu que mon père m’achetât...
On regrette de n’avoir pas mieux connu l’excellent homme, de ne pas lui avoir parlé avec la tendresse et la vénération qu’il méritait. Mais peut-être préférait-il la camaraderie libre et gouailleuse, qui tant me choquait alors, à ma réserve silencieuse de petit jeune homme bien dressé. Alfred Stevens, ce gros Belge de Paris, si bon peintre, la veille encore, mais d’intelligence si limitée, c’est lui qui paraissait le pontife dans ce milieu artiste; un pontife au chapeau penché sur l’oreille, type de préfet du Second Empire, ou de colonel de cavalerie en goguette. Fantin avait une affection fraternelle pour Manet, mais farouche, il ne se serait pas risqué dans l’atelier du 77 rue de Saint-Pétersbourg. Il avait été quelquefois, jadis, chez M. et Mme Manet, du temps où des séances de musique de chambre étaient données par le vieux magistrat; Madame Edouard Manet ne paraissait jamais à l’atelier; cet atelier était décidément une annexe du Café de Bade;—là, Edouard n’était plus le fils de M. et Mme Manet: c’était l’antre du terrible peintre, de l’excentrique dont la mère disait: «pourtant, il a copié la Vierge au Lapin, de Tintoret, vous viendrez voir cela chez moi, c’est bien copié; il pourrait peindre autrement; seulement, il a un entourage...!»
* * *
Non, Edouard désirait faire des portraits qui plussent à sa famille. Le caractère, le dessin appuyé et dur de ses [p. 162] têtes, il les leur donnait malgré lui, à son insu, car il aimait «le joli».
M. Degas fut blessé et cessa de voir son ami, à cause d’un portrait double qu’il avait fait de M. et Mme Edouard Manet. Madame Manet jouait du piano. Elle était vue de profil. Cette figure fut coupée de la toile comme peu flatteuse, par la faiblesse du mari. Quant à Manet, assis en boule sur un canapé, si j’en juge par une photographie de ce beau fragment—c’était la vie même, c’était l’homme.
* * *
«Si l’on aime la peinture de Manet, on l’aime comme Corot, comme Tourguéneff», a écrit George Moore, l’Anglais des Batignolles, ainsi qu’il était désigné quand Manet fit de lui l’étonnant pastel «aux yeux mauves, au teint vert de noyé». Plus d’un quart de siècle après la mort du peintre, Moore parle encore de lui comme s’il venait de disparaître; pour lui Paris est vide sans Manet et l’on n’y fait plus de peinture.
* * *
Manet pasticheur.
Il n’y a pas deux tableaux dans toute son œuvre, qui n’aient été inspirés par un autre tableau, ancien ou moderne. Manet prenait, résolument, la composition d’une toile de maître, la traduisait à sa façon, recommençait l’œuvre choisie; les Espagnols, dont il a été si impressionné, dans sa plus belle manière, il les pastichait avec une volonté de faire des tableaux de musée. Personne plus que lui n’a démarqué et personne n’est plus original. Plus tard, influencé par Claude Monet, il fera du plein air, aussi polychrome que ses premières œuvres étaient blanches et noires, noires surtout; mais toujours et partout, la touche est de Manet, sa pâte est unique; la maladresse et la précision à la fois du pinceau, sa décision n’appartiennent qu’à lui. C’est «bien fait» jusque dans le lâché apparent. Il y a une plénitude dans [p. 163] son dessin simplifié et souvent incorrect, il y a une déformation dans le sens de la grandeur, dans son modelé. C’est grand, c’est lourd, c’est noble, même dans la nature morte. Rappelez-vous le Jambon sur un plateau d’argent! sommaire, mais robuste comme du Chardin, pourtant si moderne; on n’a jamais peint comme cela avant Manet, dont la pâte a des vertus mystérieuses. Le pinceau sait conserver le ton frais; il le pose sur la toile de telle façon que les dessous, si nombreux parfois, ne retirent rien de sa qualité limpide. Du «Guitariste» au «Linge», une révolution s’est opérée chez l’artiste; on croit à peine que les mêmes yeux aient pu voir, à quelques années de distance, si différemment. Toutefois, la griffe est reconnaissable. Toutes mes préférences sont pour la période espagnole et surtout pour «l’Olympia» qui m’apparaît comme une œuvre sans seconde dans notre âge. Comment l’homme que j’ai connu a-t-il pu mener à bien cette entreprise périlleuse: une femme nue sur un lit blanc, d’un si beau dessin, si noble, que la toile peut soutenir la comparaison avec un Titien, un Ingres?
On a parlé de Goya, à propos de l’Olympia. La duchesse d’Albe nue ou en costume de Maya. Manet a fait, aussi, une Espagnole en costume masculin, sur un sofa. Mais s’il a été hanté par des reproductions de ces deux ouvrages de Goya (dont il ne connaissait pas les originaux), combien il les a dépassés! Les Manet sont plus beaux que les Goya; ils leur ressemblent tout en étant si différents d’eux.
Un peintre de grand métier peut s’inspirer, doit s’inspirer de ce qu’il aime, et le recréer à sa façon. Il y a des artistes sans aucun intérêt ni originalité, dont la manière n’évoque aucunement le souvenir d’une autre manière. L’originalité n’est pas tant dans la conception que dans l’exécution. Les moyens sont tout en peinture, n’en déplaise à certains. Ingres a pillé—puisque l’on dit ainsi—tout ce qui lui sembla en valoir la peine. Son admirable «Thétis» est identique à une pierre gravée [p. 164] bien connue. Les statues grecques, les miniatures persanes étaient familières à Ingres. «L’Œdipe et le Sphynx» est fait d’après un patron, courant sur les vases étrusques. L’«Œdipe» n’est-il pas cependant le tableau le plus caractéristique du maître français?
* * *
C’est par la façon dont elle est faite, que l’œuvre de Manet s’impose et vivra. C’est par son fort métier que Manet aurait dû influer sur ses contemporains. Or, de sa maîtrise de technicien, il n’était pas question, jusqu’à ce que nous l’ayions découverte, beaucoup plus tard.
Nous voyons donc le même fait se reproduire pour tous les peintres: ce qui les désigne à l’attention des connaisseurs—pendant leur vie—c’est toujours la moins intéressante de leurs qualités. Certains hommes bénéficient de l’heure à laquelle ils ont paru, d’une circonstance fortuite de leur carrière; pourquoi le nom de Manet est-il devenu une sorte de référence pour les impressionnistes et les néo-impressionnistes? Il n’a pas de parents dans l’art moderne. Claude Monet combina une palette nouvelle, point Manet. Chez celui-ci, nul maniérisme mais beaucoup de hasard et de variété dans l’inspiration. Il ne fut pas théoricien. Ses phrases coutumières sur son art étaient des enfantillages aimables; il en parlait comme un «communard» amateur, de la révolution. Son œuvre est une exception, un dandysme, un objet de curiosité. Il mit du piquant dans tout ce à quoi il touchait, de la saveur, un charme inattendu. Son œuvre est une œuvre de hasard—œuvre aussi arbitraire que celle d’un Ricard ou d’un Gustave Moreau, nous pourrions dire d’un Degas. Ces artistes auraient pu être d’ailleurs et d’un autre âge. Des météores dans la nuit où se confondent les milliers de manieurs de pinceaux. Manet domine par la fatalité de son don!
| Pages | |
| Avant-propos | 7 |
| Fantin-Latour | 11 |
| Forain | 47 |
| James Mac Neill Whistler | 79 |
| Watts | 115 |
| Charles Conder | 123 |
| Aubrey Beardsley | 135 |
| Notes sur Manet | 151 |

Achevé d’imprimer
le 1er avril 1912
CE VOLUME EST MIS DANS LE
COMMERCE AU PRIX NET DE 7 FR. 50
Nous assistons, c’est un fait, à l’agonie du volume à 3 fr. 50. Les statistiques du dépôt légal constatent la diminution du nombre des romans qui paraissent chaque année. Est-ce à dire qu’on lise moins? Bien au contraire. Mais il s’imprime dans des collections à 95 centimes, 1 fr. 35, etc., des ouvrages tirés à cinquante mille exemplaires, ou davantage. On ne vendrait pas cinq mille exemplaires de ces mêmes ouvrages, s’ils étaient publiés à 3 fr. 50.
S’en étonner serait mal connaître les besoins modernes. S’en plaindre serait vain. Les éditeurs français n’ont fait qu’imiter leurs confrères anglais et américains qui depuis longtemps ont mis en circulation des collections à bon marché. Mais à côté de ces séries populaires, les libraires étrangers offrent au public des livres qui, sans constituer des publications de luxe réservées à quelques curieux, sont bien supérieurs, par l’élégance du format, la beauté du papier et des caractères, au banal volume jaune de nos devantures. On ne trouve rien de semblable en France.
[p. 170] C’est à quoi les Bibliophiles Fantaisistes se sont proposés de remédier.
Nous avons eu le rare plaisir de voir notre initiative comprise par un certain nombre d’auteurs déjà célèbres: MM. Paul Acker, Maurice Barrès, J.-E. Blanche, Henry Bordeaux, Marcel et Jacques Boulenger, René Boylesve, François de Curel, Edouard Ducoté, Claude Farrère, Gérard d’Houville, Louis Laloy, Pierre Louÿs, Paul Margueritte, Francis de Miomandre, Gabriel Mourey, Nozière, Pierre Mortier, G. de Pawlowski, Henri de Régnier, André Rivoire, Laurent Tailhade, Jérôme et Jean Tharaud, dont nous avons publié des œuvres ou avec lesquels nous avons pris des engagements.
Chacun de nos volumes est imprimé avec les caractères, le format et le papier qui nous semblent le mieux convenir au sujet. Nous arrivons ainsi à offrir à nos souscripteurs des ouvrages qui, par la manière seule dont ils sont présentés, constituent déjà des ouvrages de bibliophile.
Ils sont toujours tirés à 500 exemplaires numérotés à la presse, dont 20 au plus tirés sur papier impérial du Japon.
A dater de ce jour, les conditions de souscription sont établies comme suit: A n’importe quelle époque de l’année, tout amateur peut devenir souscripteur aux «Bibliophiles Fantaisistes», à la condition de verser à ce moment une somme de 60 francs, moyennant quoi il recevra franco par la poste et recommandés les dix premiers ouvrages à paraître dans la collection, quel que soit le prix auquel ceux-ci pourront être mis en vente séparément.
[p. 171] En outre, quelques souscriptions aux exemplaires de luxe seront acceptées au prix de 150 francs versés d’avance pour la série de 10 volumes.
Les exemplaires non souscrits sont mis dans le commerce à un prix variable, mais qui ne s’abaisse jamais au-dessous de 7 francs 50 pour les exemplaires ordinaires et de 18 francs pour les exemplaires sur Japon.
Les souscriptions sont reçues à la Librairie Dorbon-Aîné, 19, boulevard Haussmann, à Paris.
Marcel Boulenger: Nos Élégances.
(15 Novembre 1908—7 Fr. 50.)
René Boylesve: La Poudre aux Yeux.
(1er Février 1909—10 Francs.)
Louis Thomas: L’Esprit de Monsieur de Talleyrand.
(1er Mai 1909—7 Fr. 50—Avec une reproduction
du buste de Dantan.)
Cet ouvrage est complètement épuisé.
Jacques Boulenger: Ondine Valmore.
(15 Mai 1909—7 Fr. 50—Avec la reproduction
d’une miniature.)
François de Curel: Le Solitaire de la Lune.
(10 Juin 1909—7 Fr. 50—Avec un frontispice
par Armand Rassenfosse.)
Il ne reste plus que quelques exemplaires de ce volume.
Louis Laloy: Claude Debussy.
(10 Juillet 1909—10 Francs—Avec un portrait inédit
et un autographe musical.)
Nozière: Trois Pièces Galantes.
(1er Octobre 1909—7 Fr. 50.)
Claude Farrère: Trois Hommes et Deux Femmes.
(10 Octobre 1909—10 Francs.)
Cet ouvrage est complètement épuisé.
Louis Thomas: Les Douze Livres pour Lily.
(20 Octobre 1909—7 Fr. 50.)
Maurice Barrès: L’Angoisse de Pascal.
(10 Mars 1910—7 Fr. 50—Avec une reproduction
du Masque de Pascal et de l’une des
pages du manuscrit original des Pensées.)
Cet ouvrage est complètement épuisé.
Louis Loviot: Alice Ozy (1820-1893).
(15 Mai 1910—7 Fr. 50—Avec quatre portraits
de cette femme charmante.)
Francis de Miomandre: Gazelle (Mémoires d’une Tortue).
(1er Octobre 1910—7 Fr. 50.)
Paul Margueritte: Nos Tréteaux.
(15 Octobre 1910—8 francs.)
Louis Thomas: L’Espoir en Dieu.
(1er Novembre 1910—7 Fr. 50.)
Henri de Régnier: Pour les Mois d’Hiver.
(1er Mars 1912—7 Fr. 50.)
Paul Acker: Portraits de Femmes.
Henry Bordeaux: Les Amants de Genève.
(Avec 3 planches hors texte.)
René Boylesve: Nymphes dansant avec des Satyres.
(Avec des ornements de Pierre Hepp.)
André du Fresnois: Colette Willy.
Gérard d’Houville: Les Fourberies de l’Amour.
Gabriel Mourey: Maurice Denis.
André Rivoire: Henri de Toulouse-Lautrec.
Jacques Boulenger: Candidature au Stendhal-Club.
Marcel Boulestin: Tableaux de Londres.
Edouard Ducoté: Le Château des deux Amants.
Claude Farrère: Un Livre de Contes.
Pierre Louÿs: Versions Grecques.
Eugène Marsan: Giosué Carducci.
Pierre Mortier: Becquets.
G. de Pawlowski: Comœdia...
Henri de Régnier: Les Dépenses de Madame de Chasans.
(documents sur la vie de famille au XVIIIe siècle).
Laurent Tailhade: Au Pays de l’Alcool et de la Foi.
Jérôme et Jean Tharaud: En regardant travailler Maurice Barrès.
Louis Thomas: André Rouveyre.
(Avec de nombreuses illustrations de Rouveyre.)
En vente chez DORBON-AINÉ
19, Boulevard Haussmann, 19, PARIS, IXe
LA MÉSANGÈRE
Les Petits Mémoires de Paris
I. Coulisses de l’Amour.—II. Rues et intérieurs.—III. Carnet d’un Suiveur (le Paris du Second Empire).—IV. Petits Métiers Parisiens.—V. Les Nuits de Paris.—VI. Toutes les Bohêmes.
| Collection de 6 petits volumes in-24, illustrée de 24 eaux-fortes originales de Henri Boutet, de 8 reproductions hors texte, dont 4 en couleurs, d’estampes d’Abraham Bosse, A. de Saint-Aubin, Bouchardon, Traviès, Gavarni, etc., et de nombreux fleurons, en-têtes et culs-de-lampe. Chaque volume | 2 Fr. |
| La collection complète dans un étui, reliée 1/2 chagrin de diverses couleurs, dos plat orné | 20 Fr. |
| Il a été tiré 25 exemplaires sur papier du Japon avec double suite des eaux-fortes. La collection des 6 volumes | 60 Fr. |
Xavier PRIVAS
Petites Vacances
Chansons, Rondes et Berceuses enfantines
Paroles et musique, avec Jeux sur les Rondes par Francine Lorée-Privas.
| Un volume in-4o à l’italienne, entièrement illustré en couleurs d’après les aquarelles de P. Guignebault, dans un cartonnage illustré or et couleurs | 7 Fr. 50 |
Sacha GUITRY
Correspondance de Paul Roulier-Davenel
| Illustré par l’auteur de 19 portraits-charges (Anatole France, H. de Régnier, Laurent Tailhade, Tristan Bernard, Jules Lemaître, Ibsen, H. de Rothschild, Antoine, Lucien et Sacha Guitry, Brasseur, Boisselot, etc...). Un volume in-4o couronne tiré à petit nombre. | 5 Fr. |
| Il a été tiré 15 exemplaires sur Japon, à | 15 » |
Louis THOMAS
Le Général de Galliffet
| Un volume in-8 écu avec portrait | 5 Fr. |
Edmond JALOUX
Le Boudoir de Proserpine
| Un volume in-8 carré, tiré à petit nombre | 5 Fr. |
| Il a été tiré 9 exemplaires sur papier du Japon, à | 18 Fr. |
TOLSTOÏ
La Loi de l’Amour et la Loi de la Violence
(Le dernier ouvrage paru du vivant de Tolstoï)
Traduit d’après le manuscrit et publié en français avant l’original russe par E. Halpérine-Kaminski. Précédé d’une lettre de Tolstoï à propos de La Barricade de Paul Bourget.
| Un volume in-18, avec portrait inédit et fac-similé d’autographe. (Honoré d’une souscription du Conseil municipal de la ville de Paris) | 3 Fr. 50 |
| Il a été tiré 10 exemplaires sur Japon, à | 12 Fr. |
Marcel PROUILLE et Ch. MOULIÉ
Les Poésies de Makoko Kangourou
| Brochure in-8 écu avec un frontispice de Guy Tollac | 1 Fr. 50 |
Léon VAN NECK
1870-71 illustré: Campagne franco-allemande
Préface de Paul ADAM
| Un volume grand in-8, orné d’environ 400 reproductions de pièces documentaires de l’époque: images populaires, tableaux, objets d’art, portraits, illustrations de journaux, etc | 5 Fr. |
Francis DE MIOMANDRE
Figures d’Hier et d’Aujourd’hui
| Un volume in-8 carré, tiré à petit nombre | 5 Fr. |
| Il a été tiré 15 exemplaires sur papier du Japon à | 18 » |
Edgar POË
Dix Contes traduits par Ch. Baudelaire et illustrés par Martin van Maële
de 95 compositions originales gravées sur bois par E. Dété. Un volume in-8 jésus tiré à 500 exemplaires numérotés, dont
| 20 exemplaires sur papier du Japon avec deux suites avant lettre de toutes les figures, dont une en bistre et une en noir, sur Chine | 150 Fr. |
| 30 exemplaires sur papier de Chine avec une suite en bistre avant lettre de toutes les figures, également tirée sur Chine | 100 Fr. |
| 450 exemplaires sur papier vélin à la cuve du Marais | 50 Fr. |
A. ROBIDA
Les Vieilles Villes des Flandres
(Belgique et Flandre française)
| Illustré par l’auteur de 155 compositions originales, dont 25 hors texte, et d’une eau-forte. Un beau volume gr. in-8, sous couverture illustrée en couleurs | 15 Fr. |
| Cartonné toile avec fers spéciaux spécialement dessinés par l’artiste, tête ou tranches dorées, couverture conservée | 20 Fr. |
| Il a été tiré en outre: 25 exemplaires sur Japon impérial, contenant une double suite de toutes les compositions, 3 états de l’eau-forte et une aquarelle originale de A. Robida | 100 Fr. |
| 100 exemplaires sur papier de Hollande Van Gelder, contenant une double suite de l’eau-forte et un dessin original à la plume de A. Robida | 50 Fr. |
Les Vieilles Villes du Rhin
(A travers la Suisse, l’Alsace, l’Allemagne et la Hollande).
| Un volume in-8 jésus de 310 pages, illustré de 211 dessins originaux de l’auteur, d’une eau-forte et d’une aquarelle en couleurs sur la couverture | 20 Fr. |
| Il a été tiré en outre: 10 exemplaires sur grand papier vélin à la cuve avec deux suites de toutes les gravures, sur Japon ancien et sur Chine, et une aquarelle originale de A. Robida | 200 Fr. |
| 25 exemplaires sur Japon impérial avec une suite sur Chine de toutes les gravures, à | 100 Fr. |
| 5 exemplaires sur Chine, à | 50 Fr. |
| Plus: 10 collections d’épreuves d’artiste signées, dont 5 sur Japon ancien à 125 Fr. et 5 sur Chine à | 100 Fr. |
Loys DELTEIL
expert à l’Hôtel Drouot
Manuel de l’Amateur d’Estampes du XVIIIe siècle
| Un volume grand in-8 de 448 pages sur papier vergé teinté, orné de 106 reproductions hors texte sur papier couché teinté des estampes les plus rares du XVIIIe sièclebroché: | 25 Fr. |
| dans un cartonnage spécial avec couverture conservée | 28 Fr. |
| Il a été tiré 3 exemplaires sur papier du Japon à | 75 Fr. |
E. BÉNÉZIT
avec la collaboration d’un groupe d’écrivains spécialistes français et étrangers
Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Graveurs et Sculpteurs de tous les temps et de tous les pays,
avec l’indication des prix atteints par leurs œuvres dans les ventes publiques. 3 forts volumes in-8 raisin, avec de nombreuses illustrations d’après les maîtres, leurs signatures et monogrammes.
Vient de paraître le tome I comprenant 1056 pages à 2 colonnes et 64 reproductions hors texte.
| Broché | 60 Fr. | { | payable moitié à la réception du tome I et moitié à la réception du tome II. |
| Relié | 75 Fr. |
La Sorcellerie au Maroc
| Œuvre posthume précédée d’une étude documentaire sur l’œuvre et l’auteur, par Jules Bois. Un volume in-8 avec 17 illustrations, la plupart d’après les photographies prises par l’auteur | 7 Fr. |
Th. DE CAUZONS
Histoire de la Magie et de la Sorcellerie en France
| I. Les sorciers d’autrefois. Le Sabbat. La guerre aux sorciers. Un vol. in-8 écu de XVI—426 pp | 5 Fr. |
| II. Poursuite et châtiment de la Magie jusqu’à la Réforme protestante. Le procès des Templiers. Mission et procès de Jeanne d’Arc. Un vol. in-8 écu de XXII—520 pp | 5 Fr. |
| III. La Sorcellerie, de la Réforme à la Révolution française. La Franc-Maçonnerie. Mesmer, Cagliostro et le magnétisme. Un vol in-8 écu de VIII—550 pp | 5 Fr. |
| IV. La Sorcellerie contemporaine: Les transformations du magnétisme, Psychoses et névroses. Les Esprits des vivants, les Esprits des morts. Le diable de nos jours. Le merveilleux populaire. Un vol. in-8 écu de VIII—724 pp | 7 Fr. |
Il a été tiré quelques exemplaires sur Japon, à 12 Fr. chacun des 3 premiers tomes, et 15 Fr. le dernier.

LIÉGE
IMPRIMERIE BÉNARD
SOCIÉTÉ ANONYME
CE VOLUME EST MIS DANS LE
COMMERCE AU PRIX NET DE 7 FR. 50
Au lecteur.
L’orthographe d’origine a été conservée et n’a pas été harmonisée, mais les erreurs clairement introduites par le typographe ou à l’impression ont été corrigées. Les mots ainsi corrigés sont soulignés en pointillés. Placez le curseur sur ces mots pour faire apparaître le texte original. Également à quelques endroits la ponctuation a été corrigée.